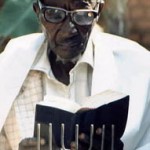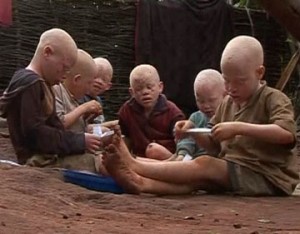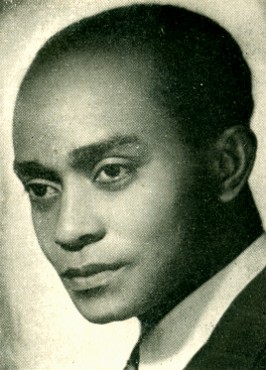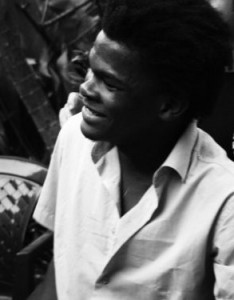Après mon post un peu sec sur la « pseudo-indépendance » du Sénégal, je devrais en principe, écrire quelque chose de positif sur le « sursaut démocratique » de la rue sénégalaise contre le projet – totalement imbécile – de réforme constitutionnelle d’Abdoulaye Wade. Le problème, c’est que rien dans cette « réaction » ne m’inspire la moindre sympathie. C’est comme s’il fallait féliciter le cocu dans le célèbre sketch de Raymond Devos (« j’ai des doutes ») de sa lucidité in extremis : J'ai des doutes !… J'ai des doutes !… Hier soir, en rentrant dans mes foyers plus tôt que d'habitude…il y avait quelqu'un dans mes pantoufles… Mon meilleur copain… Si bien que je me demande si, quand je ne suis pas là… il ne se sert pas de mes affaires ! (….) Alors !… mes pantoufles !… mon pyjama !… ma radio !… mes cigarettes !… et pourquoi pas ma femme pendant qu'il y est !…
Après mon post un peu sec sur la « pseudo-indépendance » du Sénégal, je devrais en principe, écrire quelque chose de positif sur le « sursaut démocratique » de la rue sénégalaise contre le projet – totalement imbécile – de réforme constitutionnelle d’Abdoulaye Wade. Le problème, c’est que rien dans cette « réaction » ne m’inspire la moindre sympathie. C’est comme s’il fallait féliciter le cocu dans le célèbre sketch de Raymond Devos (« j’ai des doutes ») de sa lucidité in extremis : J'ai des doutes !… J'ai des doutes !… Hier soir, en rentrant dans mes foyers plus tôt que d'habitude…il y avait quelqu'un dans mes pantoufles… Mon meilleur copain… Si bien que je me demande si, quand je ne suis pas là… il ne se sert pas de mes affaires ! (….) Alors !… mes pantoufles !… mon pyjama !… ma radio !… mes cigarettes !… et pourquoi pas ma femme pendant qu'il y est !…
Le simple fait que ce projet de loi ait existé, qu’Abdoulaye Wade ait eu la folie de le penser, que son gouvernement ait accepté de le présenter au Parlement, qu’il se soit trouvé une majorité de députés pour sérieusement penser à l’adopter (le gros de l’opposition ayant boycotté les dernières législatives, la majorité de Wade à la chambre est absolue) et que de Wade au dernier des parlementaires, tous ces gens aient pensé que les Sénégalais ne feraient rien, qu’il aie fallu attendre le dernier moment pour empêcher le désastre…. Rien, absolument rien dans ce cauchemar n’est à saluer. Ce projet de loi aurait dû, vu l’histoire démocratique de ce pays, être tout bonnement « impensable ». De la même façon qu’un coup d’état militaire en France, la fin de la monarchie britannique ou un Pape Africain sont impensables. Wade l’a pensé. Et ses députés et lui se sont étonnés de la réaction des Sénégalais. Moi aussi, à vrai dire.
J’avais vraiment cru que la stratégie du pot-au-feu avait finalement abouti. La recette est simple : cuisinez un peuple à feu doux, veillez surtout à ne pas le brusquer au départ, mais faites lui avaler à doses de plus en plus fortes, toutes sortes de projets législatifs, économique, architecturaux ou politiques plus abscons les uns que les autres, saupoudrez tout ça d’une fine touche de paternalisme, remuez toujours dans le bon sens, celui de l’exception nationale, Sénégal, lumière du monde et de l’Afrique, pour éviter tout débordement, pensez à corrompre à grandes louchées quiconque a la vélléité de faire usage de sa cervelle et le peuple est enfin prêt à tout accepter. Wade n’a peut-être pas assez corrompu.
Les Sénégalais pensent que le Sénégal, ne concerne qu’eux-seuls. Ils se trompent. Le Sénégal leur est prêté, c’est l’affaire de beaucoup d’Ouest-Africains, pour qui ce pays, le seul de la région n’ayant jamais connu de putsch, est un phare, le métronome. C’est justement pourquoi leur passivité inconcevable au cours des six dernières années, alors qu’il était évident qu’Abdoulaye Wade avait perdu tout sens des réalités et transformait leur pays en une énième satrapie tropicale m’a agacé d’abord, puis bouleversé et enfin anéanti. C’est comme de voir un ami d’enfance devenir opiomane.
Je me demande si les gens se rendent compte du changement : il y a dix ans, le monde se félicitait du sens démocratique des Sénégalais parce qu’ils organisaient une transition politique, pacifique, ordonnée, libérale ; aujourd’hui on devrait applaudir parce qu’il a fallu trois morts et une centaine de blessés pour éviter l’instauration d’une dyarchie héréditaire (de facto) dans leur pays. C’est ça le progrès ?
J’ai longtemps pensé que cette décennie serait celle des aspirations rabougries, le « printemps » sénégalais l’illustre bien, c'est-à-dire sordidement.
Joël Té Léssia