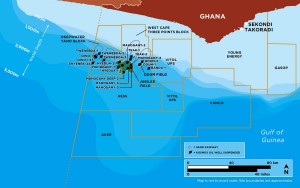Les dernières années ont été plutôt fastes pour l'Algérie qui a connu des évolutions favorables pour ses principaux équilibres macro-économiques et financiers. En 2008, le produit intérieur brut (PIB) en volume a connu un taux de croissance de 2,4 %. Sa valeur (en terme nominal) est passée de 135,3 milliards de dollars à plus de 162,9 milliards de dollars, aboutissant à un PIB par habitant de près de 4 681 dollars par an. Avec près de 80 milliards de dollars d’exportations, l’Algérie a réalisé un excédent commercial de 39,983 milliards de dollars, contre 32,898 milliards de dollars en 2007, soit une augmentation de 21,53 % de la balance commerciale et de 30,48 % des exportations en valeur. Les réserves de change qui avaient franchi la barre des 110 milliards de dollars en 2007 (110,2 milliards en fin d’année) s’établissaient fin 2008 à 143,1 milliards de dollars, soit une augmentation de près d’un tiers (29,85 %) par rapport aux douze derniers mois. L’évolution des réserves de change à ce rythme représente une couverture d’importations de plus de deux ans et demi après avoir été d’un an et demi seulement en 2003, comme nous pouvons le constater dans le tableau (1).
Les dernières années ont été plutôt fastes pour l'Algérie qui a connu des évolutions favorables pour ses principaux équilibres macro-économiques et financiers. En 2008, le produit intérieur brut (PIB) en volume a connu un taux de croissance de 2,4 %. Sa valeur (en terme nominal) est passée de 135,3 milliards de dollars à plus de 162,9 milliards de dollars, aboutissant à un PIB par habitant de près de 4 681 dollars par an. Avec près de 80 milliards de dollars d’exportations, l’Algérie a réalisé un excédent commercial de 39,983 milliards de dollars, contre 32,898 milliards de dollars en 2007, soit une augmentation de 21,53 % de la balance commerciale et de 30,48 % des exportations en valeur. Les réserves de change qui avaient franchi la barre des 110 milliards de dollars en 2007 (110,2 milliards en fin d’année) s’établissaient fin 2008 à 143,1 milliards de dollars, soit une augmentation de près d’un tiers (29,85 %) par rapport aux douze derniers mois. L’évolution des réserves de change à ce rythme représente une couverture d’importations de plus de deux ans et demi après avoir été d’un an et demi seulement en 2003, comme nous pouvons le constater dans le tableau (1).
Tableau (1) : Couverture des réserves de change en mois d’importation[3].
Indicateurs
|
2003
|
2004
|
2005
|
2006
|
2007
|
2008
|
2009
|
En mois d’importations n+1 (fab)
|
18,1
|
21,0
|
26,5
|
28,0
|
27,4
|
31,0
|
38
|
Source: IMF Country Report No.11/40, February 2011.
La balance des paiements a enregistré en 2008 un excédent global de 37 milliards de dollars, contre 29,6 milliards de dollars en 2007. Le solde de compte courant s’est établi en 2008 à 35,2 milliards de dollars.
Le niveau de la fiscalité pétrolière budgétisée est passé de 14,296 milliards de dollars à 26,391 milliards de dollars entre la loi des finances initiale 2008 (LFI 08) et complémentaire de 2008 (LFC 08), soit une progression de 76,8 %, sous l’effet de la révision à la hausse du prix de référence fiscal du baril de pétrole brut qui est passé de 19 dollars/baril à 37 dollars/baril. Par ailleurs, les disponibilités du fond de régulation des recettes (FRR) [4] ont atteint, au 31 décembre 2008, un montant de 65,847 milliards de dollars. Une richesse conjoncturelle qui est le produit conjugué de l’accroissement des exportations et l’augmentation des prix des hydrocarbures qui rendent l’économie nationale plus que fragile. La politique de l’État, les projets, les prévisions, le financement du budget, les décisions, les importations (alimentations, médicaments), les plans sont paramétrés par les ressources des hydrocarbures.
Une économie rentière et fortement dépendante
En effet, l’analyse de la structure de l’économie algérienne démontre une forte dépendance à la rente pétrolière. Le secteur des hydrocarbures est par excellence le pilier de l’économie locale. Son apport au PIB en 2008 a atteint près de 50 % et sa contribution en valeur ajoutée avoisinait les 77 milliards de dollars. L’aisance financière que connait l’Algérie aujourd’hui est exclusivement l’œuvre de ce secteur. Elle est strictement liée à deux facteurs essentiels : l’envolée des cours des hydrocarbures et l’augmentation des volumes d’exportations depuis 2002. Les hydrocarbures représentent la majorité des exportations des biens et de marchandises. Ils restent également la source principale des ressources en devises. 77,246 milliards de dollars des 79,139 milliards de dollars des exportations de marchandises proviennent des hydrocarbures, soit plus de 97,6 % de la valeur des exportations en 2008.
Les exportations d’hydrocarbures ont connu une augmentation de plus de 30,5 % en valeur par rapport à l’année 2007, grâce à l’accroissement du prix du baril de pétrole qui a connu une augmentation de plus d’un tiers par rapport à son prix en 2007, où il se situait à 74,4 dollars le baril pour atteindre 99,1 dollars en moyenne, et cela en dépit de la baisse de la production du secteur qui a enregistré un recul de 3,3 % en un an. Le secteur des hydrocarbures en 2008 a enregistré pour la troisième année consécutive, une baisse en volume de sa production : -2,3 % en 2008, – 0,9 % en 2007 et – 2,5 % en 2006. Cette diminution est due essentiellement au recul de la production du pétrole brut de – 4 %. Ceci a induit un repli du volume des exportations qui a connu une baisse de 3,3 % entre 2007 et 2008.
 La production primaire d’hydrocarbures pour l’année 2007 s’est élevée à 233,3 millions de tonnes équivalent pétrole (TEP). Le bilan par produits fait ressortir des productions de 63,8 millions de tonnes de pétrole brut, 152,8 milliards de m³ de gaz naturel, 13,7 millions de tonnes de condensat, 8,6 millions de tonnes de gaz du pétrole liquéfié (GPL) et 40 millions de m³ de gaz naturel liquéfié (GNL), d’après les statistiques de la Sonatrach [5] (rapport annuel d’activité, année 2007). Les productions et les exportations du gaz naturel ont enregistré quant à elles une quasi-stagnation depuis plus de 3 ans, en partie à cause de la crise économique mondiale. Même si ces chiffres indiquent une certaine « santé financière [6] » et une renaissance de l’économie après la crise de 1986 [7] et l’application du Plan d’ajustement structurel (PAS) en 1994, l’économie demeure néanmoins fortement dépendante aux prix des hydrocarbures[8], peu diversifiée avec des résultats dérisoires et une croissance artificielle sans réel développement, se qui accroît son caractère fébrile et vulnérable. À cette faiblesse structurelle de l’économie nationale s’ajoute l’inefficacité des autres secteurs qui fonctionnent au ralenti.
La production primaire d’hydrocarbures pour l’année 2007 s’est élevée à 233,3 millions de tonnes équivalent pétrole (TEP). Le bilan par produits fait ressortir des productions de 63,8 millions de tonnes de pétrole brut, 152,8 milliards de m³ de gaz naturel, 13,7 millions de tonnes de condensat, 8,6 millions de tonnes de gaz du pétrole liquéfié (GPL) et 40 millions de m³ de gaz naturel liquéfié (GNL), d’après les statistiques de la Sonatrach [5] (rapport annuel d’activité, année 2007). Les productions et les exportations du gaz naturel ont enregistré quant à elles une quasi-stagnation depuis plus de 3 ans, en partie à cause de la crise économique mondiale. Même si ces chiffres indiquent une certaine « santé financière [6] » et une renaissance de l’économie après la crise de 1986 [7] et l’application du Plan d’ajustement structurel (PAS) en 1994, l’économie demeure néanmoins fortement dépendante aux prix des hydrocarbures[8], peu diversifiée avec des résultats dérisoires et une croissance artificielle sans réel développement, se qui accroît son caractère fébrile et vulnérable. À cette faiblesse structurelle de l’économie nationale s’ajoute l’inefficacité des autres secteurs qui fonctionnent au ralenti.
Une agriculture qui fonctionne au ralenti…
Le bilan que nous pouvons faire de l’état du secteur agricole en Algérie après près d’un demi-siècle d’indépendance ne peut être positif. Un retard de développement de l’activité est constaté. Une dépendance accrue aux importations étrangères s’est dangereusement manifestée. Le secteur agricole dans le pays s’est révélé une victime collatérale de la stratégie du développement poursuivie par l’État durant les années du « socialisme ». L’avenir de l’agriculture semble en grande partie compromis. Même les nouveaux dispositifs visant à développer le secteur se heurtent à un blocus d’obstacles qui risquent de les entraver.
Alors que l’agriculture profitait d’une position privilégiée à l’époque coloniale, où elle fut l’activité qui bénéficiait le plus des subventions de l’État et jouissait des attentions des autorités publiques grâce à une politique agricole efficace, elle s’est vu reléguée à un second plan après l’indépendance, faisant les frais d’un choix de développement « peu réfléchi » qui a favorisé l’activité industrielle au prix de lourds investissements à travers la stratégie des « industries industrialisantes » [9]. De l’autogestion au socialisme agraire révolutionnaire et aux plans de libéralisations imposées par les institutions financières internationales, l’activité agricole en Algérie a servi de champs d’expériences pour les « idiologies » de technocrates campant dans les bureaux de l’administration centrale.
Les résultats décevants de l’agriculture depuis l’indépendance ne sauraient s’expliquer uniquement par l’héritage colonial qui a, certes, bouleversé à jamais la structure rurale en particulier pour le foncier agricole, qui demeure aussi complexe que problématique[10], mais aussi, par la création d’un dualisme de deux secteurs agricoles (traditionnel et moderne) qui subsiste jusqu’à nos jours. Elles ne sauraient s’expliquer uniquement par des causes naturelles et climatiques. Les réformes perpétuelles et les réaménagements persistants, les modes d’organisation et les mutations, souvent à caractères bureaucratiques liés notamment au statut de la terre, à son mode d’exploitation et à la distorsion considérable dans l’allocation des ressources sont parmi les éléments responsables de la situation du secteur aujourd’hui. Malgré une relative amélioration des indices globaux, l’activité demeure déficitaire et est loin de satisfaire la demande locale même si sa contribution au Pib est en croissance (11,086 milliards de dollars 2008 contre 10,152 milliards de dollars en 2007) comme nous le constatons dans le tableau (2).
Tableau (2) : Contribution sectorielle de l’agriculture dans le PIB à prix courants.
| |
2003
|
2004
|
2005
|
2006
|
2007
|
2008
|
Contribution de l’agriculture au PIB
|
6,660
|
8,032
|
7,901
|
8,805
|
10,153
|
11,087
|
Part de l’agriculture dans le PIB
|
9,80 %
|
9,40 %
|
7,70 %
|
7,60 %
|
7,60 %
|
6,50 %
|
Source: IMF Country Report No.11/40, February 2011.
L’analyse de la situation du secteur indique qu’il est toujours sujet à d’interminables restructurations et de réaménagements infinis, perpétuant ainsi l’altération d’un secteur déjà en grande difficulté, loin d’assurer son activité productive. L’étude des niveaux de production ainsi que l’examen de la balance commerciale agricole confirment ce constat. Le secteur est confronté depuis l’indépendance à une multitude de problèmes de tout ordre : techniques, financiers et humains. Ce secteur, qui a contribué fortement à la croissance économique dans le passé, en matière de production et d’absorption de la main-d’œuvre, n’assure aujourd’hui que partiellement la couverture des besoins en produits alimentaires de base (tableau 3) :
Tableau (3) : Taux de couverture de la production nationale par rapport à la demande :
Produit
|
Blé
|
Légumes secs
|
Pomme de terre
|
Viande rouge et blanche
|
Lait
|
Taux moyen
|
24,0 %
|
12,9 %
|
61,7 %
|
88,2 %
|
47,4 %
|
Source : D’après nos propres calculs à partir des différentes statistiques.
En 2008, la production agricole a enregistré une baisse en volume de près de 5,3 % par rapport à celle de 2007. Cette baisse est la conséquence d’un recul de la production végétale de l’ordre de 10 % due à une réduction importante des niveaux de production céréalière de l’ordre de 60 % (de 40,2 millions de quintaux en moyenne pour la période 2003-2007 à 17 millions en 2008) et près de 18 % de légumes secs par rapport à la même période (ministère de l’Agriculture et du Développement rural). Cette situation a obligé l’État à se tourner vers les importations afin de combler le déficit. Ainsi, les importations alimentaires ont connu un accroissement en volume de l’ordre de 5,7 % par rapport à 2007 (augmentation de 21,7 % pour les produits laitiers, 100,55 % pour les céréales).
Une industrie en mal de développement
Durant les années 1970, dans le modèle algérien de développement, le processus d’industrialisation a été orienté vers l’implantation prioritaire d’industries de base et, par conséquent, dissocié de la demande existante tant sur le marché national que le marché international. De plus, l’investissement dans sa presque totalité devait être destiné aux « industries industrialisantes », qui recouvraient dans le cadre de l’économie industrielle algérienne un rôle primordial. Il allait ainsi en priorité aux secteurs des hydrocarbures, de la pétrochimie, de la sidérurgie et de la mécanique qui sont les « industries industrialisantes »[11].
Dès lors, une économie rentière basée essentiellement sur les industries pétrolières s’est mise en place. La prérogative accordée au secteur industriel se traduisait par une importante accumulation des fonds résultant d’un taux très élevé des investissements. Un taux d’investissement sans précédent dans l’industrie s’est développé au détriment du secteur agricole, délaissé et défavorisé en termes d’investissement. Aujourd’hui, en dépit d’un taux de croissance de l’ordre de 4,3 % en 2008, la contribution de la production du secteur industriel hors hydrocarbures à la formation du produit intérieur brut demeure très marginale en comparaison avec les pays voisins comme le Maroc ou la Tunisie.
La Tunisie est le premier exportateur industriel en valeur absolue en Afrique. Le textile et l’agroalimentaire représentent plus de la moitié de sa production. Les industries mécaniques et électriques se multiplient d’une année à l’autre. Les échanges commerciaux de la Tunisie connaissent une forte progression, +21,8 % à l’exportation et +23,7 % à l’importation entre 2007 et 2008. La filière mécanique, électrique et électronique occupe une place croissante dans ces échanges. Il en va de même au Maroc, où les industries des différentes branches manufacturières, du textile (42 % de l’emploi et 34 % du secteur manufacturier), de l’agroalimentaire, de l’industrie navale, pharmaceutique et automobile et même aéronautique, se développent.
Une des raisons essentielles de la décadence de l’activité industrielle en Algérie est le sous-investissement qui a marqué le secteur depuis une trentaine d’années, contrairement à la période post-indépendance qui s’est caractérisée par des investissements gigantesques.
Tableau (4) : Indice général de la production industrielle hors hydrocarbures (1989 = 100)
Année
|
2003
|
2004
|
2005
|
2006
|
2007
|
Indice (base 1989 = 100)
|
73,8
|
73,8
|
74,6
|
74,4
|
72
|
Source : Fond Monétaire International.
La part du secteur industriel dans le PIB chute de 5 % en 2007 à 4,39 % en 2008, mais représente une augmentation en valeur nominale d’un peu moins de 310 millions de dollars. Cet accroissement est le fruit d’une augmentation dans le secteur de l’énergie, des mines, de la chimie et de l’industrie agroalimentaire, malgré une baisse dans les secteurs des matériaux de construction, des textiles, du cuir et du bois comme nous constatons à travers le tableau (5).
Tableau (5) : Taux de croissance dans les secteurs industriels hors hydrocarbures.
Bois
|
Chimie
|
Cuir
|
Énergie
|
Mines et carrières
|
IAA
|
Textiles
|
-11,90 %
|
2,50 %
|
-1,20 %
|
7,90 %
|
9,80 %
|
6,80 %
|
-1,10 %
|
Source: IMF Country Report No. 09/111, Algeria: Statistical Appendix, April 2009.
Cette situation intervient alors que l’État a consacré un niveau important de ressources aux investissements, hélas, mal gérées.
Inefficacité des dépenses publiques…
Après la décennie noire des années 1990, une nouvelle perspective économique s’est mise en marche, propulsée par le programme du Président A. Bouteflika. L’Algérie a profité depuis son élection d’une conjoncture financière particulièrement favorable, suite au vif redressement du marché pétrolier et à l’affermissement des prix du baril du pétrole qui a alors atteint plus de 34 dollars le baril, soit, un triplement de prix par rapport à celui de 1998 (10 dollars/baril en moyenne durant l’année 1998).
Le début de la période de présidence de A. Bouteflika s’est caractérisé par le lancement du Programme de soutien et de relance économique (PSRE) d’un montant de 7 milliards de dollars sur la période de 2000 à 2004, suivi du Programme complémentaire de soutien à la croissance (PCSC[12]) et de la mise en œuvre des grands projets d’investissements productifs et d’infrastructures publiques, pour une enveloppe globale de 55 milliards de dollars sur la période de 2005 à 2009, soit, en moyenne, quelque 11 milliards de dollars par an. Les plus importants de ces projets concernaient particulièrement les infrastructures : achèvement des travaux de l’aéroport d’Alger, lancement de la construction de l’autoroute Est-Ouest, édifice de nouveaux logements sociaux dans le cadre du projet d’un million de logements sociaux, etc. En dépit de ce fort taux d’investissement et l’accroissement de la dépense publique mobilisée pour la réalisation de ces grands projets d’infrastructure et l’accomplissement des programmes de soutien à la croissance, les résultats ne suivent pas !
D’après le rapport du FMI d’octobre 2009, malgré une dépense publique de 200 milliards de dollars, l’Algérie n’aura un taux de croissance que de 2,1 % en 2009 et un peu plus de 3 % en 2010. Résultat, l’indice de développement humain (IDH) de l’Algérie se voit dégradé dans le rapport du PNUD d’octobre 2009 de la 100e place en 2008 à la 104e place en 2009. Ces prévisions remettent directement en cause les anticipations gouvernementales qui concernent la création de 3 millions d’emplois entre 2009 et 2013. La création de ces emplois nécessiterait en effet au minimum un taux de croissance de 6 à 7 % sur cinq ans, ce qui est, selon les évaluations du FMI dans les conditions actuelles, tout simplement « une impossibilité économique ».
Mohamed Chabane, article initialement paru chez notre partenaire Revue Averroès
[1] Certains observateurs de la scène politique algérienne ne soutiennent pas la thèse de la spontanéité des événements d’octobre 1988. Ils estiment que le discours de président Bendjedid prononcé au palais des Nations le 19 septembre 1988 a mis le feu au poudre.
[2] Harrâga est un terme qui est utilisé pour décrire les migrants clandestins qui prennent le large de la Méditerranée depuis les côtes Sud pour rejoindre les côtes européennes en utilisant des embarcations de fortune, des barques et des radeaux d’un autre temps. Signifiant « ceux qui brulent », le nom Harrâga leur a été attribué car ils brulent leurs papiers d’identité avant leur départ.
[3] Le temps de couverture d’importations est une mesure utilisée afin d’évaluer le montant des réserves de change d’un pays par rapport à ses besoins en importations.
[4] Qui constituent le réceptacle du différentiel entre le produit de la fiscalité pétrolière recouvré et le produit de la fiscalité pétrolière budgétisé.
[5] Société Nationale pour la Recherche, la Production, le Transport, la Transformation, et la Commercialisation des Hydrocarbures. La Sonatrach s’est développée comme grande compagnie nationale chargée de prospecter et de commercialiser le pétrole après la nationalisation du pétrole et du gaz algérien le 24 février 1971 suite à la « décolonisation pétrolifère » du Président Boumediene qui a créé durant ces années plus de soixante-dix sociétés nationales, bouleversant ainsi le tissu économique algérien.
[6] Cette aisance financière n’est certainement pas durable puisqu’elle est la conséquence de la volatilité des prix du pétrole. Les données statistiques indiquent que la baisse du prix du pétrole à 50 dollars en moyenne a causé une perte de près de 17 milliards de dollars entre le premier semestre 2008 et le premier semestre 2009.
[7] Tout événement qui ébranlera la demande internationale ou engendrera une faiblesse durable des prix du pétrole se traduirait par un fort amenuisement des gains à l’exportation et aura des conséquences graves sur l’économie, similaires à celles de 1986. La crise de 1986 avait donné l’occasion d’appréhender les inconvénients d’une politique économique axée sur la rente. Après l’écroulement des prix des hydrocarbures (chute de près de 40 % des prix du pétrole entre 1985 et 1986) dont la production constituait 28 % du PIB en 1984, 98 % des exportations totales, 43 % des ressources de l’État pour la même année, et face à la dépréciation du dollar américain, principale monnaie des transactions pétrolières, l’État algérien voit son malheur amplifié par l’avènement et la combinaison de plusieurs crises.
[8] Les incertitudes concernant l’évolution des prix du pétrole constituent un des facteurs du risque les plus élevés. La chute des prix du pétrole de l’été 2008 à décembre 2008 confirme sans ambigüité qu’une économie rentière est une économie à risque sans possibilité d’anticipation, privée de conjectures sûres. Les prévisions des prix des hydrocarbures se basent sur un marché irrationnel, à une très forte volatilité et une instabilité même à court terme. Les cours pour le moyen et le long terme sont encore plus difficiles à déterminer. Les pressions spéculatives, les déséquilibres régionaux de l’offre, les tensions géopolitiques et l’incertitude résultant de l’instabilité politique au Moyen-Orient ainsi que les possibilités de rupture des approvisionnements dans d’autres pays producteurs, ajoutent à l’instabilité du prix du pétrole une autre particularité à risque.
[9] Dans un contexte économique et politique difficile, l’Algérie a fait le choix de son modèle de développement, en voulant éviter les pièges des autres politiques de développement dans les pays du tiers monde, récemment indépendants. Le modèle de développement suivi s’est caractérisé par une forte planification centralisée de type soviétique. La stratégie algérienne de développement basée essentiellement sur l’industrialisation, avait choisi en effet, de privilégier l’industrie lourde au prix de colossaux investissements matériels, supposés entraîner l’industrie légère en aval. C’est le cœur de la théorie des « industries industrialisantes ».
[10] Complexe par l’absence d’une politique clairement énoncée et problématique par la présence d’une situation où les forces qui façonnent habituellement le marché ont des stratégies, des comportements et des pratiques qui entraînent une situation délétère rendant délicat l’accès au foncier.
[11] Gérard Destanne de Bernis (un des principaux conseillers économiques de Président Houari Boumediene), qui s’est inspiré des idées de la théorie des pôles de croissance, des industries motrices et des effets d’entraînement de François Perroux, définit les industries industrialisantes comme suit : « Ce groupe d’industries dont la fonction économique fondamentale est d’entrainer dans son environnement localisé et daté un noircissement systématique ou une modification structurelle de la matrice inter-industrielle et des transformations des fonctions de production, grâce à la mise à la disposition de l’entière économie d’ensembles de nouvelles machines qui accroissent la productivité de l’un des facteurs ou la productivité globale et, en tout cas, un accroissement de la maîtrise de l’homme sur sa production et son produit. Ces transformations induisent, à leur tour, une restructuration économique et sociale et une transformation des fonctions de comportement dans l’ensemble considéré, la rénovation des structures sociales constituant à la fois et tour à tour une condition et une conséquence du processus d’industrialisation. » (Destanne de Bernis G., Les industries industrialisantes et les options algériennes, in Tiers-Monde, 1971, tome 12 n°47, p. 547).
[12] Le financement du PCSC, qui vise l’amélioration des conditions de vie des citoyens (45,4 %), le développement des infrastructures de base (40,5 %), l’appui au développement économique (8,0 %), la modernisation des services publics (4,9 %) et le développement des nouvelles technologies de communication (1,2 %), est évalué à près de 155 milliards de dollars sur la période allant de 2005 à 2009. Ainsi, le coefficient d’investissement public supérieur à 10 % du PIB, prévu dans le cadre du PCSC, classait l’Algérie parmi les pays où le niveau d’investissement est le plus élevé au monde. Selon la Banque mondiale, ce taux est particulièrement haut par rapport à la moyenne dans les pays de l’OCDE de moins de 4 % du PIB, moins de 5 % en Amérique latine, et moins de 8 % dans les pays asiatiques.
 Ici un contrat obscur et ses acronymes barbares, là des comptes offshores et leurs circuits financiers opaques… Il faut une sacrée dose de patience et de ténacité pour percer les mystères de l’argent du pétrole au Congo-Brazzaville, ce que tentent de faire depuis des années Brice Mackosso et Christian Mounzeo. Les deux hommes coordonnent la plateforme “Publiez ce que vous payez” dans ce petit pays d’Afrique centrale. Leur mot d’ordre est aussi simple que la tâche compliquée: exiger la transparence sur les revenus tirés du pétrole, la principale ressource du Congo qui représente 90% de ses exportations et plus de 75% de ses recettes publiques.
Ici un contrat obscur et ses acronymes barbares, là des comptes offshores et leurs circuits financiers opaques… Il faut une sacrée dose de patience et de ténacité pour percer les mystères de l’argent du pétrole au Congo-Brazzaville, ce que tentent de faire depuis des années Brice Mackosso et Christian Mounzeo. Les deux hommes coordonnent la plateforme “Publiez ce que vous payez” dans ce petit pays d’Afrique centrale. Leur mot d’ordre est aussi simple que la tâche compliquée: exiger la transparence sur les revenus tirés du pétrole, la principale ressource du Congo qui représente 90% de ses exportations et plus de 75% de ses recettes publiques.


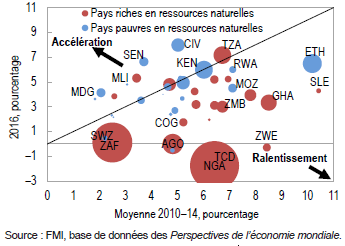
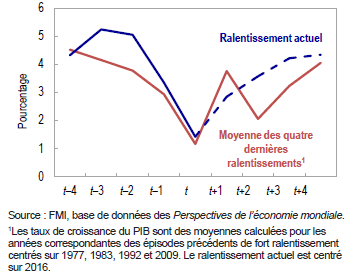

 Un fort taux de chômage et un fort taux d’inflation
Un fort taux de chômage et un fort taux d’inflation
 Cela entraîne, selon ladite théorie, un effet de dépense qui se manifeste sur le marché des biens et le marché des facteurs. Depuis l’indépendance et jusqu’aujourd’hui, la rente continuede financer l’économie algérienne. De 2009 à 2014, le pays envisage de dépenser un montant de 280 milliards de dollars dans sa stratégie de développement nationale. Alors que les conditions nécessaires pour un développement économique conséquent et durable ne sont pas satisfaites, le pays risque de se retrouver confronté aux mêmes défis et inquiétudes que par le passé. Les fondamentaux de développement économique en Algérie sont absents :
Cela entraîne, selon ladite théorie, un effet de dépense qui se manifeste sur le marché des biens et le marché des facteurs. Depuis l’indépendance et jusqu’aujourd’hui, la rente continuede financer l’économie algérienne. De 2009 à 2014, le pays envisage de dépenser un montant de 280 milliards de dollars dans sa stratégie de développement nationale. Alors que les conditions nécessaires pour un développement économique conséquent et durable ne sont pas satisfaites, le pays risque de se retrouver confronté aux mêmes défis et inquiétudes que par le passé. Les fondamentaux de développement économique en Algérie sont absents : Les dernières années ont été plutôt fastes pour l'Algérie qui a connu des évolutions favorables pour ses principaux équilibres macro-économiques et financiers. En 2008, le produit intérieur brut (PIB) en volume a connu un taux de croissance de 2,4 %. Sa valeur (en terme nominal) est passée de 135,3 milliards de dollars à plus de 162,9 milliards de dollars, aboutissant à un PIB par habitant de près de 4 681 dollars par an. Avec près de 80 milliards de dollars d’exportations, l’Algérie a réalisé un excédent commercial de 39,983 milliards de dollars, contre 32,898 milliards de dollars en 2007, soit une augmentation de 21,53 % de la balance commerciale et de 30,48 % des exportations en valeur. Les réserves de change qui avaient franchi la barre des 110 milliards de dollars en 2007 (110,2 milliards en fin d’année) s’établissaient fin 2008 à 143,1 milliards de dollars, soit une augmentation de près d’un tiers (29,85 %) par rapport aux douze derniers mois. L’évolution des réserves de change à ce rythme représente une couverture d’importations de plus de deux ans et demi après avoir été d’un an et demi seulement en 2003, comme nous pouvons le constater dans le tableau (1).
Les dernières années ont été plutôt fastes pour l'Algérie qui a connu des évolutions favorables pour ses principaux équilibres macro-économiques et financiers. En 2008, le produit intérieur brut (PIB) en volume a connu un taux de croissance de 2,4 %. Sa valeur (en terme nominal) est passée de 135,3 milliards de dollars à plus de 162,9 milliards de dollars, aboutissant à un PIB par habitant de près de 4 681 dollars par an. Avec près de 80 milliards de dollars d’exportations, l’Algérie a réalisé un excédent commercial de 39,983 milliards de dollars, contre 32,898 milliards de dollars en 2007, soit une augmentation de 21,53 % de la balance commerciale et de 30,48 % des exportations en valeur. Les réserves de change qui avaient franchi la barre des 110 milliards de dollars en 2007 (110,2 milliards en fin d’année) s’établissaient fin 2008 à 143,1 milliards de dollars, soit une augmentation de près d’un tiers (29,85 %) par rapport aux douze derniers mois. L’évolution des réserves de change à ce rythme représente une couverture d’importations de plus de deux ans et demi après avoir été d’un an et demi seulement en 2003, comme nous pouvons le constater dans le tableau (1). La production primaire d’hydrocarbures pour l’année 2007 s’est élevée à 233,3 millions de tonnes équivalent pétrole (TEP). Le bilan par produits fait ressortir des productions de 63,8 millions de tonnes de pétrole brut, 152,8 milliards de m³ de gaz naturel, 13,7 millions de tonnes de condensat, 8,6 millions de tonnes de gaz du pétrole liquéfié (GPL) et 40 millions de m³ de gaz naturel liquéfié (GNL), d’après les statistiques de la Sonatrach
La production primaire d’hydrocarbures pour l’année 2007 s’est élevée à 233,3 millions de tonnes équivalent pétrole (TEP). Le bilan par produits fait ressortir des productions de 63,8 millions de tonnes de pétrole brut, 152,8 milliards de m³ de gaz naturel, 13,7 millions de tonnes de condensat, 8,6 millions de tonnes de gaz du pétrole liquéfié (GPL) et 40 millions de m³ de gaz naturel liquéfié (GNL), d’après les statistiques de la Sonatrach