
"Ce dont une femme a besoin, c'est d'une chambre à soi, et d'un peu d'argent", disait Virginia Woolf. En attendant la chambre, les femmes Comoriennes s'attaquent depuis longtemps aux fondements mêmes leur société, à travers l'art notamment, et parfois sans avoir conscience de leur impact sur les tabous qui les encerclent. Peut-être grâce au droit de cité que leur cède, bon an mal an, la structure matrilinéaire de leur société, elles posent les problématiques propres au pays : Education des enfants, condition féminine, vivre-ensemble dans un pays morcelé. Echo de ces voix qui s'expriment principalement par la musique, le cinéma et, plus récemment, la littérature.
Bora : Le chant-transmission
Comme un secret murmuré a l'oreille, le bora dévoile plus que ne le laisse soupçonner son.rythme entrainant. Le refrain de cette litanie poétique populaire, fréquente dans les mariages et les cérémonies, se chante en chœur et accompagne une soliste qui, la plupart du temps, se sert des confidences quelle fait dans ses couplets pour sonder la société dans laquelle elle vit. Ainsi, dans ulindo mgu, on retrouve la problématique du mariage arrangé et de la déchéance programmée de la femme en tant que sujet de la société : mariée jeune, mère (trop) tôt, puis affublée par son époux d'une coépouse ou d'une maîtresse plus jeune, car flétrie avant l'âge. Le chant deplore la situation de cet être Éternellement défini selon une autre personne et jamais selon ce qu’il est. Debe, un autre chant, prend le parti de triompher de la vie malgré tout et de célébrer l' éternité dans l éphémère de la beauté féminine. Ce faisant, le chant érige la femme, perdante dans de nombreuses batailles, en gagnante de la guerre, car il lui reste finalement les mots et leur poésie :
" C'est le destin qui m' a donné cet homme, ô Tarora ; mais il n' a pas mon coeur
Et quand je me drape de mon hami, que je l' attache à ma hanche pour en faire un pli
Quiconque me voit ne baisse point les yeux, mais me fait du sourcil ! "
Côté nouvelle génération, on connaît surtout Imany et sa voix atypique. Avant elle, les deux voix engagées du pays, Chamsia Sagaf et Zainaba Ahmed, ont assuré une transition entre les complaintes formulées a demi voix dans les bora et l'entrée dans la musique contemporaine. Leurs chansons a messages démontrent une prise de position plus ferme dans tous les apsects qui touchent à la sociét, comorienne. Tantot Controversées, tantôt louangées, Zainana Ahmes, « la voix d’or », et Chamsia Sagaf, sa congénère, ont exhorté la femme d' aujourd'hui à sortir de son mutisme, à "rompre ses chaînes", à "se prendre en charge sans tarder" et à participer activement à l'avenir de l'humanité comme égale de l'homme. Aujourd'hui, les voix de Nawal et Mame, pour ne citer que celles-là, font entendre l’héritage spirituel soufi de l’archipel, et continuent de percer la coquille.
L'identité et la maternité au cinéma
Le cinéma comorien est encore tout jeune, mais ce qu'il a de surprenant, c'est que les femmes en sont les pionnières. Dans une communauté réputée pour surprotéger ses femmes, la matrilinéarité, en faisant de la femme la gardienne des traditions, semble évoluer avec son temps et pousser, malgré les tabous sociaux, des femmes à libérer leur parole. Ces trois dernières années, deux des héritières de cette parole se sont distinguées par leurs productions : Sania Chanfi, réalisatrice d'Omnimum, et Hachimiya Ahamada, réalisatrice de L'ivresse d'une oasis. Les sujets abordés sont loin du plaidoyer pour le droit des femmes, et s'attaquent directement à des questionnements profondément universels. L'ivresse d'une oasis, deuxième œuvre de Hachimiya Ahamada, suit la réalisatrice dans son parcours à travers un pays-archipel morcelé par la mer, dont les habitants se ressemblent bien plus qu'ils ne se connaissent entre eux. Omnimum traite, avec transparence et délicatesse, des méandres de la monoparentalité, situation d'extrême solitude dans une communauté où le mariage est une institution sacrée.
Littérature : Le corps censuré
Taboue dès la puberté, destinée au mariage et a la maternité, car "femme avant tout" : Le corps de la femme comorienne serait il un prêt, dont elle ne peut se servir que comme support de sa tête en attendant que les propriétaires le récupèrent ? C'est en tout cas le message qui ressort dans les discussions féminines, et gare à celle qui oserait affirmer un peu trop fort son droit de propriété sur son propre corps. Faiza Soulé Youssouf, auteure du roman Ghizza, (éditions Coelacanthe 2015, 12e), en a fait les frais : La présence d"une scène érotique dans son ouvrage, où il est question d'une jeune fille qui tente de reprendre le contrôle de son corps confisqué par la société, a soulevé le débat sur les réseaux sociaux. Une polémique qui dessine, à n'en pas douter, les contours du prochain grand thème artistique comorien : L'appropriation par la femme de son propre corps. A l’instar de Woolf, de Simone de Beauvoir ou de Sylvia Plath, on peut compter sur les intéressées pour s'emparer de la question, avec ou sans une chambre à soi.
Touhfat Mouhtare-Mahamadou


 Dakar a célébré, dans une ambiance festive, la première édition de la Journée Internationale du Jazz, mardi 30 avril 2013.
Dakar a célébré, dans une ambiance festive, la première édition de la Journée Internationale du Jazz, mardi 30 avril 2013. 

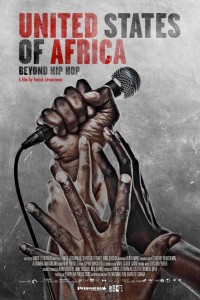

 C’était du vin chaud un soir de décembre. Des notes abordées comme les élisions d’une faena, avec souplesse et vivacité. Un bout de pied calleux et obstiné. Un petit pays mélancolique et bravache. Des galets immuables, polis et insolents. Une mer inachevée. Une espèce de ciel d’orage. C’était la voix de Cesária Évora. Elle ne s’élèvera plus.
C’était du vin chaud un soir de décembre. Des notes abordées comme les élisions d’une faena, avec souplesse et vivacité. Un bout de pied calleux et obstiné. Un petit pays mélancolique et bravache. Des galets immuables, polis et insolents. Une mer inachevée. Une espèce de ciel d’orage. C’était la voix de Cesária Évora. Elle ne s’élèvera plus. Cesária Évora est morte, hier soir. Son cœur s’est arrêté. Le mien aussi.
Cesária Évora est morte, hier soir. Son cœur s’est arrêté. Le mien aussi.