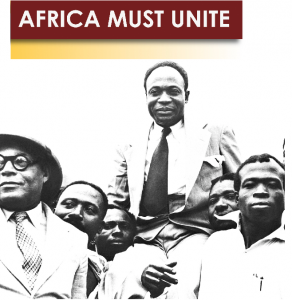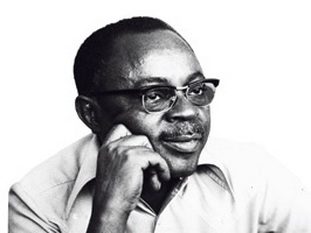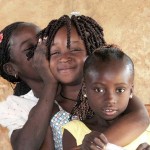« Comment aller plus loin que Mandela sans devenir Mugabe ? » La réponse à cette interrogation de Slavoj Zizek est, pour moi, fondamentale dans la construction d’une Afrique nouvelle.
« Comment aller plus loin que Mandela sans devenir Mugabe ? » La réponse à cette interrogation de Slavoj Zizek est, pour moi, fondamentale dans la construction d’une Afrique nouvelle.
Comment sortir de cette quête d’icônes qui fait que, pour certains d’entre nous, un président, parce qu’il aura rendu des terres aux paysans de son pays, ait le droit de rester au pouvoir à 90 ans révolus, avec un bilan économique peu enviable ? Comment renforcer les institutions étatiques, la cohésion nationale, le vivre ensemble comme l’a fait Mandela, tout en reprenant les leviers de nos économies extraverties aux groupes compradors ignorants du patriotisme économique ou à ceux dont le patriotisme va à d’autres Etats que ceux dans lesquels ils prospèrent ?
Comment remettre la souveraineté politique, économique, culturelle de nos Etats au centre des débats nationaux et par delà du débat continental sans tomber dans de dangereux nationalismes avec leurs lots d’exclusion et de stigmatisation ? Comment libérer les leviers de production, les donner en priorité au peuple réel, celui qui cultive la terre, creuse la mine, défie la mer, trait la vache, sans tomber dans le culte de la personnalité ? Comment en finir avec l’attente des messies et la tradition des hyper présidents tout en stimulant le sens commun vers un but de libération de toutes les entraves à l’épanouissement de l’homme ? Comment ne plus se contenter de démocraties électorales ; faire en sorte que le curseur de la nation qui avance ne soit plus seulement placé au dessus de la case « organisation d’élections transparentes » mais déplacé vers « acquisition d’une réelle indépendance économique et culturelle » ? Comment faire recouvrer toutes leurs souverainetés aux anciens pays colonisés tout en réussissant à vaincre les démons de la division interne dont souvent les ficelles sont tirées depuis cet ailleurs où se retrouve la souveraineté usurpée et à reconquérir ?
Comment faire pour que, face aux conformistes de tous ordres qui ont fini de faire un maillage efficace du système, les véritables patriotes désintéressés, ceux qui veulent sincèrement changer les mentalités et transformer le quotidien de leurs compatriotes en partant des dynamiques internes, aient leur mot à dire et la possibilité de montrer leur savoir faire ; pour qu’ils ne soient pas disqualifiés par une démocratie des oligarques où l’argent et les accointances avec des groupes de pressions fixent les règles ? Comment discipliner des peuples, les mettre au travail sans succomber à l’appel de la tyrannie? Comment avoir l’éclairé sans le despote, le visionnaire au leadership transformateur sans le monarque à l’ego surdimensionné ? Comment avoir le chef intransigeant sur les questions de souveraineté sans le démagogue qui, de manière intempestive, évoque l’autre pour masquer ses propres limites devant ceux qui l’ont porté au pouvoir ?
Comment donner le pouvoir au peuple, celui des champs et des usines sans qu’il se retrouve dans la rue où le premier démagogue venu aura tout le loisir de le ramasser ?
Une génération d’africains, intellectuels, activistes, entrepreneurs, est entrain de répondre à ces questions. Elle sait que 80% des terres arables de la planète se trouvent sur le continent, qu’à l’horizon 2050 la plus grande population en âge de travailler et d’être productive se trouvera en Afrique. La prochaine usine du monde dit-on. Oui mais à condition, pour que cet optimisme fasse sens, que les leviers et capacités de production soient tenus par des entrepreneurs locaux dans un système où mérite ferait loi.
Ma conviction est qu’il faudra un jour pas très lointain en finir avec les « taxistes » et les « sous-employistes ». Les premiers se glorifient d’une croissance économique sans impact social dans leurs pays car tirée par des entreprises étrangères. Ils se contenteront des taxes versées par ces firmes, portion congrue comparée aux sommes rapatriées dans les pays d’origine surtout en zone CFA où la possibilité de rapatrier des bénéfices est illimitée contrairement à d’autres aires monétaires où cette pratique est plafonnée.
Les seconds cèdent facilement au chantage à l’emploi. Les entreprises bien installées, ceux qui sont là depuis la colonisation comme ceux qui viennent d’arriver, des françaises aux chinoises, créent des emplois disent-ils. Cela suffit à leur bonheur et à leur détermination à maintenir le statu quo. Que ces emplois dont on parle soient, dans la grande majorité des pays africains, une goutte d’eau dans l’océan du chômage n’y fait rien.
Ces deux spécimens qu’on pourrait qualifier d’ « intellectuels compradors » qui sont les garants d’intérêts autres que ceux de leurs pays et se satisfont du monde tel qu’il est, consentant à peine à quelques ajustements mais toujours dans le même cadre prédéfini, sont malheureusement nombreux à des postes de responsabilités dans les pays africains. Leurs convergences d’intérêts avec des milieux d’affaires mus seulement par la recherche du profit à moindre coût d’investissement ne pourraient conduire à des avancées sociales.
Il faudra trouver les voies et moyens de donner plus de place dans le débat public à ceux qui déconstruisent les options prises depuis prés de 60 ans par la plupart des pays africains, souvent avec le duo de Bretton Woods comme muse, et qui n’ont pas donné de résultats à la hauteur de la demande sociale et de la poussée démographique. Cette ouverture doit aller de l’économiste qui travaille à l’élaboration d’indicateurs autres que le PIB et l’IDH pour mesurer la productivité des agents économiques ou le caractère inclusif de la croissance au philosophe qui appelle à l’introduction des langues locales dans l’enseignement pour une meilleure appropriation des concepts et une démocratisation du savoir.
Le refus salutaire des modèles importés faisant son bonhomme de chemin, il faudra, au plan interne, en finir avec les lobbys obscurantistes qui trouvent explications à toutes les forfaitures. Des pratiques du fonctionnaire subitement milliardaire qui passe pour généreux parce que partageant son butin avec des groupes de pression et leaders d’opinion à celle consistant à faire mendier des enfants par milliers dans les rues de nos villes sous prétexte d’apprentissage d’une religion, en passant par les oppositions à la mise à niveau du statut de la femme avec celui de l’homme ; oppositions nourries par des conservatismes révolus.
Il y a un passage entre la nuit noire et le soleil éclatant. Il y a ceux qui ont dormi à poings fermés, qui se sont complus de leur journée d’hier et n’attendent pas de bouleversements dans celle qui s’annonce. Mais il y a aussi ceux qui ont rêvé de jours heureux et qui se disent que ce rêve est atteignable ; qu’une Afrique qui compterait sur ses forces et dynamiques propres et avancerait à son rythme en assurant un bien-être certain à ses enfants n’est pas qu’utopie.
La réalité de ce rêve commence par le fait de penser par soi même et de refuser les satisfécits décernés par d’autres au motif d’une croissance qui serait bonne alors que le chômage explose, des femmes meurent dans presque tous les pays d’Afrique en donnant la vie faute de structures de santé à proximité, que des enfants étudient dans des abris provisoires, que l’avancée de la mer engloutit des villages entiers, que des hommes et femmes doivent marcher des dizaines de kms pour trouver de l’eau, que sont érigés en règles les emplois précaires et la corruption, que les passe-droits dans tous les secteurs de la vie active ont la peau dure…Bref que la croissance « bonne » chantée à l’unisson par certaines institutions et tous les gouvernements s’avère inutile à l’épreuve des faits et du vécu des populations.
Ce passage entre la nuit noire et le soleil éclatant est le temps actuel de l’Afrique. Un continent qui se réveille mais qui en est aux premières lueurs d’un jour nouveau devant la conduire à prendre son destin en main par le courage de ses élites et la libération de ses masses laborieuses.
Racine A. Demba