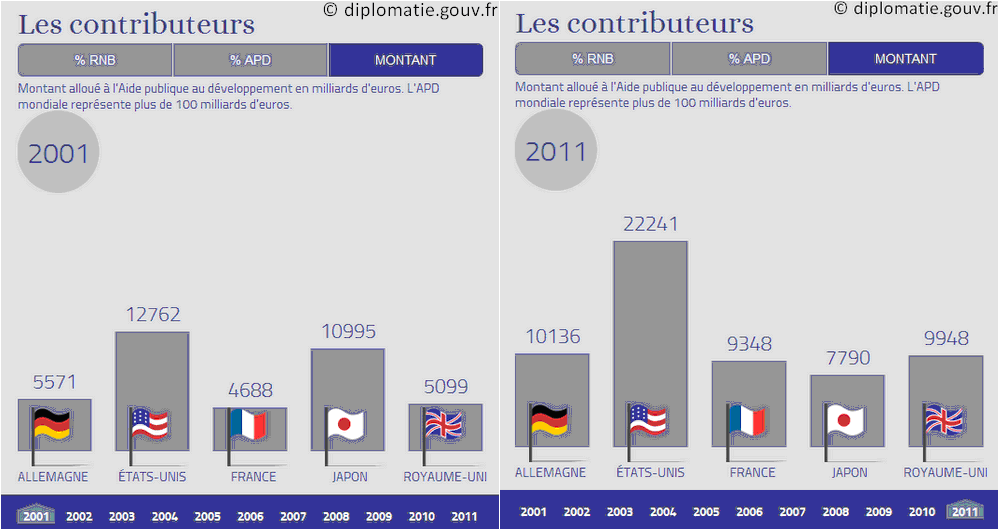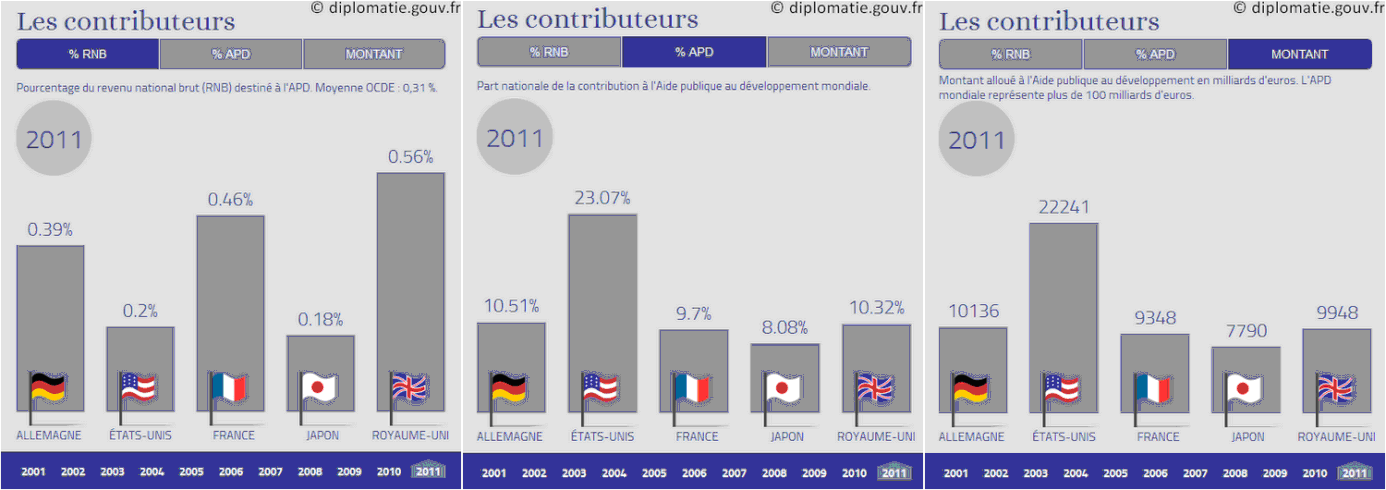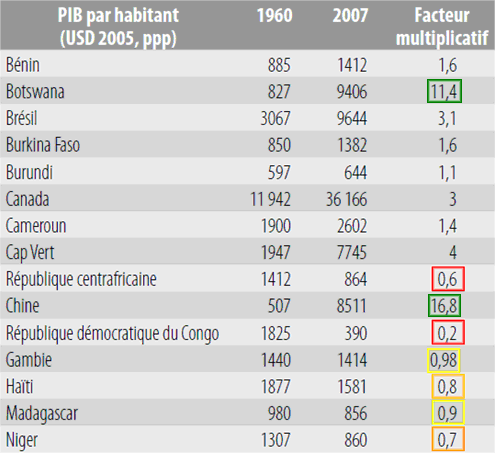Plus de vingt ans après la fin de l’Apartheid et l’élection de Nelson Mandela, l’Afrique du Sud demeure marquée par les stigmates de la ségrégation et des discriminations raciales. La deuxième économie d’Afrique en termes de PIB (1) est aujourd’hui également « la société la plus inégalitaire du monde » selon l’expression de l’économiste sud-africain Haroon Bhorat, et présente un coefficient de Gini de 0,69 (2).
Plus de vingt ans après la fin de l’Apartheid et l’élection de Nelson Mandela, l’Afrique du Sud demeure marquée par les stigmates de la ségrégation et des discriminations raciales. La deuxième économie d’Afrique en termes de PIB (1) est aujourd’hui également « la société la plus inégalitaire du monde » selon l’expression de l’économiste sud-africain Haroon Bhorat, et présente un coefficient de Gini de 0,69 (2).
Dès 1994 des politiques volontaristes visant à réduire les inégalités ont été mises en place et l’Afrique du Sud a enregistré un taux de croissance permettant de faire reculer la pauvreté (3). Toutefois, les fruits de la croissance n’ont pas permis de modifier la structure des revenus et de réduire les inégalités entre noirs et blancs.
Si l’analyse économique des inégalités retient rarement le critère ethnique comme variable d’étude il convient compte-tenu de l’histoire de l’Afrique du Sud et de son passé ségrégationniste, d’évaluer la faiblesse des capabilités (4) dont dispose la population noire de ce pays pour rendre compte des discriminations structurelles qu’elle continue à subir de nos jours.
- Vingt ans après la fin de l’apartheid, les inégalités demeurent et menacent le développement économique du pays
- Inégalité de salaire, de patrimoine et de capital humain
Un rapport publié en 2015 par l’Institut national des statistiques sud-africain (5) rendait compte de l’inquiétante persistance des inégalités de revenu en Afrique du Sud. En effet, ce document révèle qu’avec en moyenne 6444 dollars par an les foyers noirs disposent toutes choses égales par ailleurs, d’un revenu moyen cinq fois inférieur à celui des foyers blancs qui plafonne à 30 800 dollars annuel.
Par ailleurs ces inégalités salariales sont amplifiées par les inégalités de patrimoines. En effet l’accès à la propriété foncière a longtemps été interdit aux populations noires reléguées en périphérie du Cap et de Johannesburg les ghettos lors de l’Apartheid.
Enfin, le système scolaire sud-africain est extrêmement polarisé. L’enseignement public et gratuit de ce pays compte parmi les plus défaillants du monde. Une enquête menée par le Boston Consulting Group montrait ainsi en 2015 que la majorité des enseignants ne disposaient pas du niveau requis en mathématique (6) ! Or les enfants issus des familles les moins aisées sont les principaux élèves des écoles publiques. Ils ne bénéficient donc pas d’une éducation de qualité comparable à celle dispensée dans les écoles privées plus coûteuses. Dès lors d’après la théorie du « signal » élaborée par Spence, pour un même nombre d’années d’études un lycéen ayant effectué toute sa scolarité dans un établissement sud-africain public et un lycéen ayant exclusivement fréquenté un établissement privé n’enverront pas le même signal à un potentiel employeur.
- Les tensions ethniques et sociales freinent le développement économique
Minée par les inégalités, l’Afrique du Sud est régulièrement en proie à des crises sociales majeures. En août 2012 les grèves parties de la mine de platine de Marikana ont causé la mort de trente-quatre manifestants et se sont propagées vers d’autres secteurs industriels tels que l’or, le minerai de fer, le charbon et le chrome. Les pertes engendrées par ces échauffourées ont été estimées à plus d’un milliard de dollars tandis que le taux de croissance de l’économie sud-africaine a diminué de 0,9% lors du deuxième trimestre de l’année 2013. (7)
Outre ces affrontements marxistes et traditionnels liés au rapport de force à l’œuvre entre les détenteurs des moyens de production et les travailleurs, on observe également une augmentation des risques liés au sous-emploi. En 1993 C. Juhn révélait dans une étude l’existence d’une corrélation entre l’inégalité des salaires aux Etats-Unis et la recrudescence de la délinquance. En effet, à partir des années 1970, les populations noires américaines ont connu une massive sortie de la population active qui est allée de paire avec une nette augmentation de la population carcérale. Dans le cas sud-africain, le sous-emploi des travailleurs noirs les moins qualifiés a notamment été causé par les rigidités sur le marché de l’emploi (8).
Les structures syndicales héritées de l’apartheid sont restées très prégnantes et ont continué à influer sur le marché du travail sud-africain. Ainsi, l’instauration d’un salaire minimum trop élevé s’est faite au détriment des travailleurs les moins qualifiés qui n’ont pas pu profiter de la croissance économique et se sont massivement tournés vers les activités illégales ou informelles. Dans une enquête publiée en 2013 et intitulée “Job destruction in the South African clothing industry: How an unholy alliance of organised labour, the state and some firms is undermining labour-intensive growth”, Nicoli Nattrass et Jeremy Seekings témoignent des effets néfastes de l’action syndicale sur l’emploi dans les secteurs à faible intensité capitalistique comme l’industrie textile.
- De la redistribution à l’amélioration des « capabilités »
- Les tentatives de solution
Depuis la fin de l’apartheid, le gouvernement sud-africain n’a eu de cesse de développer des programmes de subvention et de redistribution fiscale. Toutefois ces solutions agissent en aval sur les conséquences de l’inégalité en capital humain mais ne permettent pas en amont d’accroître les capabilités des populations les plus démunies.
Pour l’heure le gouvernement sud-africain a préféré les solutions visant à corriger les effets des inégalités plutôt que d’engager des réformes touchant aux causes structurelles et historiques de ces inégalités.
- Recommandations : lutte contre les discriminations, politique de formation et mixité urbaine
La lutte contre les discriminations sur le marché du travail doit faire l’objet d’une politique publique afin de réduire les inégalités. Dans une enquête sur les inégalités économiques aux Etats-Unis, Phelps et Arrow analysent les discriminations en vigueur contre les noirs dans les années 1970. Les deux économistes ont ainsi montré que du fait des préjugés raciaux ancrés lors de l’époque ségrégationniste, les employeurs anticipent que certains groupes ont objectivement moins de chances que les autres d’être productifs. Les anticipations des employeurs et les comportements engendrés par ces anticipations peuvent conduire à une persistance des inégalités de capital humain. En transposant cette analyse à l’Afrique du Sud post-ségrégationniste on comprend dès lors que la réduction des inégalités passera par une lutte active contre les discriminations à l’embauche notamment grâce à des campagnes de sensibilisation, à l’instauration de missions de testing, et à la prise de sanctions exemplaires contre les employeurs se rendant coupables de discrimination.
Par ailleurs, une politique de formation volontariste permettra d’unifier le système scolaire sud-africain et de le rendre plus égalitaire. La théorie du signal de Spence, affirme que les employeurs attendent des informations précises sur la qualité du diplôme et non pas seulement sur le nombre d’années d’étude. Dès lors l’octroi de subvention aux écoles publiques et une meilleure formation des personnels enseignant dans ces établissements permettra de réduire significativement les écarts en termes de capital humain et d’accès au marché de l’emploi.
Une refonte de l’enseignement public ne saurait se passer d’une politique urbaine audacieuse. En effet, le rapport Coleman publié en 1966 par l’administration américaine faisait état d’un échec des politiques publiques visant à augmenter les moyens des écoles des quartiers défavorisés, ainsi que d’une insertion médiocre sur le marché du travail. Plusieurs commentateurs du rapport ont rappelé que les résultats médiocres ne sont pas seulement imputables au fait que le milieu social détermine la réussite scolaire mais aussi à la composition des classes (peu d’émulation entre les élèves…). Le quartier d’habitation influe sur la réussite scolaire. Les externalités locales, au niveau micro-économique de la salle de classe, ont un effet global sur la dynamique des inégalités. Dans ces conditions, l’instauration d’une carte scolaire apparaît comme une solution pour favoriser la mixité sociale et ethnique tout en réglant le problème de la ségrégation urbaine qui sévit toujours en Afrique du Sud et est un vestige du régime de l’apartheid.
Daphnée Setondji
Sources
- http://afrique.lepoint.fr/economie/ou-va-l-afrique-du-sud-19-08-2014-1857787_2258.php
- Haroon Bhorat, Fighting poverty: Labour markets and inequality in South Africa, 2001.
- http://www.rfi.fr/afrique/20170128-afrique-sud-inegalites-salaires-statitstiques-blancs-noirs-foyers-pauvres
- Eric Monnet, La théorie des « capabilités » d’Amartya Sen face au problème du relativisme
- http://www.latribune.fr/economie/international/l-afrique-du-sud-champion-des-inegalites-de-revenus-478113.html
- http://www.agenceecofin.com/gestion-publique/2605-29246-lafrique-du-sud-occupe-le-2eme-rang-mondial-dans-le-domaine-des-inegalites-de-revenus
- http://www.slate.fr/story/80853/retombees-apartheid
- C. Juhn “Wage Inequality and the Rise in Returns to Skill”, 1993


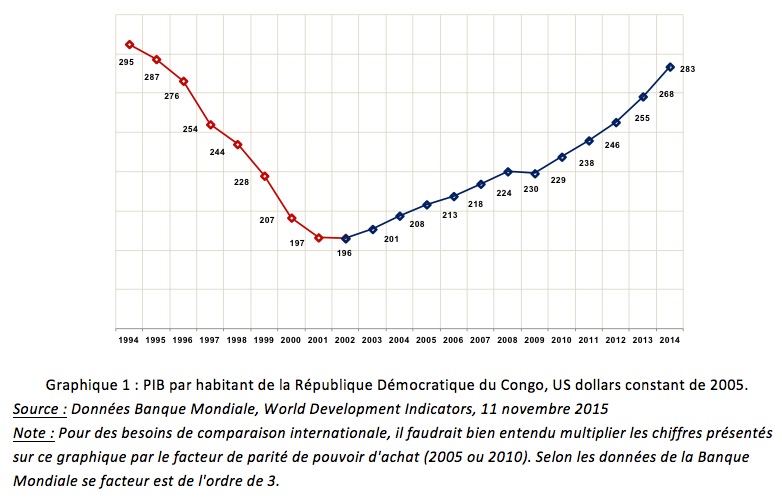
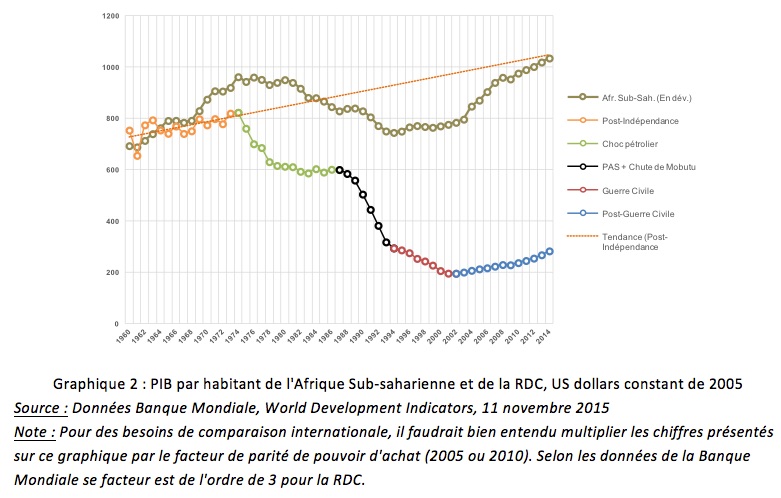
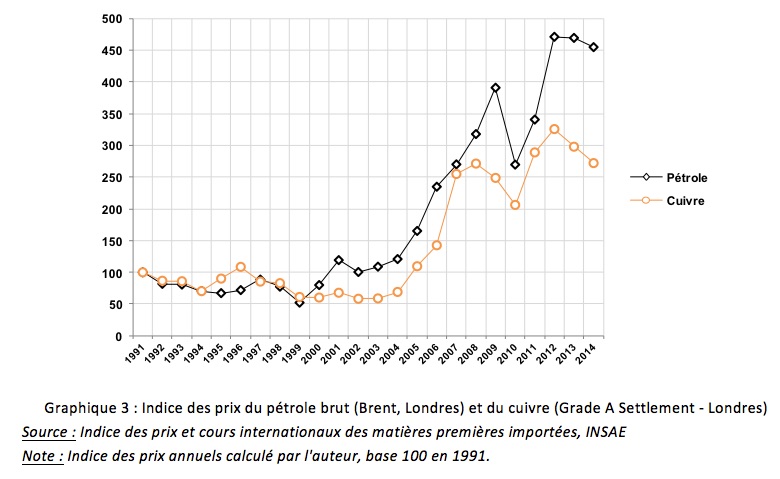






 Selon l’Organisation internationale du travail (OIT), est considéré comme travail des enfants, les travaux effectués par des filles et des garçons en deçà de l'âge minimum requis pour les exercer.
Selon l’Organisation internationale du travail (OIT), est considéré comme travail des enfants, les travaux effectués par des filles et des garçons en deçà de l'âge minimum requis pour les exercer.
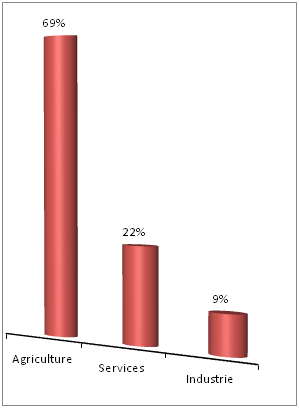

 «
«