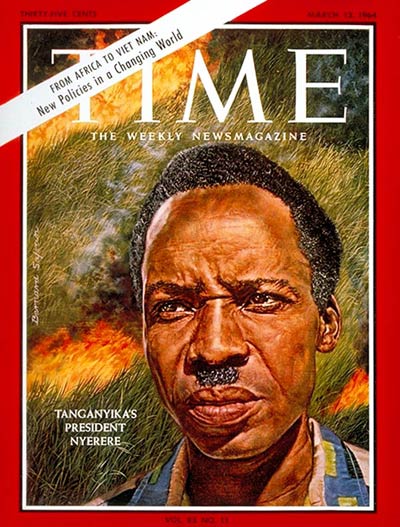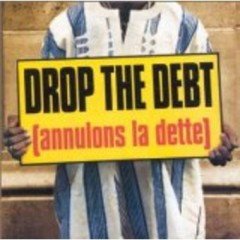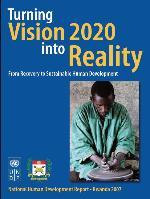Entretien avec Marwa Belghazi, activiste féministe au Maroc.
Entretien avec Marwa Belghazi, activiste féministe au Maroc.
Bonjour Marwa. Peux-tu nous décrire les principaux enjeux qui se posent aujourd'hui dans les sociétés nord-africaines pour l'épanouissement social des femmes ?
Il reste encore beaucoup de choses à faire dans le domaine des droits des femmes en Afrique du Nord, en termes d'accès égal au marché de l'emploi, à l'éducation et à la santé, d'amélioration des conditions de vie et notamment dans le milieu rural, ainsi que de leur protection contre tous types de violences. Mais quand l'on en vient à parler de l'épanouissement des femmes en Afrique du Nord, il y a un sujet qu'on évoque très peu ou pas suffisamment à mon sens: Il concerne l'épanouissement de la femme dans son sens le plus simple, le ressenti d'un bien être au niveau de son corps et de son esprit.
Or, incontestablement, il y a dans nos sociétés nord-africaines une pression sociale sur le corps masculin et féminin, la pression sur le corps féminin étant toutefois plus visible et plus violente. Concrètement, cette pression s'exerce lorsqu'on en vient à aborder le droit de disposer librement de son corps. La virginité continue à symboliser l'honneur non seulement de la fille mais de toute sa famille, qui se sent donc investie d'un droit de regard et de contrôle sur le corps féminin. Au Maroc, il existe encore un article du code pénal qui punit les rapports sexuels entre deux personnes non mariées d'un mois à un an d'emprisonnement, contraignant de ce fait tout citoyen non marié à la clandestinité.
Par ailleurs, on reste dans une conception phallocentrique de la loi, des lois écrites du point de vue masculin. Par exemple, l'article 486 du code pénal marocain définit le viol comme "l'acte par lequel un homme a des relations sexuelles avec une femme contre le gré de celle-ci". Cette définition de relations sexuelles non consenties se limite à la pénétration phallique du vagin de la femme. On ne conçoit donc pas que l'homme puisse être victime de viol ou que cela se fasse par une autre partie du corps ou objet autre que le pénis.
Enfin, on n'insiste pas assez sur la force destructrice et traumatisante du harcèlement sexuel au quotidien dans l'espace public, dans les lieux de travail, mais aussi à l'intérieur des familles. Cet harcèlement sexuel peut se transformer très vite en violence physique. On n'en parle pas suffisamment, et c'est peut être aussi une erreur des femmes de ne pas en parler, de « normaliser » la chose. Le corps féminin est constamment scruté et jugé, cela va du soi-disant compliment à l'insulte ou à l'attouchement. La pression sur le corps de la femme, je pense qu'elle est universelle. Mais les visages qu'elle prend sont différents suivant les sociétés. Par exemple, si les sociétés occidentales ont libéré le corps de la femme du joug de la tradition, c'est pour mieux retomber sous le contrôle d'une image marketing, d'un objectification qui impose pareillement un certain nombre de diktats.
A mon avis, on en est toujours à un conflit de définition de ce qu'est et ce que "doit" être la femme, la féminité, sa place dans la société, dans l'espace public, la liberté qu'elle peut avoir vis à vis de son corps. Et dans nos sociétés nord-africaines, nous essayons tant bien que mal d'avoir ces débats sans pour autant être traitées de traîtres à la nation, de mécréantes, voire très souvent de traînées.
Face à cette situation, comment s'organise la mobilisation des femmes sur ces questions ? Y a t'il un mouvement féministe organisé ? Si oui, en quoi se distingue t'il, à ton sens, d'autres mouvements qui se sont réclamés de ce terme par le passé ou dans d'autres régions du monde ?
Le début du mouvement féministe coïncide avec l'indépendance des pays d'Afrique du Nord. Ces mouvements d'indépendance se sont accompagnés de discours progressistes dont les porte-voix ont été ces personnes éduquées, occidentalisées, dont certaines se sont fait les étendards du féminisme. Mais de ce fait, les porte-voix de ce féminisme sont resté(e)s assimilé(e)s à une élite francophone issue des classes aisées. Leur discours arrive à être porté au niveau politique, avec une sorte de féminisme étatique, qui réussit à faire entendre ses doléances et à faire réformer la loi ; mais est-ce que ce discours arrive à pénétrer le reste de la société, et à changer les mentalités ? Est-ce que la réforme du code de la famille a changé les mentalités au Maroc ? Je n'en suis pas sûre.
Autre trait commun aux mouvements féministes en Afrique du Nord, la majorité de la population étant musulmane, les mouvements féministes ont généralement essayé de coopérer ou de ménager le religieux, en reconnaissant l'importance de l'islam. Les revendications sont restées dans un cadre musulman. Le discours, c'est de dire que les relations homme-femme sont plus dictées par la tradition que par la religion, cela afin de dédouaner la religion dans leurs attaques contre les pesanteurs de la société.
Je peux paraître critique vis-à-vis des ces premières générations de féministes, mais en même temps on ne peut pas nier l'importance de leur travail. Je suis le produit de leur héritage : si j'ai pu m'instruire, si j'ai la liberté d'expression, c'est grâce au travail de toutes ces militantes qui ont préparé le chemin. On a tendance, nous les jeunes générations, à oublier à quel point ce travail de militantisme qui nous a précédé a forgé le cadre dans lequel on vit. Par exemple, au Maroc, on leur doit la réforme du code de la famille, travail que poursuit le Collectif du printemps de la dignité, qui propose une révision globale des codes et des lois en vigueur au Maroc pour offrir aux femmes des garanties juridiques de leurs libertés individuelles et de l’égalité entre les sexes.
On sent aussi qu'il y a un renouveau de la mobilisation des femmes, qui a resurgit lors du Printemps arabe. Cette mobilisation n'a d'ailleurs pas été spécifiquement féministe au début, la femme s'engageant à l'égal de l'homme dans un militantisme pour l'émancipation politique de leur pays. Les revendications politiques étaient les mêmes, on ne sentaient pas le besoin de se distinguer, c'était une belle illusion de se dire qu'on se battait tous pour la même chose, pour des lois, pour une constitution instaurant un Etat de droit, en faisant abstraction de l'inégalité de fait qui subsiste entre hommes et femmes. Dans les plus forts moments de la révolte, il n'y avait pas de séparation entre les sexes dans les revendications. Je me rappelle du slogan : « les femmes et les hommes dans les droits sont les mêmes » qui a été souvent répété lors des manifestions. Certains slogans étaient accordés au masculin et au féminin : « écoute les fils du peuple, écoute les filles du peuple !».
Dans ce contexte de réveil politique et d'engagement des jeunes, nous assistons aussi à l'émergence d'un nouveau type de figures militantes. Aujourd'hui, la militante féministe est plutôt une jeune femme, pas forcément arrivée à un statut professionnel, social et civil considéré comme "stable" (ni mariée ni divorcée). Elle n'est pas forcément engagée au sein d'une association officiellement reconnue et peut utiliser des outils de revendication non conventionnels voire provocateurs pour certains. Et c'est ce qui explique sans doute que cette figure peine à trouver sa place au sein de la société. Aujourd'hui aussi, une militante ne cherche pas forcément à être dans la défense de victimes, elle se défend elle-même avant tout. Le terrain même de la lutte a changé: La femme militante réclame le droit d'être un individu, elle défend son existence libre au sein de la société.
Toutefois, ce contexte de printemps arabe n'est pas forcément synonyme d'avancées en matière d'épanouissement des femmes. En effet, ce qui se passe en Tunisie et en Egypte pendant ces deux dernières années nous a enseigné qu'aucun droit n'est définitivement acquis, et que les lois et les mentalités peuvent changer en notre défaveur. Cela a d'ailleurs remobilisé les militantes de tous fronts qui ont compris que rien n'était encore gagné : C'est un combat perpétuel de défendre ses droits et d'en gagner de nouveaux !
Peux-tu nous parler plus spécifiquement des actions que tu as toi même mené sur ces questions, des raisons de ton engagement, des modalités de ton action, des difficultés rencontrées et de tes objectifs ?
Le point de départ de mon engagement est lié à mon expérience personnelle, à mon vécu dans mon pays, le Maroc. Je tiens à le préciser clairement : mon engagement et mes actions, avant d'être présentés ou idéalisés comme une sorte de mission altruiste, c'est avant tout un combat personnel, bien sûr dans lequel peuvent se retrouver d'autres individus. Ce qui me dérange le plus, c'est la difficulté d'exister en tant qu'individu dans ma société. Et il n'y a pas de cloisonnement à faire à ce sujet entre femmes et hommes, ni de guerre entre les sexes, parce que le plus dur dans cet engagement, c'est de ne pas haïr l'autre, ce qui demande un effort immense quand on est attaqué verbalement, physiquement, parce qu'il faut comprendre l'autre, pour ne pas lui répondre par la même violence. Pour moi l'enjeu essentiel, c'est ce travail de compréhension, qui demande plus d'efforts que l'action concrète ou l'indignation systématique, mais qui est sans doute plus constructif dans le long terme. Il est essentiel qu'on travaille sur nos conceptions de la masculinité, de la féminité, et de notre rapport au corps.
Mon engagement sur ces questions se traduit essentiellement par un travail sur le terrain, travail difficile pour une femme, parce que c'est dans l'espace public qu'elle est le plus vulnérable. La question la plus pressante, celle du harcèlement sexuel dans la rue, est celle qui occupe la part la plus importante de mon temps, parce que c'est un combat quotidien. La première chose, c'est d'en terminer avec l'indifférence et l'impunité. L'impunité de l'homme amené à dire et faire ce qu'il veut. Les petites actions que je mène au quotidien, c'est de sortir avec suffisamment de temps pour pouvoir m'arrêter à chaque fois que je suis agressée verbalement pour interpeller les auteurs des attaques, pour leur interroger sur le pourquoi de leur comportement, leur demander de réfléchir à ce qu'ils viennent de dire. Cela peut prendre les tournures les plus agréables jusqu'à la confrontation public avec un attroupement de personnes qui viennent une fois que l'altercation a eu lieu, pour me calmer et non pas pour réprimander l'agresseur… Ce qui me permet aussi de demander aux gens pourquoi ils interviennent à ce moment et pas avant.
Je ne suis pas seule à faire ce travail, il y a d'autres personnes qui partagent ces mêmes préoccupations. Il y a des documentaires marocains en cours de réalisation sur la question, qui cherchent à donner de la visibilité au sujet, , le film égyptien "les femmes du bus 678" en traite aussi de manière poignante. Le mois dernier, nous avons réalisé une campagne avec le mouvement né sur Facebook "Le Soulèvement des Femmes dans le Monde Arabe" (Women Uprising in the Arab World) : nous avons affiché pendant une semaine dans 8 villes arabes d'immenses pancartes avec le visage de chacune d'entre nous portant un message pour interpeller les gens. A Tanger, on avait une affiche sur la façade de la cinémathèque de la ville, en 10×10 mètres. L'affiche avait pour message « je suis avec le soulèvement de la femme dans le monde arabe, parce que je ne me tairai pas devant le harcèlement sexuel auquel je fais face quotidiennement dans la rue ». L'idée était de pouvoir toucher ou interpeller chaque passant, et de mettre le doigt sur ce sujet en insistant sur le fait que c'est bien un problème sérieux et pas une mauvaise manière de draguer ou de faire connaissance !

Autre élément qui me tient à cœur, c'est le travail de réflexion commun entre hommes et femmes, avec l'organisation de petits ateliers de discussion réunissant des étudiants de tous les âges (collèges, lycées, universités), et de réfléchir ensemble sur la conception de nos corps et de nos relations. Ce qui est intéressant c'est de commencer ce travail depuis le début, avant que les consciences deviennent imperméables et fermées au débat.
Tout cela ne signifie pas non plus qu'il faille nier l'existence de réalités violentes et des personnes qui en sont victimes, parce qu'elles existent et ont besoin de soutien. A ce sujet, ce qui m'intéresse le plus c'est peut être ce qui se passe quand les caméras s'éteignent. Que se passe t-il quand la « victime » gagne son procès ? Est-ce que le plus important a été fait, ou est-ce que le plus important ce n'est pas d'avoir une alternative de vie ? Ce qui devrait nous occuper, c'est la possibilité de futur et de développement personnel offerte à ces personnes. Elles ont certes fait face à des réalités dures, mais cela devrait être juste un épisode à dépasser pour ouvrir de nouveaux chapitres de leur vie, meilleurs. Concrètement, cela veut dire qu'on doit travailler sur le suivi des victimes pour pouvoir leur assurer des possibilités de se reconstruire. Cela peut passer par une re-scolarisation, par une insertion dans le monde professionnel, un suivi psychologique, et la possibilité de rencontrer d'autres personnes ayant fait face à des situations similaires afin de créer un réseau de soutien entre elles. A ma connaissance, il y a encore beaucoup de travail à faire dans cette direction, et cela exige de se défaire de l'approche de victimisation qui suit la personne toute sa vie.
N'as-tu pas peur que ce travail de pédagogie ne soit pas suffisant pour changer les mentalités, pour bousculer les pesanteurs de ces sociétés, en tout cas à court et moyen terme ?
Ce travail sur les mentalités doit se faire accompagner par un renforcement du dispositif légal. On n'a pas encore de lois qui nous protègent du harcèlement sexuel dans la rue. Il y a un travail à faire pour réfléchir au type de loi dont nous aurions besoin pour lutter contre ce problème. Il faut en terminer avec l'impunité, mais sans tomber non plus dans une répression tout azimut. Je n'ai pas forcément envie qu'un harceleur se retrouve systématiquement en prison, ce que je veux c'est qu'il ne recommence plus. C'est la difficulté et le travail que l'on doit faire, et j'invite tous ceux qui sont intéressés par ce sujet à nous aider à élaborer une loi qui n'instaure par une guerre entre les sexes, mais qui protège en responsabilisant ceux qui enfreindraient les limites posées par la loi. Pour ceux-là, la peine pourrait se traduire en travaux d'intérêt général, en obligations de suivre des sessions de sensibilisation à ces thématiques, on n'a pas besoin forcément d'envoyer les gens en prison.
Et pour répondre à ta question, j'ai en effet parfois l'impression de vider la mer avec une petite cuillère. Il y a des jours où je me dis qu'en restant à une si petite échelle, même si j'y consacrais toute ma vie, je ne réussirai pas à toucher 1% de la société marocaine. Je profite donc de l'occasion pour inviter toute personne qui voudrait se joindre à moi pour travailler sur les questions soulevées, soit en participant aux ateliers de sensibilisation ou pour travailler sur une proposition de projet de loi concernant le harcèlement sexuel. Toutes autres idées sont aussi les bienvenues ! Si nous arrivons à constituer un groupe suffisamment solide, nous pourrions avoir plus d'impact et plus de visibilité et notre réseau pourrait s'étendre à travers tout le Maroc et toute l'Afrique du Nord.
Interview réalisée par Emmanuel Leroueil
Marwa Belghazi est joignable à l'adresse : gendermorocco@outlook.com
 Dans son essai « Zero to One : notes sur les startups et comment bâtir le futur », l’entrepreneur américain Peter THIEL, co-fondateur de sociétés comme PayPal et Palantir, identifie deux approches du progrès : un progrès horizontal ou encore incrémental, et un progrès vertical ou exponentiel.
Dans son essai « Zero to One : notes sur les startups et comment bâtir le futur », l’entrepreneur américain Peter THIEL, co-fondateur de sociétés comme PayPal et Palantir, identifie deux approches du progrès : un progrès horizontal ou encore incrémental, et un progrès vertical ou exponentiel.







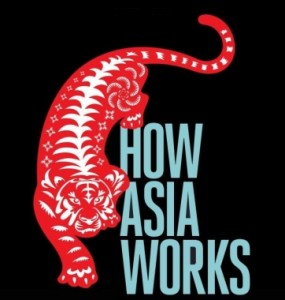 A contrario, le décret de 1962 instituant la New Bank of Korea, sous la tutelle du Ministère des Finances, a fait de cette banque centrale un instrument de financement de l’économie réelle aligné aux objectifs de développement du pays, sans tomber dans les travers africains de la planche à billet. En effet, les prêts préférentiels accordés aux industries nationales dépendaient de la capacité des opérateurs à produire des lettres de créance de clients internationaux, et donc à prouver leur compétitivité sur les marchés internationaux. Les banques qui prêtaient à ces opérateurs pour financer leur production préachetée à l’étranger pouvaient se refinancer quasiment à taux zéro auprès de la banque centrale. Ce type de mesure va grandement contribuer à accélérer la constitution d’une industrie lourde en Corée du Sud, suivie ensuite d’une industrie de technologie de pointe. La conditionnalité de la compétitivité des opérateurs créditeurs sud-coréens a permis d’assurer la soutenabilité de la dette nationale. La crise de 1997 finira d’assainir le paysage économique sud-coréen, en ne laissant survire que les opérateurs les plus solides économiquement et technologiquement.
A contrario, le décret de 1962 instituant la New Bank of Korea, sous la tutelle du Ministère des Finances, a fait de cette banque centrale un instrument de financement de l’économie réelle aligné aux objectifs de développement du pays, sans tomber dans les travers africains de la planche à billet. En effet, les prêts préférentiels accordés aux industries nationales dépendaient de la capacité des opérateurs à produire des lettres de créance de clients internationaux, et donc à prouver leur compétitivité sur les marchés internationaux. Les banques qui prêtaient à ces opérateurs pour financer leur production préachetée à l’étranger pouvaient se refinancer quasiment à taux zéro auprès de la banque centrale. Ce type de mesure va grandement contribuer à accélérer la constitution d’une industrie lourde en Corée du Sud, suivie ensuite d’une industrie de technologie de pointe. La conditionnalité de la compétitivité des opérateurs créditeurs sud-coréens a permis d’assurer la soutenabilité de la dette nationale. La crise de 1997 finira d’assainir le paysage économique sud-coréen, en ne laissant survire que les opérateurs les plus solides économiquement et technologiquement.
 2014 ne débute pas sous les meilleurs auspices pour l’Afrique. Pour ne reprendre que les titres qui font l’actualité : début de guerre civile au Sud-Soudan ; guerre civile en République Centrafricaine ; tentative de coup d’Etat en RDC ; situation institutionnelle bloquée en Tunisie ; situation politique délétère en Egypte… Et il faudrait encore citer des réalités moins visibles mais non moins réelles, comme le climat de défiance entre les citoyens et leurs représentants politiques dans nombre de pays africains, au premier rang desquels le géant Sud-africain ; la proportion quasi industrielle et systématique des détournements de biens publics dans certains pays, comme l’a illustré en fin d’année 2013
2014 ne débute pas sous les meilleurs auspices pour l’Afrique. Pour ne reprendre que les titres qui font l’actualité : début de guerre civile au Sud-Soudan ; guerre civile en République Centrafricaine ; tentative de coup d’Etat en RDC ; situation institutionnelle bloquée en Tunisie ; situation politique délétère en Egypte… Et il faudrait encore citer des réalités moins visibles mais non moins réelles, comme le climat de défiance entre les citoyens et leurs représentants politiques dans nombre de pays africains, au premier rang desquels le géant Sud-africain ; la proportion quasi industrielle et systématique des détournements de biens publics dans certains pays, comme l’a illustré en fin d’année 2013 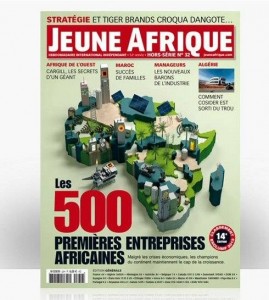 Notre analyse de la situation est qu’au-delà d’un environnement continental favorable, les agents économiques africains sont voués à s’engager dans une nouvelle logique d’organisation et de production de valeur ajoutée. Nous voyons dans la réorientation des méthodes d’organisation et de production des agents économiques dans le sens d’une recherche constante de la performance, le fondement de l’ère de prospérité qui se dessine. Cette recherche de la performance, que l'on peut également appeler efficience opérationnelle, repose sur deux principaux piliers : la compétivitié-coût et l'optimisation des processus.
Notre analyse de la situation est qu’au-delà d’un environnement continental favorable, les agents économiques africains sont voués à s’engager dans une nouvelle logique d’organisation et de production de valeur ajoutée. Nous voyons dans la réorientation des méthodes d’organisation et de production des agents économiques dans le sens d’une recherche constante de la performance, le fondement de l’ère de prospérité qui se dessine. Cette recherche de la performance, que l'on peut également appeler efficience opérationnelle, repose sur deux principaux piliers : la compétivitié-coût et l'optimisation des processus.
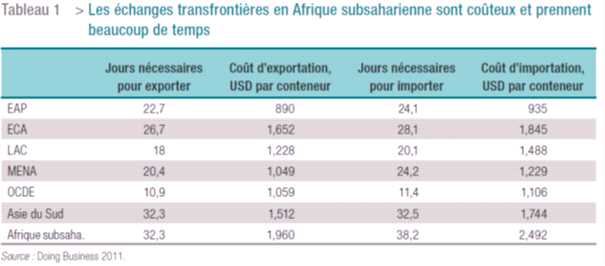
 En Afrique comme dans le reste du monde, les cabinets de conseil en Organisation et Stratégie jouent le rôle clé, dans le capitalisme moderne, d’agents de diffusion des meilleures pratiques afin de faire évoluer collectivement le tissu économique d’un espace donné. Tels des abeilles permettant la fécondation végétale en butinant de fleurs en fleurs, leur rôle dans la transformation de l’Afrique est d’accompagner les champions de la compétitivité d’aujourd’hui et de demain. Permettre à des entreprises d’occuper des positions de leadership dans leur secteur, en les aidait à rendre leur organisation plus efficace, plus innovante, mieux sécurisée et plus proche de leurs consommateurs.
En Afrique comme dans le reste du monde, les cabinets de conseil en Organisation et Stratégie jouent le rôle clé, dans le capitalisme moderne, d’agents de diffusion des meilleures pratiques afin de faire évoluer collectivement le tissu économique d’un espace donné. Tels des abeilles permettant la fécondation végétale en butinant de fleurs en fleurs, leur rôle dans la transformation de l’Afrique est d’accompagner les champions de la compétitivité d’aujourd’hui et de demain. Permettre à des entreprises d’occuper des positions de leadership dans leur secteur, en les aidait à rendre leur organisation plus efficace, plus innovante, mieux sécurisée et plus proche de leurs consommateurs.
 L’adaptation de ce service aux besoins des clients a permis à Safaricom de s’imposer sur le marché : entre son lancement en mars 2007 et décembre 2011, le système M-Pesa a convaincu 17 millions de consommateurs sur le seul marché kenyan. A l’image de cette success story, les entreprises africaines doivent trouver leur propre réponse aux besoins particuliers de leur marché, et partir sur cette base à la conquête du monde. Cette dynamique est déjà en cours dans les grandes économies émergentes que sont la Chine, l’Inde ou le Brésil [6]. L’Afrique peut et doit faire autant, si ce n’est mieux.
L’adaptation de ce service aux besoins des clients a permis à Safaricom de s’imposer sur le marché : entre son lancement en mars 2007 et décembre 2011, le système M-Pesa a convaincu 17 millions de consommateurs sur le seul marché kenyan. A l’image de cette success story, les entreprises africaines doivent trouver leur propre réponse aux besoins particuliers de leur marché, et partir sur cette base à la conquête du monde. Cette dynamique est déjà en cours dans les grandes économies émergentes que sont la Chine, l’Inde ou le Brésil [6]. L’Afrique peut et doit faire autant, si ce n’est mieux.
 Près de vingt ans après son arrivée démocratique au pouvoir et la planification de ses objectifs à travers le Reconstruction & Development Programme (RDP), le gouvernement de l’ANC tire un bilan de son action et fixe les grandes lignes de sa volonté politique et économique d’ici à 2030, pour la prochaine génération de Sud-Africains.
Près de vingt ans après son arrivée démocratique au pouvoir et la planification de ses objectifs à travers le Reconstruction & Development Programme (RDP), le gouvernement de l’ANC tire un bilan de son action et fixe les grandes lignes de sa volonté politique et économique d’ici à 2030, pour la prochaine génération de Sud-Africains.
 L’arrivée au pouvoir en 2009 du président Jacob Zuma a coïncidé avec la volonté pour l’ANC de porter un regard critique sur son propre bilan afin de construire, sur cette base, les lignes de son projet d’avenir pour l’Afrique du Sud. Une démarche rigoureuse et honnête qui mérite d’être saluée. Cette tâche difficile a été confiée à Trévor Manuel, ancien ministre des Finances sous les deux mandats de Thabo Mbeki. En juin 2011, un premier Rapport de Diagnostic sur le bilan de l’ANC est rendu public. Ce diagnostic est sans concession, qui reconnaît d’emblée que « les conditions socio-économiques qui ont caractérisé le système de l’apartheid et du colonialisme définissent encore largement notre réalité sociale ». Tout en se félicitant des réelles avancées connues depuis 1994 – l’adoption d’une nouvelle Constitution pour l’égalité des droits et l’établissement de la démocratie ; le rétablissement de l’équilibre des finances publiques ; la fin des persécutions politiques de l’apartheid ; l’accès aux services publiques de première nécessité (éducation, santé, eau, électricité) pour des populations qui en étaient privées – le rapport de diagnostic reconnait que la situation présente de l’Afrique du Sud pose problème. La pauvreté reste endémique et les inégalités socio-économiques ont continué à se creuser, faisant de la Nation arc-en-ciel le deuxième pays le plus inégalitaire au monde après le Lesotho[1].
L’arrivée au pouvoir en 2009 du président Jacob Zuma a coïncidé avec la volonté pour l’ANC de porter un regard critique sur son propre bilan afin de construire, sur cette base, les lignes de son projet d’avenir pour l’Afrique du Sud. Une démarche rigoureuse et honnête qui mérite d’être saluée. Cette tâche difficile a été confiée à Trévor Manuel, ancien ministre des Finances sous les deux mandats de Thabo Mbeki. En juin 2011, un premier Rapport de Diagnostic sur le bilan de l’ANC est rendu public. Ce diagnostic est sans concession, qui reconnaît d’emblée que « les conditions socio-économiques qui ont caractérisé le système de l’apartheid et du colonialisme définissent encore largement notre réalité sociale ». Tout en se félicitant des réelles avancées connues depuis 1994 – l’adoption d’une nouvelle Constitution pour l’égalité des droits et l’établissement de la démocratie ; le rétablissement de l’équilibre des finances publiques ; la fin des persécutions politiques de l’apartheid ; l’accès aux services publiques de première nécessité (éducation, santé, eau, électricité) pour des populations qui en étaient privées – le rapport de diagnostic reconnait que la situation présente de l’Afrique du Sud pose problème. La pauvreté reste endémique et les inégalités socio-économiques ont continué à se creuser, faisant de la Nation arc-en-ciel le deuxième pays le plus inégalitaire au monde après le Lesotho[1].
 J’étais à Addis-Abeba du 23 au 26 mai 2013, pour participer aux célébrations du cinquantenaire de l’Union africaine. Sous l’invitation conjointe de la Commission de l’Union africaine, de la Commission Economique pour l’Afrique des Nations Unies et de la Banque Africaine de Développement, j’ai participé avec environ deux cent jeunes gens provenant de l’ensemble du continent à un débat intergénérationnel avec des présidents africains, le 24 mai. L’intérêt pour moi était triple : participer « en live » à un moment historique de réjouissance et de projection du projet panafricaniste ; rencontrer des jeunes Africains de mon âge avec des cultures et des parcours différents des miens, discuter avec eux pour juger de ce qu’ils pensent, ce qu’ils projettent de faire, ce qu’ils sont ou compte devenir ; enfin visiter Addis-Abeba, une ville à la fois mythique et dynamique dont beaucoup de personnes m’avaient dit le plus grand bien.
J’étais à Addis-Abeba du 23 au 26 mai 2013, pour participer aux célébrations du cinquantenaire de l’Union africaine. Sous l’invitation conjointe de la Commission de l’Union africaine, de la Commission Economique pour l’Afrique des Nations Unies et de la Banque Africaine de Développement, j’ai participé avec environ deux cent jeunes gens provenant de l’ensemble du continent à un débat intergénérationnel avec des présidents africains, le 24 mai. L’intérêt pour moi était triple : participer « en live » à un moment historique de réjouissance et de projection du projet panafricaniste ; rencontrer des jeunes Africains de mon âge avec des cultures et des parcours différents des miens, discuter avec eux pour juger de ce qu’ils pensent, ce qu’ils projettent de faire, ce qu’ils sont ou compte devenir ; enfin visiter Addis-Abeba, une ville à la fois mythique et dynamique dont beaucoup de personnes m’avaient dit le plus grand bien.
 La rencontre avait pourtant bien commencé. Dans son propos introductif, Carlos Lopes rappelait l’importance de la jeunesse en Afrique, de par son poids démographique dans nos sociétés actuelles, mais également par le rôle historique qu’elle a déjà été amené à jouer : les pères des indépendances, les fondateurs des Etats modernes africains, les grands romanciers et artistes qui font aujourd’hui la fierté du continent avaient pour la plupart (Kwamé Nkrumah, Patrice Lumumba, Frantz Fanon, Amilcar Cabral) commencé à bâtir l’œuvre qui allait les rendre célèbre à un très jeune âge. Un propos confirmé par Mme Dlamini-Zuma qui a plus particulièrement insisté sur le leadership féminin et la nécessité d’offrir les conditions d’épanouissement aux jeunes filles et femmes africaines.
La rencontre avait pourtant bien commencé. Dans son propos introductif, Carlos Lopes rappelait l’importance de la jeunesse en Afrique, de par son poids démographique dans nos sociétés actuelles, mais également par le rôle historique qu’elle a déjà été amené à jouer : les pères des indépendances, les fondateurs des Etats modernes africains, les grands romanciers et artistes qui font aujourd’hui la fierté du continent avaient pour la plupart (Kwamé Nkrumah, Patrice Lumumba, Frantz Fanon, Amilcar Cabral) commencé à bâtir l’œuvre qui allait les rendre célèbre à un très jeune âge. Un propos confirmé par Mme Dlamini-Zuma qui a plus particulièrement insisté sur le leadership féminin et la nécessité d’offrir les conditions d’épanouissement aux jeunes filles et femmes africaines.

 Yannick Ebibié est le président de l’association One Gabon, qui promeut la culture de l’entreprenariat et soutient des entrepreneurs dans leur montage de projet et leur recherche de financement au Gabon. Il se confie aux lecteurs de Terangaweb – l’Afrique des idées sur l’action de son association et sa lecture des potentialités qu’offre le financement participatif – crowdfunding en anglais – pour les entrepreneurs africains.
Yannick Ebibié est le président de l’association One Gabon, qui promeut la culture de l’entreprenariat et soutient des entrepreneurs dans leur montage de projet et leur recherche de financement au Gabon. Il se confie aux lecteurs de Terangaweb – l’Afrique des idées sur l’action de son association et sa lecture des potentialités qu’offre le financement participatif – crowdfunding en anglais – pour les entrepreneurs africains.

 Il y a des modèles de financement différents suivant les plateformes. Sur certaines, ce sont des prêts avec intérêts. Pour Kiva et ONE Gabon, tu donnes de l’argent, qui te sera remboursé progressivement, sans intérêt. Kickstarter est plus dans le don. De manière générale, je pense que ce nouveau procédé, rendu possible grâce à la technologie et aux nouveaux réseaux virtuels, représente une opportunité très important dont beaucoup d’Africains pourraient profiter. Au sein de notre association, nous souhaitons étudier la question pour comprendre quels sont les freins au développement du financement participatif au Gabon. Une première observation, c’est que souvent les institutions de micro-finance ne parviennent pas à atteindre les standards exigés par les plateformes tels que Kiva. Il y a donc sans doute un travail à mener pour mieux accompagner les différentes acteurs engagés dans le microfinancement, et sans doute faire évoluer le cadre réglementaire qui entoure ce secteur.
Il y a des modèles de financement différents suivant les plateformes. Sur certaines, ce sont des prêts avec intérêts. Pour Kiva et ONE Gabon, tu donnes de l’argent, qui te sera remboursé progressivement, sans intérêt. Kickstarter est plus dans le don. De manière générale, je pense que ce nouveau procédé, rendu possible grâce à la technologie et aux nouveaux réseaux virtuels, représente une opportunité très important dont beaucoup d’Africains pourraient profiter. Au sein de notre association, nous souhaitons étudier la question pour comprendre quels sont les freins au développement du financement participatif au Gabon. Une première observation, c’est que souvent les institutions de micro-finance ne parviennent pas à atteindre les standards exigés par les plateformes tels que Kiva. Il y a donc sans doute un travail à mener pour mieux accompagner les différentes acteurs engagés dans le microfinancement, et sans doute faire évoluer le cadre réglementaire qui entoure ce secteur.
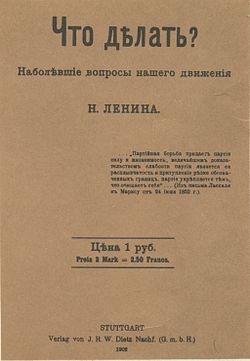 En 1863, Nikolaï Tchernychevski, écrivain et penseur socialiste dans la Russie tsariste féodale, publiait un roman qui allait influencer des générations de jeunes penseurs et activistes, bien au-delà de ses frontières. A notre époque, peu ont eu l'occasion de lire dans le texte ce monument de la littérature russe, mais peu ignorent la puissance évocatrice de son titre : « Que faire ? »
En 1863, Nikolaï Tchernychevski, écrivain et penseur socialiste dans la Russie tsariste féodale, publiait un roman qui allait influencer des générations de jeunes penseurs et activistes, bien au-delà de ses frontières. A notre époque, peu ont eu l'occasion de lire dans le texte ce monument de la littérature russe, mais peu ignorent la puissance évocatrice de son titre : « Que faire ? » Entretien avec Marwa Belghazi, activiste féministe au Maroc.
Entretien avec Marwa Belghazi, activiste féministe au Maroc.