 Dambisa Moyo, William Easterly, ou encore Jeffrey Sachs sont des noms qui reviennent souvent dans les débats sur l’aide au développement. À coup de théories économiques et d’exemples de cas d’école, chacun d’entre eux, et de nombreux autres économistes du développement, apportent leurs perspectives à la question de l’efficacité de l’aide, et son impact réel sur le développement. Pourtant, les alternatives à l’aide au développement attirent également de plus en plus l’attention des économistes comme substitut ou complément à l’aide au développement, car ayant le potentiel de limiter la dépendance à l’aide ou de combler certaines de ses lacunes. Cet article a donc pour objectif de présenter certains de ces nouveaux moyens de financement du développement, notamment les partenariats publics privés, et l’autofinancement à travers le recours aux ressources internes et à l’endettement sur les marchés financiers. Ces modèles ont également leurs limites, qui seront présentées dans un second temps.
Dambisa Moyo, William Easterly, ou encore Jeffrey Sachs sont des noms qui reviennent souvent dans les débats sur l’aide au développement. À coup de théories économiques et d’exemples de cas d’école, chacun d’entre eux, et de nombreux autres économistes du développement, apportent leurs perspectives à la question de l’efficacité de l’aide, et son impact réel sur le développement. Pourtant, les alternatives à l’aide au développement attirent également de plus en plus l’attention des économistes comme substitut ou complément à l’aide au développement, car ayant le potentiel de limiter la dépendance à l’aide ou de combler certaines de ses lacunes. Cet article a donc pour objectif de présenter certains de ces nouveaux moyens de financement du développement, notamment les partenariats publics privés, et l’autofinancement à travers le recours aux ressources internes et à l’endettement sur les marchés financiers. Ces modèles ont également leurs limites, qui seront présentées dans un second temps.
-
Quels nouveaux modèles de financement pour le développement ?
-
Les Partenariats Public–Privé (PPP)
Les Partenariats Public–Privé (PPP) sont principalement utilisés pour financer des infrastructures, et ont été imaginés pour éviter certaines difficultés posées par les modèles traditionnels de financement des infrastructures. En effet, le modèle de marché public, dans lequel une entreprise produit une infrastructure qui sera ensuite gérée par l’État, fait peser sur celui-ci des risques liés à un manque de contrôle sur la qualité de l’infrastructure, et sur les coûts que cela peut engendrer. Le modèle de la concession publique, où c’est l’État qui est en charge de la construction de l’infrastructure qui sera gérée par une entreprise, fait peser ces risques entièrement sur l’entreprise.
Les PPP représentent donc un nouveau modèle de financement, censé permettre une meilleure répartition des risques. Même si le terme de PPP peut être utilisé pour désigner différents type de projets, c’est en général la réalisation et l’entretien par une entreprise, pour le compte de l’État d’un ouvrage ou un service public, qui produit ensuite des recettes qui servent à rémunérer l’entreprise. C’est par exemple le cas de l’autoroute à péage Dakar-Diamniado, réalisée par la société Eiffage au Sénégal ou le pont Henry Konan Bédié réalisé par la Socoprim en Côte d’Ivoire. Dans les deux cas, l’entreprise a été chargée par le gouvernement de concevoir et réaliser l’ouvrage, ainsi que de l’exploiter et de l’entretenir, pour une durée de 30 ans.
Le modèle des PPP permet un meilleur équilibre des risques, avec un État garantissant des compensations au cas où l’équilibre financier prévu pour le projet, n’est pas atteint. Ce modèle de financement assure également en général des ouvrages de qualité, dans les délais, d’une part car le partenaire privé qui le réalise possède une expertise en la matière, de l’autre car elle doit bénéficier des recettes qui en découlent.
-
Les marchés financiers
L’autofinancement du développement représente une autre alternative à l’aide au développement. Elle permettrait aux États de rompre une situation de dépendance à l’aide, souvent critiquée, et de moins subir les chocs externes. On peut s’intéresser d’une part à l’emprunt sur les marchés financiers, et d’autre part aux ressources que sont l’épargne privée intérieure (c’est-à-dire celle des populations), et l’épargne publique, qui découle des impôts sur les particuliers et les entreprises.
L’émission d’emprunts sur les marchés se développe depuis quelques années, avec de plus en plus de pays africains qui se tournent vers l’émission d’emprunts sur les marchés financiers, comme moyen de financer leur développement. Ces émissions consistent en des titres de créances émis par les États africains, sur des marchés étrangers, qui seront remboursés en totalité et avec intérêts. Le Ghana était ainsi le premier à émettre des obligations souveraines d’un montant total de 750 millions de dollars à un taux d’intérêt de 8,5%. En Octobre 2015, il émettait à nouveau des obligations, cette fois pour un montant de 1 milliard de dollar US, à un taux d’intérêt de 10,75%.
D’autres pays ont rapidement suivi le Ghana, parmi lesquels la Côte d’Ivoire, le Sénégal, le Gabon, le Cameroun ou encore le Tchad. Derniers en date, le Sénégal en Mars et l’Algérie en Avril. Avec des taux de croissance importants et des profils de risque qui se sont améliorés, les États africains peuvent apparaitre comme particulièrement attractifs pour certains investisseurs. Du côté des États, l’intérêt de ces émissions d’emprunt est qu’elles les laissent autonomes dans la gestion des fonds obtenus, contrairement aux prêts bilatéraux et multilatéraux. Cependant, ce modèle remplace les créanciers traditionnels des États africains que sont les bailleurs de fonds, par de nouveaux créanciers.
-
Les ressources internes
En revanche, d’autres ressources internes gagneraient à être davantage exploitées par les États africains, notamment l’épargne. D’après le rapport économique sur l'Afrique 2010, publié par la Commission économique pour l’Afrique, « le taux d’épargne en Afrique est très faible par rapport à ceux d’autres parties du monde en développement », avec moins de 20% du PIB. Les ressources comme l’épargne privée ou les impôts sont donc clairement sous exploitées par les États, malgré le potentiel important qu’elles représentent.
C’est notamment le cas de l’épargne privée, alors que la microfinance a montré que même les populations les plus pauvres sont capables d’épargner. En cause : des systèmes financiers qui excluent la majorité des citoyens. À cause d’un nombre d’agences insuffisant surtout dans les zones rurales, de versements minimum demandés trop élevés, de taux d’intérêt peu intéressants ou encore une documentation à fournir, trop importante, les conditions nécessaires à l’ouverture d’un compte d’épargne sont souvent des barrières rendant ceux-ci peu attractifs pour les particuliers.
Du côté des ressources publiques, les systèmes fiscaux gagneraient à être développés. Les impôts collectés par les États africains ont pourtant augmentés, selon le rapport Perspectives Économiques en Afrique publié en 2010. Le rapport montre ainsi qu’ils sont passés de 113 milliards de dollars USD en 1996, à 479 milliards en 2008. Cependant, ces impôts sont souvent issus de la taxation des ressources minières et naturelles. Or, les crises successives des matières premières ont montré les limites de ce type de fiscalité ; de plus, cette source de revenus est souvent montrée du doigt comme facteur contribuant à la mauvaise gouvernance et à l’instabilité politique. Enfin, elles peuvent représenter un obstacle à la mise en place de systèmes fiscaux plus complexes, car représentant une source de revenus faciles.
En revanche, la mise en place d’impôts directs sur les populations et les sociétés, et indirects (TVA et autres taxes commerciales) permettrait de mobiliser de nouvelles ressources. Certains économistes argumentent par ailleurs que la taxation des particuliers peut rendre la population plus regardante sur la gestion des ressources publiques lorsque celles-ci sont issues de ses propres revenus, en comparaison avec l’aide extérieur, qui n’exerce pas la même pression sur les populations.
-
Limites et risques des nouveaux moyens de financement
Ces nouveaux moyens de financement du développement ne sont pas exempts de risques et de coûts, qu’on ne retrouve pas forcément avec l’aide au développement.
-
Les Partenariats Public–Privé (PPP)
Dans le cas des PPP, les États ne maitrisent pas forcément les risques liés à la demande. En effet, le niveau futur de demande ou d’utilisation par les usagers de l’ouvrage, est estimé lors de la signature du PPP. Si ce niveau n’est pas atteint, l’État doit verser des compensations financières au partenaire privé, ce qui représente donc des dépenses supplémentaires pour l’État. Par ailleurs, le risque de mauvaise gouvernance, liés aux marchés publics et aux concessions lorsque ceux-ci ne sont pas attribués de manière transparente et équitable, reste présent dans les PPP. Pour limiter ces risques, le développement d’un cadre réglementaire des PPP pourrait favoriser leur réussite. La Banque Africaine de Développement et la Banque Mondiale encouragent les États africains à aller dans ce sens, et c’est de plus en plus le cas. Les États de l’UEMOA travaillent ainsi à la mise en place d’un cadre régional des PPP, et nombreux sont les États qui ont déjà un cadre national, comme le Sénégal, le Niger ou la Côte d’Ivoire. Pour que ce cadre devienne réellement opérationnel, il sera important de renforcer les capacités des organismes en charge de gérer les PPP, et l’aide au développement pourrait y contribuer directement en facilitant des transferts de compétences dans ce domaine.
-
Les marchés financiers
Les émissions d’emprunt sur les marchés financiers, elles, si elles représentent une alternative intéressante à l’aide au développement, envoyant des signaux positifs quant au développement économique de l’Afrique, peuvent également être à double tranchant. Dans un article publié en 2013 dans le journal les Échos, l’économiste Joseph Stiglitz met en garde contre un enthousiasme exagéré vis-à-vis de ces émissions. En effet, elles ont un coût supérieur à celui des prêts bilatéraux ou multilatéraux, car ces derniers ont des taux d’intérêts bas voir nuls, ce qui n’est pas le cas des obligations. Elles contribuent ainsi à l’endettement des pays africains : alors qu’il y a une dizaine d’années, les émissions d’obligations des États africains représentaient 1% de la dette extérieure des pays en développement, elles sont passées aujourd’hui à 4%.
-
Les ressources internes
Le développement d’un système fiscal efficace parait de loin plus avantageux, car permettant à l’État de rester autonome et de mobiliser sa population. Le potentiel parait énorme, notamment avec la possibilité de taxer le secteur informel. Pourtant les réformes du système administratif devraient être profondes, avec notamment un besoin de décentralisation de l’administration pour assurer une collecte dans toutes les zones des pays. Les nouvelles technologies peuvent ici jouer un rôle efficace dans cette collecte, avec le potentiel de systèmes comme les paiements mobiles ou la plateforme eZwick au Ghana qui permet à ses utilisateurs d’atteindre des instruments financiers peu importe leur situation géographique.
Cependant, la mise en place d’une fiscalité efficace nécessitera des réformes plus profondes des systèmes en place. Parmi celles-ci, l’allocation d’une part plus importante des ressources collectées aux des dépenses productives, plutôt que pour couvrir les dépenses de fonctionnement, qui représentent aujourd’hui 85% des ressources internes collectées. Enfin, pour qu’un tel système fiscal fonctionne, la confiance de la population dans le système et une gestion transparente des fonds seront des prérequis, ainsi qu’une société civile engagée et vigilante par rapport à l’utilisation des fonds. Cette évolution ne pourra se faire qu’avec des États prêts à dialoguer davantage avec leurs populations, et des populations plus regardantes sur le modèle de gouvernance de leurs États.
MC


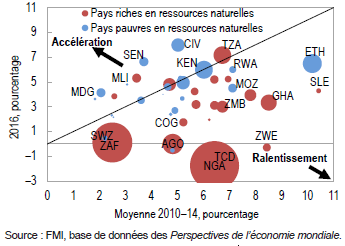
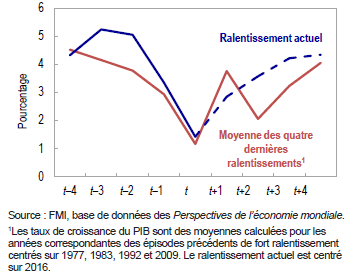



 Un article
Un article