Étreintes par le sous-emploi et le chômage des jeunes, les économies africaines devront réinventer leur système éducatif. Si le débat n’est pas nouveau, notamment en ce qui concerne le rôle de l’éducation dans la formation du capital humain, ses termes devront avancer en incluant les spécificités de la formation professionnelle. Lire plus dans ce rapport (avec un Erratum, page 8, lire 100 M d’emplois)
Catégorie : Publications
Enquête sur les attentes des jeunes Africains en matière de formation
Cette enquête constitue une première tentative pour comprendre les facteurs qui déterminent
les choix de formation des jeunes Africains et ce qu’ils espèrent autour de leur formation
pour améliorer leur employabilité. Bien que les résultats fournissent des indications générales
sur les attentes des jeunes Africains, elles ne devraient pas être considérées comme des faits
stylisés. On retient tout au moins les besoins des jeunes Africains en matière de formation pourrait
trouver une réponse dans l’ETFP, dont le potentiel reste très marginalement employé en Afrique.Enquete sur les attentes des jeunes africains en matière de formation
Rencontr’Afrique sur le Franc CFA avec Nicolas NORMAND
 Mercredi 02 octobre 2019. L’Afrique des Idées, bureau de Paris a eu l’immense honneur de recevoir M. Nicolas NORMAND, ancien diplomate français, normalien et énarque et enseignant à Sciences Po et à l’ENA. Il a été ambassadeur de France au Mali, au Congo, au Sénégal et en Gambie. Fort de son expérience et de sa fine connaissance de l’Afrique, il a partagé avec l’assistance sa vision de la monnaie FCFA en renchérissant l’agenda pour une réforme du FCFA proposé par L’Afrique des Idées. La « Rencontr’Afrique » débuta par une présentation des travaux du think tank sur la monnaie du FCFA puis s’ensuivit l’intervention de M. Nicolas NORMAND.
Mercredi 02 octobre 2019. L’Afrique des Idées, bureau de Paris a eu l’immense honneur de recevoir M. Nicolas NORMAND, ancien diplomate français, normalien et énarque et enseignant à Sciences Po et à l’ENA. Il a été ambassadeur de France au Mali, au Congo, au Sénégal et en Gambie. Fort de son expérience et de sa fine connaissance de l’Afrique, il a partagé avec l’assistance sa vision de la monnaie FCFA en renchérissant l’agenda pour une réforme du FCFA proposé par L’Afrique des Idées. La « Rencontr’Afrique » débuta par une présentation des travaux du think tank sur la monnaie du FCFA puis s’ensuivit l’intervention de M. Nicolas NORMAND.
Agenda pour une réforme du FCFA
 Le débat sur la pertinence du FCFA a eu une résonance très forte ces dernières années. Notre think tank s’est donc permis d’apporter sa contribution au débat à travers une analyse technique de la monnaie FCFA (analyse téléchargeable ici). Les résultats de cette étude ont permis d’élucider les caractéristiques de la zone franc et des économies des pays qui en font partie. En effet:
Le débat sur la pertinence du FCFA a eu une résonance très forte ces dernières années. Notre think tank s’est donc permis d’apporter sa contribution au débat à travers une analyse technique de la monnaie FCFA (analyse téléchargeable ici). Les résultats de cette étude ont permis d’élucider les caractéristiques de la zone franc et des économies des pays qui en font partie. En effet:
- L’inflation est nettement maîtrisée dans les pays de la zone franc comparativement aux autres économies d’Afrique sub-saharienne, une performance non négligeable dans des pays pauvres où la réduction de l’incertitude afin d’attirer les investisseurs, couplée au maintien et à l’amélioration du pouvoir d’achat des populations sont essentiels ;
- Le niveau des crédits à l’économie reste sous-optimal en dépit d’un taux de couverture de l’émission monétaire largement supérieur au minimum de 20% requis, mais il l’est aussi dans les économies situées en dehors de la zone ;
- Les balances commerciales sont déficitaires en raison d’un manque de diversification des économies imputable à la faiblesse des structures et à l’absence d’une vision à moyen ou long terme.
Toutefois, le système de la zone franc ne constitue pas une panacée. En effet, les risques d’une radicalisation de la contestation populaire, voire d’une désintégration de la zone monétaire sont très probables pour deux raisons essentielles :
- Les impacts sociaux de la stabilité monétaire (bonnes performances d’inflation) ne sont pas encore effectifs, un demi-siècle après l’introduction de la monnaie commune compte-tenu de l’insuffisance des performances d ’une croissance économique soutenue ;
- La remise en cause de la « souveraineté monétaire » des États membres de la zone est réelle et exceptionnelle même si l’architecture institutionnelle du système de la zone franc telle que présentée ne suppose une quelconque domination de la France dans les décisions de politique monétaire.
Pour se prémunir de ces risques politiques, l’étude propose deux scénarios de réformes cumulables en mettant en exergue le rôle central des États et des politiques budgétaires. Le premier vise uniquement à maximiser les avantages du système monétaire actuel et envisage une révision des aspects de la monnaie commune qui ne nécessitent pas une remise en question de la convention de coopération entre la France et les États membres. Le deuxième scénario propose une évolution des dispositions actuelles de la convention de coopération qui remettent en cause la souveraineté monétaire des États membres. Plus spécifiquement, le premier scénario propose de :
- Accroître le financement de l’intégration régionale en utilisant une partie des recettes générées par les réserves monétaires et les opérations d’open-market pour financer des infrastructures régionales, ou pour servir de garantie à des prêts ;
- Ne plus faire fabriquer la monnaie par la Banque de France, mais par un prestataire choisi à l’issue d’un appel d’offre. Idéalement, le lieu de fabrication devra être externe à la zone franc pour éviter les risques de conflits politiques ;
- Renommer la monnaie commune de manière à lui enlever toute connotation coloniale.
Le second scenario consisterait à :
- Remplacer le compte des opérations par un compte d’avances auprès de la Banque de France ;
- Mettre en place une commission d’experts incluant des représentants français, en lieu et place de leur présence au sein du conseil d’administration et du comité de politique monétaire des banques centrales.
Au-delà de ces réformes, les États ont un rôle essentiel à jouer afin d’optimiser les effets de la politique monétaire. Ils devront :
- Accroître le financement du secteur privé à travers le déploiement de solutions innovantes de gestion des risques de crédits et d’assurance ;
- Faire de la diversification économique une priorité en se focalisant sur la production locale de produits de première nécessité tels que le riz, le blé, le lait et la volaille ;
- Approfondir l’intégration régionale en accélérant la normalisation des réglementations et en donnant davantage de moyens à la Banque Ouest Africaine de Développement pour financer la convergence des économies de la sous-région.
Intervention de M. Nicolas Normand
 L’ancien diplomate français a commencé son discours avec beaucoup de pédagogie sur la question monétaire. En effet, la monnaie, rappelle-t-il, est un instrument qui remplit trois fonctions essentielles :
L’ancien diplomate français a commencé son discours avec beaucoup de pédagogie sur la question monétaire. En effet, la monnaie, rappelle-t-il, est un instrument qui remplit trois fonctions essentielles :
- La monnaie comme unité de compte. Elle permet d’exprimer la valeur de tous les biens et services dans une unité commune et de faire des choix en conséquence. Elle rend ainsi possible l’allocation des ressources selon leur usage optimal.
- La monnaie comme instrument d’échange. Elle facilite les transactions entre les agents économiques. Elle rend possible des échanges qui seraient beaucoup trop complexes dans une économie de troc.
- La monnaie comme réserve de valeur. Elle permet de transférer du pouvoir d’achat. Elle rend possible l’accumulation du capital via l’épargne. Il faut pour cela que la monnaie soit stable, c’est à dire qu’il soit possible d’épargner sans craindre que la monnaie perdra en valeur à un degré imprévisible.
En plus de ces 3 fonctions sus-citées, la monnaie présente aussi une dimension politique, insiste-t-il. En effet, la monnaie est outil de souveraineté nationale d’un pays et, d’un point de vue anthropologique, un facteur de lien social, de cohésion, de rapprochement entre membres d’une même communauté. M. Normand aborde ensuite les caractéristiques du FCFA.
Il précise en effet, que le franc FCFA a bien rempli ses fonctions économiques notamment celle de réserve de valeur. L’inflation dans la zone franc est totalement maitrisée (0,8% en 2017) générant ainsi de la confiance en l’avenir et permettant d’attirer les investisseurs. La zone franc connait donc une stabilité monétaire remarquable. Il a pris l’exemple du Zimbabwe, pays hors de la zone franc, qui pour des besoins de financement des coûts de fonctionnement de l’Etat, s’est mis a imprimé des billets. Les prix se sont envolés, l’économie s’est totalement dérégulée. Une autre caractéristique de la zone franc est que les pays s’y trouvant doivent déposer la moitié de leurs réserves de change au Trésor français. Tous les pays, africains ou pas, ont généralement besoin de détenir un peu de réserves de change (un matelas de 3 mois) afin de pouvoir assurer les importations. Donc techniquement, ça ne changerait pas grande chose, si les réserves de change étaient stockées à Bamako ou à Cotonou. Par contre, cela pose un problème politique, un problème de souveraineté.
L’ancien diplomate donne son point de vue personnel en indiquant qu’il épouse l’idée de la sortie du FCFA par les pays qui l’utilisent. La raison principale pour laquelle il est partisan de la sortie du FCFA est l’aspect politique et symbolique. Il lui paraît essentiel de couper le cordon ombilical avec la France qui alimente tous les fantasmes de la francafrique. La solution peut être soit une européanisation complète du système où la BCE remplace la banque de France ou bien un système purement africain : des monnaies nationales ou bien une nouvelle monnaie commune, ce qui est plus compliqué à realiser. Il ajoute que le système cfa favorise les investissements et échanges avec la zone euro et non spécialement avec la France, sans handicap pour les autres grands partenaires (Chine et usa). Mais il est clair qu’une monnaie stable est nécessaire mais nullement suffisante.
Par ailleurs, M. Nicolas Normand souligne la faiblesse des échanges intra-zone franc. Il pense même que, si l’idée de la monnaie commune est utile, elle n’est en revanche pas nécessaire car les pays de la zone franc échangent très peu entre eux. Il indique aussi que d’autres problématiques, tout aussi importantes que celle de la monnaie FCFA, sont au cœur des défis à relever par les pays africains. Son livre « Le Grand Livre de l’Afrique » aborde les questions de politique, d’économie, de culture, de terrorisme. Il y dresse un panorama complet de la réalité africaine tout en proposant des approches de solutions qui pourraient remettre l’Afrique en phase avec son ambition d’émergence.
Agenda pour une réforme du franc CFA
 Alors que le débat repart de plus belle sur le franc CFA, L’Afrique des Idées anticipe et propose un agenda pour réformer la zone monétaire, privilégiant les arguments économiques et sociaux qui renforcent la nécessité d’envisager un avenir autre que le statu quo actuel.
Alors que le débat repart de plus belle sur le franc CFA, L’Afrique des Idées anticipe et propose un agenda pour réformer la zone monétaire, privilégiant les arguments économiques et sociaux qui renforcent la nécessité d’envisager un avenir autre que le statu quo actuel.
Les défis de la formation professionnelle et technique en Afrique : Quel avenir pour la jeunesse du continent ?-Livre Blanc de la Conférence Annuelle 2018
[pdfjs-viewer url= »https://www.lafriquedesidees.org/wp-content/uploads/2018/12/livreblanc_FINAL_nume%CC%81rique-1.pdf » viewer_width=100% viewer_height=1360px fullscreen=true download=true print=true]
La coopération BRIC/Afrique : Bilan, enjeux, perspectives
[pdfjs-viewer url= »https://www.lafriquedesidees.org/wp-content/uploads/2018/09/Bric-Afrique.pdf » viewer_width=100% viewer_height=1360px fullscreen=true download=true print=true]
Le terrorisme en Afrique : Mythes, faits, réalités
[pdfjs-viewer url= »https://www.lafriquedesidees.org/wp-content/uploads/2018/09/terrorisme-afrique.pdf » viewer_width=100% viewer_height=1360px fullscreen=true download=true print=true]
La Revue de L’Afrique des Idées – numero 2
Dans l’édition 2018, retrouvez des propositions concrètes en matière de gestion des déchets, de connectivités physiques dans la CEMAC et d’implication des diasporas dans le développement local au Sénégal et au Cameroun.
Vous pouvez télécharger gratuitement l’intégralité de la Revue en cliquant ici.
Boris Houenou, économiste
Directeur des publications de l’Afrique des Idées
Rencontr’Afrique Bureau de Dakar : « Jeunesse africaine et entreprenariat : comment peuvent-ils améliorer le climat des affaires ? »

Le Samedi 27 Janvier 2018, Les membres de l’Afrique des Idées du bureau de Dakar ont eu l’honneur d’être accueillis par M. Ibrahim Théo LAM, fondateur de l’Ecole Supérieure de Développement du Leadership. L’homme d’affaires, entrepreneur et écrivain a entretenu les membres du bureau de Dakar sur la contribution de la jeunesse dans le leadership et l’amélioration des affaires en Afrique.
L’Afrique a ce qu’il faut pour relever les défis économiques et sociaux !
Un constat général pour débuter. Dans un langage engagé, M.LAM a commencé par soulever le fait que l’Afrique n’a pas à pâlir de sa situation en matière de ressources pour son développement.
En effet, le continent dispose de la plupart des ressources naturelles de la planète : 97% des réserves mondiales de cuivre, 80% de celles de coltan, 57% de celle d’or, 23% de celles d’uranium et phosphates, 32% de celles de manganèse, 41% de celles de vanadium, 49% de celles de platine, 60% de celles de diamants, 14% de celles de pétrole…En termes d’agriculture, l’Afrique possède de vastes terres fertiles de forêts.
Malgré ce potentiel énorme, la plupart de ces ressources reste sous-exploitées et majoritairement cédées à des entreprises étrangères, ce qui crée une énorme dépendance de l’extérieur. Ce constat est d’autant plus vrai pour ce qui concerne l’alimentation. En Afrique subsaharienne par exemple, 24 % des céréales consommées localement en 2014-16 étaient importées et cette proportion devrait passer à 27 % au cours de la période de projection, de 2017 à 2026.[1]
Ce constat sera toujours le même temps que les autorités ne mettront pas en place de vraies politiques sectorielles, en vue de réduire le gap en matière d’infrastructures (agricoles, énergétiques, transport…) et favoriser la production et la consommation locale.
Une contribution de la jeunesse au développement économique peu valorisée
La jeunesse Africaine se trouve au cœur de toutes les rencontres et sommets sur le développement de l’Afrique. Selon M. LAM, en plus de contribution intellectuelle, le Jeune Africain apporte des solutions concrètes et originales aux problèmes de développement dont il faut tenir compte.
Les jeunes représentent près de 30% de la population mondiale. En Afrique de l’Ouest comme en Afrique centrale, les moins de 25 ans représentent plus de 60% de la population[2]. Cette population peut constituer une opportunité si les politiques actuelles tiennent compte de leurs aspirations et problèmes. Ceci devrait passer par un renforcement du rôle de la jeunesse dans la promotion du développement économique et social de nos Etats.
Il faudrait davantage de cadres visant à promouvoir le dialogue entre la jeunesse et les autorités à tous les niveaux, et des mécanismes leur permettant d’accéder à l’information et d’exprimer leur point de vue sur les décisions de politiques publiques.
Une inadéquation des formations face aux besoins du marché du travail
Concernant le marché du travail et l’insertion professionnelle des jeunes, l’intervenant a relevé l’inadéquation de l’offre de formations actuelle avec les besoins réels du marché de l’emploi. Pour lui, les écoles Africaines ne préparent pas assez les étudiants aux réalités et aux comportements à avoir dans le milieu professionnel. C’est ce constat qui l’a amené à proposer une alternative : l’Ecole Supérieure de Développement du Leadership[3].
Cette école se veut être une plateforme de transformation pour un changement social. Le modèle développé permet aux étudiants d’être acteurs de leurs formations. Avec une pédagogie active et alternative, et une faculté de professionnels, l’ESDL prépare de jeunes leaders aptes à promouvoir une renaissance africaine.
Entreprendre en Afrique : entre contraintes environnementales et pressions sociales
Dans son intervention, M. LAM a aussi partagé la vision qu’il se fait de l’environnement des affaires en Afrique de l’Ouest, région qu’il connait bien.
M. LAM a mis un point d’orgue sur le fait que l’entrepreneur en Afrique fait face à plusieurs contraintes. En plus du cadre des affaires contraignant, le jeune entrepreneur Ouest-Africain fait face à des pressions sociales non négligeables et évolue dans un environnement qui ne favorise pas « l’essayage ». L’intervenant a donc exprimé la nécessité d’encourager les jeunes à entreprendre en les poussant à se découvrir eux même et en valorisant leurs initiatives.
En conclusion, M. LAM exhorte la jeunesse à faire le pari du leadership et prendre le courage de s’engager dans la politique. Les défis sont grands et la jeunesse a toute sa place dans les instances de décisions publiques.
L’Afrique des Idées – Dakar
[1] Rapport de Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), Juillet 2017
[2] Banque Mondiale, 2017
Potential, policies, financing and de-risking in Renewable Energy sector in Africa
 600 million Africans have no access to electricity while the energy sources, especially renewable energies (RE) abound on the continent. Its key features: environment friendly, availability and its recent cost competitiveness gains over fossil energy; make renewable energy an excellent avenue to start an energy revolution in African. However, having affordable, sustainable and smooth access to energy has a cost. Public policy in investments promotion and risk mitigation in the RE sector are among other issues on which African Government should work on.
600 million Africans have no access to electricity while the energy sources, especially renewable energies (RE) abound on the continent. Its key features: environment friendly, availability and its recent cost competitiveness gains over fossil energy; make renewable energy an excellent avenue to start an energy revolution in African. However, having affordable, sustainable and smooth access to energy has a cost. Public policy in investments promotion and risk mitigation in the RE sector are among other issues on which African Government should work on.
This study evaluates the potential of the continent in terms of renewable energy source, assesses the investment needs in light of the renewable energy targets of African countries and presents a set of recommandations to ensure these could be reached. Read the full note.
Rencontre avec le Professeur Nicaise Médé
 Le Samedi 5 Août 2017, s’est tenue sur le campus d’Abomey Calavi une rencontre d’échanges du Cercle de réflexion l’Afrique des Idées, think tank indépendant sur le thème des compétences nécessaires pour un Bénin Emergent. Sous l’égide du Professeur Nicaise Mede, Agrégé des Facultés de droit, Directeur du Centre d’Étude sur l’Administration et les Finances (CERAF), la rencontre s’est articulée autour des défis démographiques du continent de façon générale, l’insertion professionnelle ainsi que l’empreinte de l’afro responsabilité dans les approches de solutions de façon spécifique.
Le Samedi 5 Août 2017, s’est tenue sur le campus d’Abomey Calavi une rencontre d’échanges du Cercle de réflexion l’Afrique des Idées, think tank indépendant sur le thème des compétences nécessaires pour un Bénin Emergent. Sous l’égide du Professeur Nicaise Mede, Agrégé des Facultés de droit, Directeur du Centre d’Étude sur l’Administration et les Finances (CERAF), la rencontre s’est articulée autour des défis démographiques du continent de façon générale, l’insertion professionnelle ainsi que l’empreinte de l’afro responsabilité dans les approches de solutions de façon spécifique.
Des chiffres qui peignent un tableau pessimiste
D’après une étude conjointe conduite par l’Organisation des Migrations Internationales (OMI et la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA), on estime à 20.000 cadres compétents qui quittent chaque année l’Afrique pour s’installer dans les pays occidentaux, où ils sont susceptibles d’obtenir des situations professionnelles plus avantageuses. Cette forte migration, toutes causes confondues, prive doublement le continent de ressources valides pour contribuer à son développement de même qu’à la formation des générations futures . Dans “le camp des Saints”, Jean Raspail décrit telle une prémonition, comment les populations du Tiers-Monde envahissent pacifiquement l’Occident pour y retrouver l’espérance; rappelle Léonide Sinsin, chercheur et co-conférencier.
Malgré cette exode massive, le taux d’accroissement naturel de l’Afrique demeure le plus élevé. Au Sénégal, ce sont environ 200 000 jeunes diplômés qui arrivent sur le marché de l’emploi chaque année augmentant de facto le rapport de dépendance entre la population active et la population non active. Comme l’a souligné le Professeur Mede “il y a plus de bouches à nourrir que de personnes actives; ce qui fait que nous nous reproduisons plus que nous ne créons de la richesse ”. Le rapport de dépendance (rapport entre l’effectif de la population d’âges généralement actifs et l’effectif de la population en âge de travailler, il se calcule comme le quotient entre l’effectif des moins de 15 ans et des 65 ans ou plus par celui des 15-64 ans) au plan mondial est de 52%. En Afrique sub-saharienne, il connaît une croissance vertigineuse allant jusqu’à 94% pour le Bénin, et atteignant 120% pour le Niger seul. Avec un taux d’accroissement naturel estimé à 2.5% l’an et un chômage juvénile moyen de 60%, le rapport de dépendance apparaît donc comme un seuil critique. Il permet néanmoins de mettre en exergue la problématique du concept de capital humain, qui correspond à l’idée d’une population adéquatement formée et qui occupe des emplois qui leur assurent de bonnes conditions de vie et leur offre la capacité de contribuer au développement économique de leurs pays[5], est donc insuffisamment exploité en Afrique[6]. Le développement du capital humain, c’est-à-dire d’une population active compétente, est donc un enjeu majeur pour les pays africains en ce qu’il constitue « un élément essentiel de la croissance, car les avantages associés sont liés aux modifications de la structure de l’emploi (amélioration de l’employabilité de la population active) »[7].
L’inadéquation du capital humain face aux besoins du marché
La constitution du capital humain pour le développement du Bénin et de l’Afrique en général se pose alors avec acuité lorsque l’on prend conscience de la responsabilité des pays africains dans la création du fossé entre l’emploi des jeunes et les opportunités économiques. Sur la question de l’insertion professionnelle, les intervenants n’ont pas manqué de rappeler l’inadéquation entre la multitude de formations existantes et les besoins du marché. En effet, l’Afrique compte 1 ingénieur pour 10 000 habitants, pendant que la France en compte 36 pour 10 000 habitants. La Chine, formerait chaque année un million d’ingénieurs aussi bien dédié pour les besoins du pays qu’à l’export. En Afrique, pour une population d’un million d’habitants, 169 chercheurs sont formés. Pour la même population en Asie, on obtient 742 chercheurs, 2.728 en Europe et 4.654 en Amérique du Nord. Dans un contexte local, à l’Université d’Abomey-Calavi, la plus grande université publique du pays, notamment, 566 étudiants étaient inscrits en licence d’Audit et Contrôle de Gestion pour l’année 2015-2016, 223 inscrits en Histoire et Archéologie et 175 en Français et langue étrangère. Dans la même année, seulement 118 étudiants étaient inscrits en Mathématiques, 18 en Génétique et en Hydrologie et 6 en Statistiques et Econométrie. Pour un pays qui a des problèmes fondamentaux à assurer l’accès à l’eau potable et l’assainissement de ces villes, il semble être pour les jeunes étudiants plus intéressants d’être un contrôleur de gestion que d’être un spécialiste de l’eau.
Pour atteindre les Objectifs du Développement Durable, il faudrait que le continent forme environ 2.5 millions d’ingénieurs chaque année pour amorcer une croissance durable. Ainsi, pour faire face aux urgences de l’heure, les assistances techniques sont légion dans bon nombre de pays africains. D’après le CNUCED, elles représentent un marché de plus de 4 milliard USD des pays d’Afrique vers les pays Occidentaux; et peuvent être perçus à juste titre, soit comme une fuite des capitaux, ou un manque à gagner dans l’investissement dans l’éducation et les ressources opérationnelles.
L’afro responsabilité comme concept ?
En 2050, les estimations convergent sur le fait que la population africaine représenterait le quart de la population mondiale avec 2.5 milliard d’habitants, avec le Nigéria fort de 400 millions d’habitants et le Bénin autour de 22 millions d’habitants. Il revient aux pays africains d’investir massivement dans l’innovation et l’éducation. Le Rwanda, par exemple, a misé sur l’économie du savoir comme plan décennal. Au Bénin, le Président Patrice Talon, à travers son Programme d’Actions Gouvernementales (PAG), veut inscrire le Bénin dans une économie de transformation structurelle profonde. Un des piliers de ce programme est la Cité Internationale de l’Innovation et du Savoir (CIIS), véritable prise de conscience du secteur de l’éducation et de la recherche appliquée.
Un second levier repose sur la consolidation du système éducatif à travers la refonte de la carte scolaire et les formations en alternance. Plusieurs réformes sont nécessaires dès la base (introduction de l’anglais dès le bas âge, le développement durable, etc..), en passant par le secondaire et la formation professionnelle (les conditions d’orientation des élèves vers le second cycle et la formation professionnelle doivent prendre en compte les besoins en matière de filière scientifique et technique pour le marché de l’emploi et l’université), pour arriver à l’enseignement supérieur (avec la redéfinition de la carte universitaire, la création de la CIIS ou celle des Instituts universitaires d’enseignement professionnel (IUEP) pour l’orientation des bacheliers vers des filières de formation de courte durée).La création des IUEP est suffisamment intéressante pour que l’on s’y attarde car elle augure d’une meilleure adéquation entre la formation et les besoins techniques du marché de l’emploi. De plus, elle permet à l’Etat béninois d’orienter ses ressources affectées au secteur de l’éducation vers des filières de formation favorisant à terme le développement des secteurs prioritaires pour l’économie tels que le tourisme, les services et le numérique, ou encore l’agriculture. Cela implique de même une meilleure allocation des ressources à l’endroit des universités publiques et une meilleure définition des profils et priorités afin de lutter contre la massification des effectifs, d’éviter le sous-financement de la recherche et de renforcer la prise en compte par le monde universitaire des réalités du monde économique.
Enfin, le dernier pilier est la promotion de l’excellence à travers l’octroi de bourses et accompagnements dans des processus indépendants, transparents et basés sur la méritocratie. Par un décret n°2017-155 du 10 mars 2017 portant critères d’attribution des allocations d’études universitaires, il a ainsi été défini de nouvelles conditions pour favoriser la lutte contre la fuite des cerveaux. En effet, le constat amer qui se faisait était que les meilleurs bacheliers du Bénin, qui recevaient des bourses gouvernementales pour continuer leurs études dans des universités occidentales ne revenaient pas après l’obtention de leurs diplômes pour servir le pays. Désormais, suivant les dispositions du décret précité, il est fait obligation à tout récipiendaire d’une bourse d’excellence du gouvernement béninois, de revenir servir l’Etat à la fin de sa formation sous peine de restitution des ressources dépensées pour le boursier. Même si certaines mesures de contraintes gagneraient à être davantage précisés (dans quelles conditions revenir servir l’Etat, servir dans la fonction publique ou privée, clauses libératoires de l’obligation de servir, etc.), ceci constitue déjà une avancée majeure pouvant permettre au pays de constituer un vivier de compétences ayant reçu des formations de pointe à l’étranger et s’engageant à rentrer pour contribuer au développement de la nation.
Somme toute, en citant Nelson Mandela “ l’éducation est l’arme la plus puissante qu’on puisse utiliser pour changer le monde”, le Prof. Mede a exhorté les Etats africains à plus d’engagements en faveur de politiques publiques favorables au capital humain. Ce défi, qui ne peut être national, doit aussi être porté par les institutions internationales et sous régionales, telles que la BAD, la CEDEAO, dans leurs agendas périodiques. Cette question des compétences est lancinante dans le pays, où les efforts de l’Etat ont été vains dans le domaine de la recherche et de l’éducation de masse. Des réformes profondes accompagnées de mesures incitatives doivent être menées pour renforcer la confiance de la jeunesse en l’éducation de qualité, qu’elle soit longue ou de courte durée, professionnelle ou orientée vers la recherche. Cette jeunesse formée, qualifiée et motivée servira inexorablement de tremplin pour l’émergence d’une économie telle que voulue par les dirigeants, orientée vers les services afin de faire du Bénin notamment, le quartier numérique de l’Afrique de l’Ouest.
L’Afrique des Idées – Bénin
[1]
[2] Investisseurs et Partenaires, « Le Poids démographique de l’Afrique en 2050 », 2015 http://bit.ly/2g7NVKY
[3] Henri Leridon, « Afrique subsaharienne : une transition démographique explosive », Futuribles, 2015, http://bit.ly/2v8HX35
[4] Avec une économie essentiellement extractive et d’exportation, les pays africains n’arrivent pas à créer des industries qui permettraient de transformer les matières premières sur leur territoire afin d’employer les jeunes africains. De plus, ces pays comptent beaucoup plus sur les travailleurs étrangers pour conduire les grandes réalisations en raison du défaut d’adéquation entre la formation et l’emploi sur le continent. Voir Le Monde, « Pourquoi la croissance économique africaine ne crée-t-elle pas plus d’emplois ? », 2015, http://lemde.fr/2isU9Wn
[5] Guillard Alexandre, Roussel Josse, « Le capital humain en gestion des ressources humaines : éclairages sur le succès d’un concept », Management & Avenir, 2010/1 (n° 31), p. 160-181. DOI : 10.3917/mav.031.0160. http://bit.ly/2itjT5a
[6] Banque Africaine de Développement, « Le capital humain est crucial pour la transformation structurelle de l’Afrique », 2011, http://bit.ly/2irOikd
[7] Ibid. Propos de Henri Sackey lors de la communication « Développement du capital humain en Afrique: agents, facteurs et incidences sur la croissance et la transformation structurelle ».
[8] Banque africaine de développement, « L’Afrique dans 50 ans, vers une croissance inclusive », 2011, http://bit.ly/2g87iDr
L’impact de la société civile sur le développement : l’exemple du Cameroun
 De nombreux pays africains ont eu des difficultés à atteindre leurs Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD). L’amélioration de la gestion de l’aide internationale, passant par une participation accrue de la société civile, était alors au cœur des débats.
De nombreux pays africains ont eu des difficultés à atteindre leurs Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD). L’amélioration de la gestion de l’aide internationale, passant par une participation accrue de la société civile, était alors au cœur des débats.
Alors que les gouvernements du monde entier se sont engagés à atteindre les nouveaux Objectifs du Développement Durable avant 2030, la société civile pourrait jouer un rôle décisif dans leur réussite. L’ampleur de ce rôle et ses conditions d’effectivité sont analysées dans cette étude qui aboutit sur des recommandations concrètes en matière de politiques publiques. Lisez l’intégralité de ce Policy Brief.
La Démocratie culturelle comme rempart contre l’exclusion dans les sociétés multiculturelles : le cas de la Ville du Cap
 L’effectivité du principe démocratique selon lequel chaque voix compte peut s’avérer complexe dans un environnement multiculturel où des minorités peuvent être exclues. A partir de l’exemple de la ville du Cap en Afrique du Sud, cette étude montre comment la démocratie culturelle, c’est-à-dire un système politique où chacun est libre d’affirmer ses positions, son identité et sa culture par des moyens d’expression et des manifestations culturelles, peut être une solution à l’inclusion politique dans un environnement multiculturel. Les enseignements qui en découlent peuvent être utiles aux pays africains multiethniques. Lisez l’intégralité de ce Policy Brief.
L’effectivité du principe démocratique selon lequel chaque voix compte peut s’avérer complexe dans un environnement multiculturel où des minorités peuvent être exclues. A partir de l’exemple de la ville du Cap en Afrique du Sud, cette étude montre comment la démocratie culturelle, c’est-à-dire un système politique où chacun est libre d’affirmer ses positions, son identité et sa culture par des moyens d’expression et des manifestations culturelles, peut être une solution à l’inclusion politique dans un environnement multiculturel. Les enseignements qui en découlent peuvent être utiles aux pays africains multiethniques. Lisez l’intégralité de ce Policy Brief.
Les nouveaux défis de la santé en Afrique, quel rôle pour le numérique? – Livre blanc de la conférence annuelle 2017 de l’ADI
Dans un environnement d’extrême pauvreté, la maladie fait partie des principaux risques auxquels est confronté une part importante de la population africaine,[1] et ce, malgré des progrès significatifs enregistrés au cours des quinze dernières années. Selon les statistiques de l’OMS, l’espérance de vie à la naissance est ainsi passée de 44 ans en 2000 à 53 ans en 2015, soit une augmentation de 9 années.[2] Cependant, l’émergence économique de l’Afrique s’accompagne d’une augmentation de la prévalence des maladies chroniques[3] imputable aux nouveaux modes de vie et de consommation.[4] De même, l’explosion démographique, avec la concentration urbaine qui l’accompagne, augmente les risques d’épidémies, notamment de maladies infectieuses.[5]
Face à ces nouveaux facteurs de risque, l’Afrique accuse encore un retard en matière de politiques de santé, d’équipements, de personnels et de traitements. Par exemple, le nombre de médecins pour 1000 habitants a seulement cru de 0,1 point entre 1990 et 2011 en Afrique subsaharienne contre 0,9 point en zone Euro et 0,8 point dans l’OCDE.[6] Alors que les politiques publiques ont été principalement axées autour de la lutte contre le VIH-SIDA, n’est-il pas temps qu’elles intègrent les nouveaux défis en matière de santé auxquels les pays africains doivent se confronter ?
Pour répondre à cette question, L’Afrique des Idées organise sa 3ème Conférence Annuelle afin d’identifier les nouveaux défis en matière de santé en Afrique, de discuter des causes et de formuler des recommandations. Retrouvez les conclusions de ces échanges dans le livre blanc de la conférence.
[1] Selon les résultats de l’enquête Afrobaromètre de 2014/2015, la moitié des africains ont déjà renoncé à des soins de santé faute de moyens.
[2] Voir données OMS.
[3] Diabète, cancer, maladies cardio-vasculaires et respiratoires, etc.
[4] Le taux de prévalence des maladies chroniques non transmissibles est passé de 18,7% à 25% entre 1990 et 2000. BOUTAYEB A. “The Double Burden of Communicable and Non-Communicable Diseases in Developing Countries”. Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene, 100, 2006, pp 191-199.
[5] Selon l’OMS, la plus longue et plus grave épidémie à virus Ebola a été enregistrée en Afrique de l’Ouest en 2014, avec plus de 150 cas recensés chaque semaine.
[6] Le nombre de médecins pour 1000 habitants est passé de 0,1 à 0,2 en Afrique subsaharienne entre 1990 et 2011 alors qu’il est passé de 3 à 3,9 en zone Euro et de 2 à 2,8 dans les pays de l’OCDE sur la même période. Données Banque Mondiale : http://data.worldbank.org/indicator/SH.MED.PHYS.ZS
South Sudan’s existential fiscal crisis and possible remedies
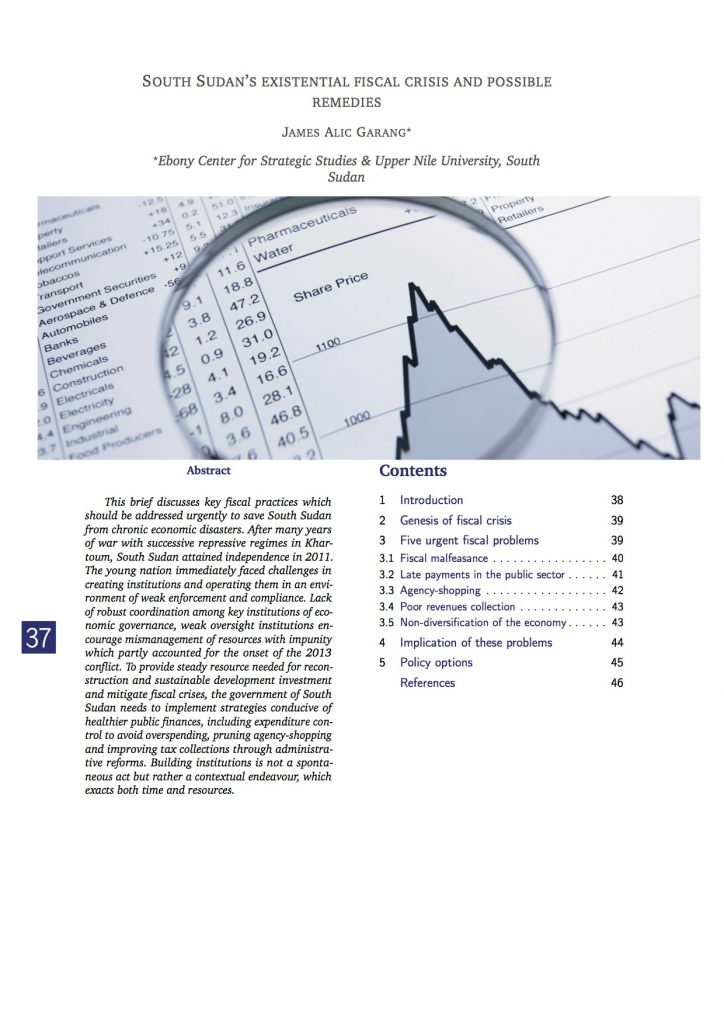 This brief discusses key fiscal practices which should be addressed urgently to save South Sudan from chronic economic disasters. After many years of war with successive repressive regimes in Khartoum, South Sudan attained independence in 2011. The young nation immediately faced challenges in creating institutions and operating them in an environment of weak enforcement and compliance.
This brief discusses key fiscal practices which should be addressed urgently to save South Sudan from chronic economic disasters. After many years of war with successive repressive regimes in Khartoum, South Sudan attained independence in 2011. The young nation immediately faced challenges in creating institutions and operating them in an environment of weak enforcement and compliance.
Lack of robust coordination among key institutions of economic governance, weak oversight institutions encourage mismanagement of resources with impunity which partly accounted for the onset of the 2013 conflict. To provide steady resource needed for reconstruction and sustainable development investment and mitigate fiscal crises, the government of South Sudan needs to implement strategies conducive of healthier public finances, including expenditure control to avoid overspending, pruning agency-shopping and improving tax collections through administrative reforms. Building institutions is not a spontaneous act but rather a contextual endeavour, which exacts both time and resources. Read the full Policy Brief.
