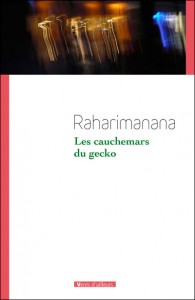 Voici un livre qui ravira tous ceux qui apprécient de se retrouver dans un livre comme dans un laboratoire où l'on voit l'artiste à l'oeuvre : il cisèle les mots, il les perfore pour en tirer le suc qui donnera du goût et du sens au discours ! Même si l'on peut déplorer la "prétention des mots à délimiter le réel" (page 101), il n'en demeure pas moins que ceux-ci constituent notre principal outil pour dire les choses, pour "nommer le monde", comme l'affirme Sony Labou Tansi que Raharimanana cite bien à propos au début de son livre : "Nommer le monde / Avec moi remplir chaque / Chose de la douce aventure / De nommer".
Voici un livre qui ravira tous ceux qui apprécient de se retrouver dans un livre comme dans un laboratoire où l'on voit l'artiste à l'oeuvre : il cisèle les mots, il les perfore pour en tirer le suc qui donnera du goût et du sens au discours ! Même si l'on peut déplorer la "prétention des mots à délimiter le réel" (page 101), il n'en demeure pas moins que ceux-ci constituent notre principal outil pour dire les choses, pour "nommer le monde", comme l'affirme Sony Labou Tansi que Raharimanana cite bien à propos au début de son livre : "Nommer le monde / Avec moi remplir chaque / Chose de la douce aventure / De nommer".
Comme Sony Labou Tansi, Raharimanana nous embarque dans son livre dans la "douce aventure de nommer". Oui, c'est bien doux et agréable pour le lecteur d'entrer dans l'univers de cet auteur pour y assiter comme à un feu d'artifice du langage ! Je crois en effet que le mot n'est pas exagéré : les mots, dans Les cauchemars du gecko, éclatent en mille sons et en tous sens, ils invitent d'une manière ludique à réfléchir, à penser le monde, à panser les maux dont il souffre. Les jeux de mots dans ce livre sont si délectables que je me prends au jeu ! C'est un texte qu'on a envie de mettre en musique, certains passages vous inspirent même des airs de rap.
Vous aurez remarqué que, depuis le début, je ne le désigne que par les termes génériques de "livre" ou d' "ouvrage", car on ne saurait le faire entrer dans une catégorie : ce n'est pas un roman, ce n'est pas un essai, je pense que ce n'est pas non plus un recueil de poèmes, même si on brûle de le considérer comme une oeuvre poétique. En fait ce livre emprunte à chacun de ces genres : il y a un narrateur, comme dans le roman, un "je" qui s'adresse à "vous", et qui se positionne par rapport à la situation actuelle du monde, en particulier les relations nord-sud, dont il dénonce les travers. C'est un positionnement propre aux essais, cependant il l'exprime de manière poétique, en exploitant à volonté les multiples possibilités d'agencement des mots, de sorte que ceux-ci produisent une musique qui éclaire le propos d'une manière subtile. Rahiramana ne souhaite pas s'enfermer dans une catégorie, il veut être libre de voler avec les mots où bon leur semble, d'éprouver avec eux le vertige :
Ecrire 1./ Territoires d'écriture la nuit quand l'espace s'étire et que les limites se font floues, quand le regard s'efface et quand du silence des cris qu'on égorge se recrée le monde. Dans les pas du hasard souvent pour y semer ma déraison et y tisser un récit où m'étendre, me méfier de la narration et me dire sans lien aux mots qui m'aliènent, sortir du silence et exister le temps d'une scansion, d'un mouvement, d'un souffle, territoires tenus sur un fil, le temps de me faire funambule, le vide autour pour me transfigurer… (Les Cauchemars du gecko, page 96)
C'est une "douce aventure" que celle de nommer, sans doute, mais c'est pour dire combien le monde va mal. Raharimanana se propose dans ce livre de dénoncer "l'incapacité de l'homme à n'être pas homme pour l'homme" (page 6), il se présente comme "l'étranger qui contredit la belle affaire de l'humanité" (page 7). L'homme a de beaux discours, de belles paroles, de beaux principes, mais qu'il foule aux pieds chaque jour par ses actes. C'est cette hypocrisie que l'auteur montre du doigt, cet orgueil mal placé de celui qui se place au-dessus des autres mais qui, dans le fond, n'est pas meilleur que ceux-là qu'il dénigre. L'Occident, en particulier, est placé dans ce livre face à un miroir :
Tu te dis bonne France.
As-tu jamais existé ?
Code noir, code de l'indigénat,
T'en souviens-tu ou préfères-tu l'oubli ?
Je sais que tu rôdes encore – tu m'encordes !
De l'esclavage à la colonisation,
Tu as toujours préféré le sucre à l'honneur.
Tu as glorifié l'arachide, humilié les Rachid, ri des Farid ou des Farah.
Le goût à la bouche, le dégoût au coeur,
Tu as fait ripaille de mon corps esclave :
indigène, tirailleur et maintenant racaille.
Des cales à la cave
Des cases aux squats
J'ai tout connu, j'ai tout vécu.
(page 29)
 Le mal-être du monde que Raharimanana peint dans son livre est parfaitement résumé dans le chapitre "La connerie des siècles", où il est question entre autres de "dictature et népotisme", de "guerre froide", de "famine", de "corruption", de "pauvreté", de "paradis fiscaux", de "cannibalisation des terres pour les damnés de la terre", de l'Afrique "terre de barbarie, pour paradis capitaliste" etc. (page 46)
Le mal-être du monde que Raharimanana peint dans son livre est parfaitement résumé dans le chapitre "La connerie des siècles", où il est question entre autres de "dictature et népotisme", de "guerre froide", de "famine", de "corruption", de "pauvreté", de "paradis fiscaux", de "cannibalisation des terres pour les damnés de la terre", de l'Afrique "terre de barbarie, pour paradis capitaliste" etc. (page 46)
Les exemples et les situations évoquées dont diversifiés et dénotent une bonne connaissance de la part de l'auteur de l'histoire des pays africains, mais aussi du monde. Si l'homme blanc est particulièrement interpellé,
L'hôomme développelé occidenté blanchinordé,
L'hôomme évolué cervelisé scientifriqué,
Athée devant l'Athérnel,
Laïc devant l'aïd et tout autre laïus et coutumes
(page 48)
si, disais-je, il apparaît comme le principal accusé, c'est parce que c'est lui en général s'aroge le droit de catégoriser, de classer les humains, de déterminer parmi ceux-ci l'intelligent, le nul, le diable, le bon, le beau… Dans cette classification, l'homme noir a le meilleur lot, autrement dit on lui plaque sur le dos tout ce qu'il y a de pire, tandis que le Blanc se pare d'une aura divine. Raharimanana plaint cette tendance à diviser les hommes, à les dresser les uns contre les autres, alors que la "connerie" est partout, comme le montre le chapitre "Voyez nos fous !" (page 53), qui énumère les dictatures, dans tous les continents, passés comme présents, d'Idi Amin Dada à Vladimir Poutine en passant par Denis Sassou Ngesso, de Joseph Pétain à Adolf Hitler, de Mussolini à Kim Il Sung-ju, de John Fitzgerald Kennedy à Charles Taylor… ce sont des dizaines et des dizaines de dirigeants politiques qui sont cités, sous la "haute bienveillance de Caligula", cet empereur romain, fou de pouvoir.
Raharimanana n'a nullement l'intention d'attiser la haine envers qui que ce soit, surtout pas envers le blanc. Les vers du poète martiniquais Aimé Césaire, qui déclare dans son Cahier d'un retour au pays natal : "Ne faites pas de moi cet homme de haine pour qui je n'ai que haine", conviendraient bien pour répondre à quiconque ferait de ce livre une mauvaise lecture. Raharimanana met lui-même les points sur les i : […] la dent que j'ai contre personne, les races n'existent pas, nous sommes tous les mêmes êtres humains, même droits, mêmes prérogatives, mêmes victimes, même bourreaux… (page 87) D'ailleurs, si le "je" du narrateur commence au début du texte par interpeller l'homme blanc par un "vous" qui établit bien la distance qui les sépare, cette distance s'efface à la fin du livre puisque le-dit narrateur s'autorise, tout à la fin, à lui dire "tu", et à le laver de toute culpabilité : "Lavé du passé (…) Lavé de toute responsabilité" (page 108). C'est comme si, après avoir laissé libre cours à la lave de son verbe, son coeur s'était apaisé, ce coeur qui ne bat que pour la réconciliation de l'humanité toute entière.
Raharimana est né en 1967 à Antananarivo. Il a été journaliste, professeur de Français avant de se consacrer entièrement à la littérature. J'ai eu la chance de le rencontrer à la soirée littéraire Africa Paris du 28 avril 2011, il y a un an, mais alors j'étais loin de soupçonner la force de frappe de son verbe : coloré, malicieux, libre, tranchant aussi.
Liss Kihindou, article initialement paru sur son blog
La critique de Gangoueus ici.
Raharimanana, Les cauchemars du gecko, Editions Vents d'ailleurs, 2011, 114 pages, 15 €.
 De gauche à droite : Jean-Luc Raharimanana, Bernard Magnier, Lareus Gangoueus, Yahia Belaskri
De gauche à droite : Jean-Luc Raharimanana, Bernard Magnier, Lareus Gangoueus, Yahia Belaskri





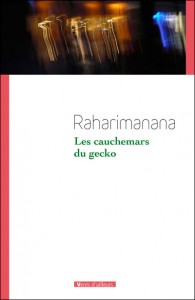

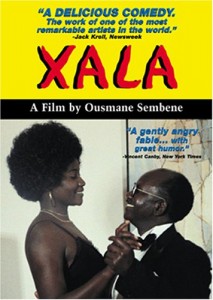



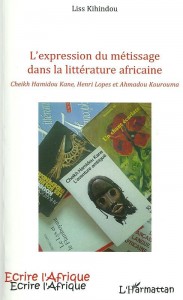
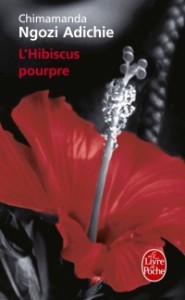


 Plutôt que de se caresser le nombril, la narratrice conte des destins de femmes qu'elle a croisée dans la rue, dans le métro, dans des foyers pour femmes, dans sa famille… Et c'est ce regard très intime, très fort qui porte ce roman magnifique où au fil des rencontres sont brossées des portraits de femmes violentées par la société, un compagnon, un père, un corps, portraits de femmes en souffrance et marginalisées. Une violence contenue que la rencontre va révéler et permettre une nouvelle approche, ou, tout simplement un retour arrière après la vision d'une crane explosée de la femme plume, un regard triste sur ces batailles qu'elle n'avait plus la force de porter seule.
Plutôt que de se caresser le nombril, la narratrice conte des destins de femmes qu'elle a croisée dans la rue, dans le métro, dans des foyers pour femmes, dans sa famille… Et c'est ce regard très intime, très fort qui porte ce roman magnifique où au fil des rencontres sont brossées des portraits de femmes violentées par la société, un compagnon, un père, un corps, portraits de femmes en souffrance et marginalisées. Une violence contenue que la rencontre va révéler et permettre une nouvelle approche, ou, tout simplement un retour arrière après la vision d'une crane explosée de la femme plume, un regard triste sur ces batailles qu'elle n'avait plus la force de porter seule.

