 La fin de l’année est souvent une période propice pour dresser des bilans et prendre de bonnes résolutions, en prenant en considération ses faiblesses et ses fautes pour ne pas les répéter. Au delà d’un passage à une nouvelle année, les fins de décennies ont, par une étrange coïncidence de l’histoire, plus tendance à constituer des ruptures que d’autres. 2009 n’aura pas échappée à cette règle, puisqu’elle sembler clôturer un cycle qui a été entamée avec le mémorable Millenium il y’a de cela dix ans. Si 1929 a ébranlé la foi dans un progrès et une croissance illimitée, si 1939 a mis fin aux espoirs pacifistes d’une sécurité bâtie sur le dialogue et non plus sur la force, et si 1989 a indéniablement introduit une nouvelle donne dans les affaires du monde, 2009 aura également constitué, à sa manière, une année charnière dans l’histoire universelle. Continue reading « Un bilan de la mondialisation en Afrique: Sommes-nous condamnés au sous-développement? (1ère partie) »
La fin de l’année est souvent une période propice pour dresser des bilans et prendre de bonnes résolutions, en prenant en considération ses faiblesses et ses fautes pour ne pas les répéter. Au delà d’un passage à une nouvelle année, les fins de décennies ont, par une étrange coïncidence de l’histoire, plus tendance à constituer des ruptures que d’autres. 2009 n’aura pas échappée à cette règle, puisqu’elle sembler clôturer un cycle qui a été entamée avec le mémorable Millenium il y’a de cela dix ans. Si 1929 a ébranlé la foi dans un progrès et une croissance illimitée, si 1939 a mis fin aux espoirs pacifistes d’une sécurité bâtie sur le dialogue et non plus sur la force, et si 1989 a indéniablement introduit une nouvelle donne dans les affaires du monde, 2009 aura également constitué, à sa manière, une année charnière dans l’histoire universelle. Continue reading « Un bilan de la mondialisation en Afrique: Sommes-nous condamnés au sous-développement? (1ère partie) »
Étiquette : Afrique des Idées
Interview avec Ernest Mendy sur le scoutisme au Sénégal
 Terangaweb a interviewé Ernest Clément Mendy (26 ans), commissaire national à la branche verte des Scouts du Sénégal (SDS). M. Mendy présente le mouvement Scout lié à l’Eglise et aborde l’intérêt croissant de jeunes musulmans pour le scoutisme. Il évoque aussi la situation socio-économique difficile à laquelle fait face la jeunesse sénégalaise ainsi que l’engagement des jeunes chrétiens en politique.
Terangaweb a interviewé Ernest Clément Mendy (26 ans), commissaire national à la branche verte des Scouts du Sénégal (SDS). M. Mendy présente le mouvement Scout lié à l’Eglise et aborde l’intérêt croissant de jeunes musulmans pour le scoutisme. Il évoque aussi la situation socio-économique difficile à laquelle fait face la jeunesse sénégalaise ainsi que l’engagement des jeunes chrétiens en politique.
Terangaweb : Pouvez-vous expliquer à nos internautes qu’est-ce-que le scoutisme et quel est l’état du mouvement scout aujourd’hui au Sénégal ?
Ernest Mendy : Le Mouvement scout est un mouvement éducatif pour les jeunes, fondé sur le volontariat. Il s’agit d’un mouvement à caractère non politique, ouvert à tous sans distinction de genre, d’origine, de race ni de croyance. Continue reading « Interview avec Ernest Mendy sur le scoutisme au Sénégal »
Réhabiliter l’homme politique en Afrique
 Ces derniers mois ont vu la disparition de deux figures politiques du continent africain : messieurs Omar Bongo, président du Gabon, et Lansana Conté, président de la Guinée Conakry. Ces deux personnages se sont éteints au pouvoir, après des règnes présidentiels de plusieurs décennies. Les média ont amplement souligné, et à juste titre, le piètre bilan, pour utiliser un euphémisme, de ces deux hommes d’Etat. Mais ce qui retiendra notre attention est le renouvellement du pouvoir laissé vacant par ces deux décès. Dans le cas de la Guinée Conakry comme du Gabon, l’impression est que le fruit mûr du pouvoir est tombé dans l’escarcelle de celui qui a su s’en saisir le premier.
Ces derniers mois ont vu la disparition de deux figures politiques du continent africain : messieurs Omar Bongo, président du Gabon, et Lansana Conté, président de la Guinée Conakry. Ces deux personnages se sont éteints au pouvoir, après des règnes présidentiels de plusieurs décennies. Les média ont amplement souligné, et à juste titre, le piètre bilan, pour utiliser un euphémisme, de ces deux hommes d’Etat. Mais ce qui retiendra notre attention est le renouvellement du pouvoir laissé vacant par ces deux décès. Dans le cas de la Guinée Conakry comme du Gabon, l’impression est que le fruit mûr du pouvoir est tombé dans l’escarcelle de celui qui a su s’en saisir le premier.
Le capitaine Dadis Camara, sous les habits de l’homme de troupe populiste et désintéressé, s’est servi du seul pouvoir réellement constitué en Guinée, l’armée, pour mener un coup de force qui lui permis, sans réelle opposition, de prendre la tête de son Etat. Les institutions démocratiques guinéennes, verni de légitimité dont s’était doté Lansana Conté plus pour plaire à l’extérieur qu’à son propre peuple, ont montré leurs limites. Alors même que le pouvoir du comité militaire de Dadis Camara est déjà complètement décrédibilisé suite au massacre du 28 septembre 2009, la contestation n’est réellement portée que par la société civile ; la classe politique, divisée, sans idées, sans réel ancrage populaire, est aux abonnés absents. Continue reading « Réhabiliter l’homme politique en Afrique »
Bilan de 2009 pour le Sénégal: Etat en deliquescene, appauvrissement et frusatration des populations
De l’année 2009 qui vient de s’écouler, que retenir pour le Sénégal si ce n’est que l’Etat y est en déliquescence, que les populations se sont incontestablement appauvries et que la frustration y a touché un seuil jusque là jamais atteint ?
Il n’est guère besoin de s’y attarder, l’Etat au Sénégal est en faillite. Le Président Wade n’incarne même plus un pouvoir qui a déserté un gouvernement pléthorique dont la plupart des ministres sont des pantins, une Assemblée Nationale entre les mains d’un petit groupe de bandits, un Sénat qui ne sert qu’à élargir l’éventail de rente du pouvoir. Dans ce pays, la constitution et les institutions y ont été vidé de leur sens ; le président sent bien venir l’apocalypse et ne pourra sauver ni l’Etat, ni son parti ni même son propre fils. il ne lui reste plus qu’à s’accrocher à son espèce de monument dit de la renaissance africaine qui suscite l’indignation de notre peuple et fait la risée de notre pays dans la presse internationale. On ne peut plus rien attendre d’Abdoulaye Wade sur le plan politique, il a perdu la mesure des choses et son entourage ne l’a jamais suffisamment eue. Continue reading « Bilan de 2009 pour le Sénégal: Etat en deliquescene, appauvrissement et frusatration des populations »
Logos et logocrates (II) : Sarkozy et Obama discourent sur l’Afrique
Interview sur la situation des étudiants sénégalais au Maroc
Le Maroc est connu pour être la seconde patrie des Sénégalais. Ceux-ci sont notamment très nombreux à effectuer leurs études supérieures dans le Royaume chérifien qui constitue, juste derrière la France, la deuxième destination des étudiants sénégalais. Terangaweb est allé à la rencontre de cette forte communauté sénégalaise en interviewant Arame NDAO, Présidente de l’Union Générale des Etudiants et Stagiaires Sénégalais au Maroc (l’UGESM). Avec une pertinence et un sens de la formule remarquables, elle aborde la situation, souvent difficile et généralement méconnue, des étudiants sénégalais au Maroc. Un entretien qui vaut sans nul doute plus qu’un simple détour !
Terangaweb : Pouvez-vous présenter aux internautes de Terangaweb l’association que vous dirigez ?
Arame NDAO : Permettez-moi tout d’abord de me réjouir de l’intérêt que vous portez à notre association. L’Union Générale des Etudiants et Stagiaires Sénégalais au Maroc (l’UGESM) est une association qui, comme son nom l’indique, regroupe tout élève, étudiant et stagiaire sénégalais résidant sur toute l’étendue du territoire marocain. Elle a été créée en 1979 par de valeureux étudiants comme j’ai l’habitude de les qualifier. Des étudiants qui avaient senti la nécessité de s’unir, de s’entraider dans un pays avec lequel le Sénégal a pu tisser des relations séculaires et exemplaires.
De 1979 à 2009 l’UGESM n’a cessé de s’agrandir. Elle compte aujourd’hui plus de 1 000 étudiants qui sont aussi bien dans le public que dans le privé. Et avec nos sections qui sont dans presque toutes les villes du Royaume, nous essayons tant bien que mal de hisser la communauté estudiantine sénégalaise au rang des communautés les plus unies et les plus solidaires. Continue reading « Interview sur la situation des étudiants sénégalais au Maroc »
Logos et logocrates (I) : Sarkozy et Obama discourent sur l’Afrique…
Le scribe du Président Français, n’avait pu résister à la tentation de glisser, à intervalles réguliers, de petits signaux, adressés à l’électorat UMP, censés rappeler les « positions de la droite » sur l’Afrique, c’est-à-dire, le salmigondis concocté par les nostalgiques des armées coloniales et les héritiers de Foccart. Pour ce faire, il a alterné références littéraires explicites (Rimbaud, Senghor, Césaire, Camara Laye et Birago Diop entre autres) et sous-bassement philosophique suranné et colonialiste.
Faut-il mettre fin à « l’aide au développement »?
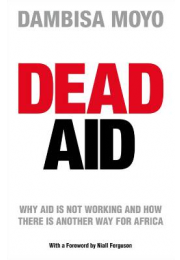 Telle est en substance la question posée dans son livre Dead Aid par Dambisa Moyo. Cette dernière est considérée par les grands médias anglo-saxons comme l’intellectuelle africaine de l’année 2009 ; le Time magazine l’a placé dans son dernier classement des 100 personnalités les plus influentes au monde, et elle est régulièrement invitée sur les plateaux des grandes télévisions internationales comme la BBC ou CNN, pour tout sujet ayant trait à la situation socio-économique africaine. Dambisa Moyo ? Zambienne, économiste titulaire d’un master à Harvard et d’un PhD à Oxford, elle a travaillé à la Banque mondiale ainsi qu’à la célèbre banque d’affaire américaine Goldman & Sachs.
Telle est en substance la question posée dans son livre Dead Aid par Dambisa Moyo. Cette dernière est considérée par les grands médias anglo-saxons comme l’intellectuelle africaine de l’année 2009 ; le Time magazine l’a placé dans son dernier classement des 100 personnalités les plus influentes au monde, et elle est régulièrement invitée sur les plateaux des grandes télévisions internationales comme la BBC ou CNN, pour tout sujet ayant trait à la situation socio-économique africaine. Dambisa Moyo ? Zambienne, économiste titulaire d’un master à Harvard et d’un PhD à Oxford, elle a travaillé à la Banque mondiale ainsi qu’à la célèbre banque d’affaire américaine Goldman & Sachs.
Son constat est le suivant : sur les soixante dernières années, l’Afrique aurait reçu un trillion (1000 milliards) de dollars d’aide au développement de la part des pays développés (une petite partie sous forme de dons, le gros du reste sous forme de prêts à taux censément faibles). Or, la situation économique et sociale du continent africain est toujours dramatique. Elle en tire comme conclusion que cette aide aura été inefficace d’un triple point de vue : économique, social et politique. Continue reading « Faut-il mettre fin à « l’aide au développement »? »
l’ « Affaire Bara Tall »
 Le cas Bara Tall, du nom de l’entrepreneur sénégalais qui dirige le holding Talix International et l’entreprise Jean Lefebvre, mérite l’attention de tous les sénégalais, en particulier celle des jeunes encore plein de rêves pour leur pays. Grosso modo Bara Tall, dont l’entreprise Jean Lefebvre participait, avec une quarantaine d’autres, aux fameux chantiers de Thiès, s’est vu en 2004 accusé de surfacturations et d’intelligence avec l’homme à abattre d’alors Idrissa Seck, en vue de détournement d’argent portant sur des milliards de FCFA. Ces accusations ont valu à Bara Tall un séjour carcéral de deux mois et demi à la prison Rebeuss alors même qu’à ce jour la justice sénégalaise ne reconnait un quelconque fondement aux accusations malhonnêtes et mensongères portées contre sa personne.
Le cas Bara Tall, du nom de l’entrepreneur sénégalais qui dirige le holding Talix International et l’entreprise Jean Lefebvre, mérite l’attention de tous les sénégalais, en particulier celle des jeunes encore plein de rêves pour leur pays. Grosso modo Bara Tall, dont l’entreprise Jean Lefebvre participait, avec une quarantaine d’autres, aux fameux chantiers de Thiès, s’est vu en 2004 accusé de surfacturations et d’intelligence avec l’homme à abattre d’alors Idrissa Seck, en vue de détournement d’argent portant sur des milliards de FCFA. Ces accusations ont valu à Bara Tall un séjour carcéral de deux mois et demi à la prison Rebeuss alors même qu’à ce jour la justice sénégalaise ne reconnait un quelconque fondement aux accusations malhonnêtes et mensongères portées contre sa personne.
On pourrait ne pas s’en émouvoir si l’Etat du Sénégal ne devait pas encore aujourd’hui la rondelette somme de 10 milliards de FCFA à Bara Tall pour les travaux de la route Kaolack-Fatick d’après ses propos tenus la semaine dernière lors d’une interview accordée à la 2STV, propos non démentis par le Ministre des Finances Abdoulaye Diop qui, dans une interview au quotidien Le Soleil, dit attendre une autorisation dans ce sens. Les biens fondés de la réclamation de Bara Tall ne font pas l’objet d’un doute tant la dette est quasiment reconnue par l’Etat du Sénégal par le biais de son argentier Abdoulaye Diop d’une part et d’autre part par l’Assemblée Nationale qui avait voté un budget pour que Bara Tall soit payé et il semblerait que ces montants aient été alloués à Karim Meissa Wade pour la construction de villas dans le cadre du dernier sommet de l’OCI. Continue reading « l’ « Affaire Bara Tall » »
Sénégal : à la recherche d’une politique économique
 Cet article est tiré du blog “Le Sénégal émergent” de l’économiste sénégalais Moubarack LO et publié avec l’autorisation de l’auteur.
Cet article est tiré du blog “Le Sénégal émergent” de l’économiste sénégalais Moubarack LO et publié avec l’autorisation de l’auteur.
Le monde, du fait de la crise financière américaine qui s’est diffusée un peu partout, vit aujourd’hui la pire crise économique de son histoire depuis 1929. Selon l’OCDE (Organisation de Coopération et de Développement Economiques), la récession touchera une grande partie du globe, faisant passer le PIB mondial de 2,2% en 2008 à -2,7% en 2009, soit une chute de près de 5 points de pourcentage. L’Organisation Internationale du Travail prévoit que de 18 à 30 millions de personnes pourraient s’ajouter au nombre de chômeurs dans le monde en 2009. Du jamais vu depuis fort longtemps.L’impact de la crise financière sur l’économie réelle atteint même les pays les moins intégrés au système financier mondial. Selon la BAD (Banque Africaine de Développement), le taux de croissance de l’Afrique sub-saharienne est projeté à 2,4% pour 2009, la première fois en 5 ans qu’il serait en dessous de 5%. L’analyse de la croissance économique des pays africains dans la dernière décennie montre en effet que les pays ayant le mieux réussi ont généralement bénéficié d’une forte aide étrangère, de bons termes d’échanges et d’une forte exportation. Or ce sont ces trois facteurs qui pourraient se détériorer à cause de la crise. Continue reading « Sénégal : à la recherche d’une politique économique »
L’Afrique du Sud ou les immenses défis du développementalisme (1)
 Son nom est Zuma, Jacob Zuma. Il est zoulou, il a 67 ans et vient d’être nommé président de l’Afrique du Sud le 6 mai 2009, conclusion logique de la victoire de l’ANC aux dernières élections législatives, avec 65,9% des voix. Par la grâce de ce scrutin, il est devenu le troisième leader post-apartheid de ce géant d’Afrique sub-saharienne : une population de 48,5 millions d’habitants, une économie qui pèse à elle-seule 45% du PNB de l’Afrique sub-saharienne et un Etat qui siège dans le tout nouveau club des puissants de ce monde, le G20. Un géant aux pieds d’argile toutefois, classé au 125ème rang (sur 179) de l’Indice de Développement Humain du PNUD en 2008, et qui partage avec le Brésil le triste record de pays aux plus fortes inégalités sociales dans le monde.
Son nom est Zuma, Jacob Zuma. Il est zoulou, il a 67 ans et vient d’être nommé président de l’Afrique du Sud le 6 mai 2009, conclusion logique de la victoire de l’ANC aux dernières élections législatives, avec 65,9% des voix. Par la grâce de ce scrutin, il est devenu le troisième leader post-apartheid de ce géant d’Afrique sub-saharienne : une population de 48,5 millions d’habitants, une économie qui pèse à elle-seule 45% du PNB de l’Afrique sub-saharienne et un Etat qui siège dans le tout nouveau club des puissants de ce monde, le G20. Un géant aux pieds d’argile toutefois, classé au 125ème rang (sur 179) de l’Indice de Développement Humain du PNUD en 2008, et qui partage avec le Brésil le triste record de pays aux plus fortes inégalités sociales dans le monde.
Comme ses prédécesseurs Nelson Mandela et Thabo Mbeki, Jacob Zuma est issu des rangs de l’African National Congress (ANC) qui, depuis 1991, fait face à l’immense défi du développement socio-économique. L’élection d’un nouveau président est donc une bonne occasion de juger le bilan gouvernemental de ce parti qui porta les espoirs de tout un peuple, et même de tout un continent. Car de par son poids réel et symbolique, l’Afrique du Sud est à l’avant-garde du mouvement développementaliste africain. Ses succès, et peut-être encore plus ses échecs, se doivent d’être médités. Continue reading « L’Afrique du Sud ou les immenses défis du développementalisme (1) »
On ne change pas une équipe qui perd !
 Au cours du Conseil des ministres du jeudi 30 avril, Hadjibou Soumaré a réitéré au Président Wade sa volonté de quitter ses fonctions de Premier Ministre. Wade, après avoir vraisemblablement essayé de reconduire celui qu’on qualifie de « technocrate », a finalement accepté la démission de Hadjibou Soumaré. Mais le Sénégal n’a pas attendu longtemps pour avoir un nouveau Premier Ministre, en la personne de Souleymane Ndéné Ndiaye. Quel que soit le prisme par lequel on essaie d’analyser cette nomination, on ne peut échapper à ce constat : Wade ne fait que du saupoudrage en reconduisant une équipe qui a échoué dans tous les domaines et en faisant le panégyrique de la défaite et des perdants.
Au cours du Conseil des ministres du jeudi 30 avril, Hadjibou Soumaré a réitéré au Président Wade sa volonté de quitter ses fonctions de Premier Ministre. Wade, après avoir vraisemblablement essayé de reconduire celui qu’on qualifie de « technocrate », a finalement accepté la démission de Hadjibou Soumaré. Mais le Sénégal n’a pas attendu longtemps pour avoir un nouveau Premier Ministre, en la personne de Souleymane Ndéné Ndiaye. Quel que soit le prisme par lequel on essaie d’analyser cette nomination, on ne peut échapper à ce constat : Wade ne fait que du saupoudrage en reconduisant une équipe qui a échoué dans tous les domaines et en faisant le panégyrique de la défaite et des perdants.
Benno Siggil Sénégal : de la contestation à la proposition
 Les élections municipales du 22 mars 2009 ont rappelé aux bons souvenirs de tous la vitalité des institutions démocratiques sénégalaises. Fatigués d’un personnel politique trop confortablement installé au pouvoir autour de la personne du président Wade, les électeurs ont sanctionné l’immobilisme, l’arrogance, la rapacité de leurs édiles locaux, et accessoirement remis en scelle l’opposition républicaine, victorieuse dans la plupart des villes du pays. Pour une fois, cette dernière se présentait en rangs serrés autour d’une large coalition, Benno Siggil Sénégal (BSS), au personnel politique rajeuni. Suffisant pour ramasser le fruit mûr du mécontentement populaire. Mais peut-être pas assez pour offrir aux Sénégalais ce qu’ils sont en droit d’attendre, à savoir un projet politico-économique alternatif crédible, et défendre sérieusement les chances de l’opposition de gauche aux prochaines échéances électorales, dont l’élection présidentielle de 2012.
Les élections municipales du 22 mars 2009 ont rappelé aux bons souvenirs de tous la vitalité des institutions démocratiques sénégalaises. Fatigués d’un personnel politique trop confortablement installé au pouvoir autour de la personne du président Wade, les électeurs ont sanctionné l’immobilisme, l’arrogance, la rapacité de leurs édiles locaux, et accessoirement remis en scelle l’opposition républicaine, victorieuse dans la plupart des villes du pays. Pour une fois, cette dernière se présentait en rangs serrés autour d’une large coalition, Benno Siggil Sénégal (BSS), au personnel politique rajeuni. Suffisant pour ramasser le fruit mûr du mécontentement populaire. Mais peut-être pas assez pour offrir aux Sénégalais ce qu’ils sont en droit d’attendre, à savoir un projet politico-économique alternatif crédible, et défendre sérieusement les chances de l’opposition de gauche aux prochaines échéances électorales, dont l’élection présidentielle de 2012.
La question est donc la suivante : comment la coalition Benno Siggil Sénégal peut-elle passer de la simple contestation à la proposition d’un projet alternatif crédible ?
Continue reading « Benno Siggil Sénégal : de la contestation à la proposition »
L’actualité de la Négritude: être et demeurer métis
 La Négritude est de nos jours trop vite évacuée quand on ne finit pas de reprocher aux écrivains qui en furent les pionniers d’avoir écrit en français. Pourquoi les poètes de la Négritude ont-ils écrit en français? Fut-ce-t-elle un classique, cette question semble la plus à même de laisser transparaitre en l’occurrence l’actualité de la Négritude dont elle révèle d’ailleurs la quintessence.
La Négritude est de nos jours trop vite évacuée quand on ne finit pas de reprocher aux écrivains qui en furent les pionniers d’avoir écrit en français. Pourquoi les poètes de la Négritude ont-ils écrit en français? Fut-ce-t-elle un classique, cette question semble la plus à même de laisser transparaitre en l’occurrence l’actualité de la Négritude dont elle révèle d’ailleurs la quintessence.
Léopold Sédar SENGHOR lui-même répondait à cette question dans la postface d’Ethiopiques[1]
Voici (et on y reviendra) ce qu’en dit le poète de la Négritude et non moins futur membre de la prestigieuse Académie française : « Mais on me posera la question : pourquoi, dès lors, écrivez-vous en français? – Parce que nous sommes des métis culturels… ». Continue reading « L’actualité de la Négritude: être et demeurer métis »
Repose en paix, Boubacar Joseph Ndiaye
 Boubacar Joseph Ndiaye était le conservateur de la maison des esclaves de Gorée. Il est l’une des figures sénégalaises les plus connues dans le monde, notamment des touristes mêmes si des travaux scientifiques sur la traite négrière ont conduit à remettre ses propos passionnés en perspective.
Boubacar Joseph Ndiaye était le conservateur de la maison des esclaves de Gorée. Il est l’une des figures sénégalaises les plus connues dans le monde, notamment des touristes mêmes si des travaux scientifiques sur la traite négrière ont conduit à remettre ses propos passionnés en perspective.
Issu d’une famille d’origine goréenne, Boubacar Joseph Ndiaye est né le 15 Octobre 1922 à Rufisque. Après ses études primaires à Gorée, il entre à l’école professionnelle Pinet-Laprade de Dakar. En 1943 il participe à la guerre avec l’armée française. Il a notamment participé à la bataille du mont Cassin en tant que tirailleurs sénégalais. Depuis 1962 il était le conservateur de la maison des esclaves de Gorée. Il est décédé le 06 février à l’âge de 87 ans à Dakar. Il repose désormais au cimetière de Camberéne.
Vous pouvez voir une petite vidéo sur Joseph Ndiaye en cliquant sur ce lien…
Joseph Ndiaye, conservateur de la maison des esclaves de Gorée
Thierry L. Diouf