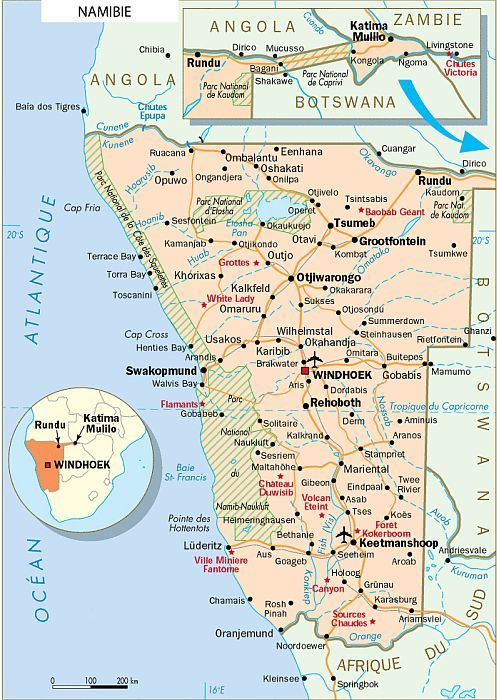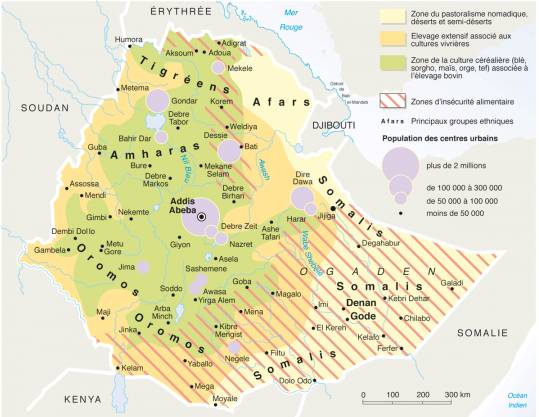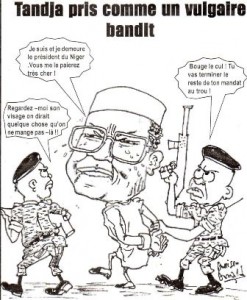Le Global Innovation Index, publié conjointement par l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), Cornel University et l’INSEAD est devenu un classement de référence dans le domaine de l’innovation. Il constitue une source d’information indispensable non seulement pour évaluer la situation, mais aussi pour construire des programmes visant à soutenir l’innovation.
Dans sa septième édition, centrée sur le facteur humain, le rapport s’intéresse plus spécifiquement à l’action des individus et des équipes dans le processus d’innovation, ce qui constitue un défi en raison de la difficulté à appréhender ce phénomène en statistiques. En compilant plus de 80 indicateurs pour 143 pays, le Global Innovation Index offre une image particulièrement intéressante de l’environnement dans lequel évoluent les entreprises, en particulier les startups et les PME.
Sans surprise, les dix pays les mieux classés au monde sont des pays développés dans lesquels les dépenses de recherche et développement sont parmi les plus élevés. On y retrouve les Etats-Unis, le Royaume-Uni, la Suède, les Pays Bas ou la Finlande. On retrouve également dans ce top 10 quelques ilots d’innovation, tels que Singapour ou Hong Kong. L’Allemagne se retrouve au 13ème rang, la France au 22ème rang, alors que le premier pays Africain (Afrique du Sud) arrive au 53ème rang. Le haut du classement est resté en fait relativement inchangé au cours des années (la Suisse est ainsi à la première place depuis plusieurs années), avec des évolutions mineures dans les progressions. En revanche, l’évolution est beaucoup plus dynamique s’agissant des pays africains.
Une progression remarquable des pays Africains dans le classement 2014
L’Afrique Subsaharienne a été la région qui a le mieux progressé dans le classement. En 2014, la Cote d’Ivoire a progressé de 20 places, enregistrant le plus grand bon du classement. L’Afrique du Sud progresse de 5 places. Le Kenya, l’Ouganda, le Botswana, le Ghana, le Sénégal et le Cap Vert, font partie du top 100. Même si la plupart des pays Africains progressent, 24 pays d’Afrique Subsaharienne se retrouvent au bas du tableau. Le Togo et le Soudan clôturent le classement 2014, respectivement à la 142ème et 143ème place.
S’ils se retrouvent assez proches dans le classement, les pays Africains se distinguent entre eux sur plusieurs aspects. Le rapport note ainsi les domaines dans lesquels certains se détachent : le capital humain et la recherche pour le Ghana ou la sophistication du marché pour l’Afrique du Sud.
Par ailleurs, les résultats semblent avoir été favorisés par des politiques et programmes lancés ces dernières années dans certains pays (avec des succès variables) et visant à encourager l’innovation. C’est en particulier le cas du Rwanda, qui a mis en place un fond de soutien à l’innovation (Rwanda Innovation Endowment Fund) avec l’appui des Nations Unies. Ce fond placé sous la tutelle du Ministère de l’Education a pour mission de soutenir des projets innovants dans l’agriculture, l’industrie, les TIC et l’énergie, permettant ainsi aux startups et PME qui ont introduit des idées nouvelles de bénéficier d’un appui public décisif.
Les « Innovation Learners », statut privilégié de plusieurs pays d’Afrique Subsaharienne
L’Afrique Subsaharienne compte de plus en plus de pays qui font partie du groupe dit des « innovation learners », défini comme l’ensemble des pays dont les indices relatifs à l’innovation sont d’au moins 10% supérieurs par rapport à ce qui est attendu vu leur niveau de PIB (autour de 2000 USD en PPA). Il inclue une douzaine de pays, dont la Chine, l’Inde, le Vietnam, la Thaïlande, la Malaisie, la Jordanie … et le Sénégal.
En 2013, le Rwanda, le Mozambique, la Gambie, le Malawi, et le Burkina Faso, ont rejoint ce groupe, qui compte désormais six pays Africains. D’après les analyses du Global Innovation Index, cette « surperformance » dans les niveaux d’innovation est notamment due à une main d’œuvre relativement bien formée, à de bonnes possibilités de crédits d’investissement, et à un environnement des affaires plus sophistiqué qu’ailleurs en Afrique (notamment dans le secteur tertiaire). Le Nigeria, plus grand économie du continent, passe de la 120ème à la 110ème place, et reste loin du Kenya (85ème).
Il est important de noter que l’appartenance au groupe des innovation learners n’est pas lié à un classement par rapport aux autres, mais plutôt par rapport à ce qui est attendu vu ses ressources internes. Ainsi le Rwanda (102ème), le Mozambique (107ème), et le Burkina Faso (109ème), sont très proches du Nigeria, mais se distinguent par leur très bonne performance au regard de leurs ressources beaucoup plus limitées et de ce qui serait attendu d’eux en termes d’innovation.
L’importance du facteur humain
Comment certains pays s’en sortent ils mieux que d’autres dans le domaine de l’innovation? D’après le Global Innovation Index, les diplômés du supérieur constituent « un point de départ essentiel » dans le processus d’innovation, même si leur présence ne garantit pas forcément des résultats. En effet, d’autres facteurs entrent en jeu et sont tout aussi important que les compétences techniques : la créativité, l’esprit critique, la tolérance du risque et l’esprit entrepreneurial sont des facteurs « au moins aussi importants », et constituent l’environnement le plus favorable à l’innovation. La mise en place de ce type d’environnement, qui porte efficacement de nouvelles idées, reste un défi complexe, en particulier pour les pays en développement dont les moyens sont limités. Il est d’autant plus compliqué par la concurrence internationale et la mondialisation.
En effet, « les talents de haut niveau restent rares », malgré le développement de l’éducation supérieure. De plus, ils tendent « à se regrouper autour des meilleurs institutions », dans la mesure où la mobilité du capital humain a beaucoup progressé au cours des dernières décennies. Ces évolutions constituent ainsi à la fois des menaces et des opportunités pour les pays Africains, d’autant plus qu’une « fuite des cerveaux inversée » commence à se mettre en place (à l’instar de l’Inde ou de la Chine).
Des processus d’innovation peuvent néanmoins trouver leur voie plus spécifiquement en Afrique, environnement dans lequel les besoins sont immenses et les possibilités de rattrapage accéléré existent réellement. La success story du paiement mobile, qui a trouvé en Afrique un terrain de croissance beaucoup plus favorable qu’ailleurs précisément en raison des carences des réseaux classiques, constitue un exemple particulièrement frappant et encourageant pour l’avenir.
Lire le rapport complet (en anglais)
Nacim KAID SLIMANE

 Nous trouverons un chemin…ou nous en créerons un.
Nous trouverons un chemin…ou nous en créerons un.