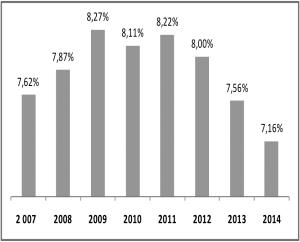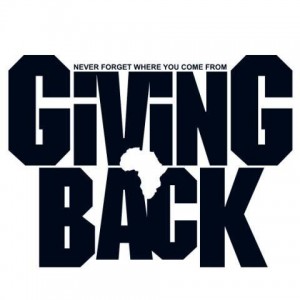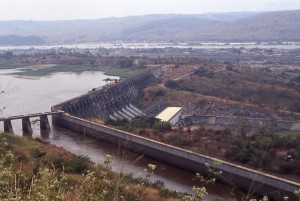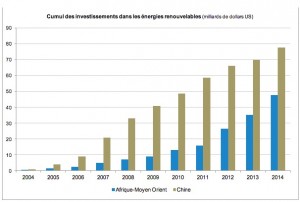Le Nigéria – première économie africaine avec un PIB de 522 milliards de dollars en 2014 et une population s’élevant à 167 millions d’habitants – subit actuellement une crise monétaire couplée à un déficit budgétaire croissant. Une crise que les autorités tentent de juguler et qui met le pays sous la rampe des projecteurs. A l'occassion de sa revue article VI, le FMI a proposé une série de mesures pour aider le pays à surmonter cette situation. L’article IV des statuts du FMI dispose que le Fonds doit exercer une surveillance sur les politiques de changes des Etats membres et adopter des principes spécifiques pour guider leur politique monétaire. Les travaux du FMI pour l’année 2014 ont été cruciaux pour le pays et les observateurs et investisseurs internationaux y ont été particulièrement attentifs.
Le Nigéria – première économie africaine avec un PIB de 522 milliards de dollars en 2014 et une population s’élevant à 167 millions d’habitants – subit actuellement une crise monétaire couplée à un déficit budgétaire croissant. Une crise que les autorités tentent de juguler et qui met le pays sous la rampe des projecteurs. A l'occassion de sa revue article VI, le FMI a proposé une série de mesures pour aider le pays à surmonter cette situation. L’article IV des statuts du FMI dispose que le Fonds doit exercer une surveillance sur les politiques de changes des Etats membres et adopter des principes spécifiques pour guider leur politique monétaire. Les travaux du FMI pour l’année 2014 ont été cruciaux pour le pays et les observateurs et investisseurs internationaux y ont été particulièrement attentifs.
Les travaux de l’organisation internationale ont permis de traiter différentes questions économiques telles que la stabilité des finances publiques, les réformes structurelles entreprises, l’état du système bancaire et financier et les grandes tendances macroéconomiques. En décembre 2014, Lagos et Abudja ont ainsi reçu la visite de la délégation du FMI, qui a dessiné les contours d’une politique d’austérité en fixant les priorités suivantes[1] :
- Politiques conjoncturelles pour faire face aux déséquilibres de court-terme,
- Mise en place d’objectifs relatifs à la stabilité macroéconomique,
- Soutien à la croissance inclusive,
- Baisse de la pauvreté et des inégalités.
Le présent article (très technique) reviendra dans un premier temps sur les recommandations préconisées par le FMI pour aider la première économie africaine à surmonter le contre-choc pétrolier ; puis les limites de ces solutions seront analysées dans un second temps, à la lumière des spécificités institutionnelles et des précédentes crises monétaires et financières traversées par le Nigeria.
Le plan du FMI pour sortir le Nigéria de l’impasse : rigueur budgétaire et diversification des activités économiques.
Les concertations se sont tenues dans un climat économique et politique incertain. En effet, comme d’autres Etats africains, majoritairement exportateurs de pétrole, le Nigéria fait actuellement face à un choc exogène. La chute du court du baril conduit à une dégradation de la balance commerciale et à une diminution des recettes publiques. L’incertitude liée à la l’évolution future des prix du pétrole accroît l’aversion au risque des investisseurs étrangers et menace les prévisions de croissance pour l’année 2015, révisées de 6,4 à 5,5% par la Ministre de l’Economie et des finances, Ngozi Okonjo-Iwealan lors de la présentation du budget au Parlement. De plus, la pression sur le Naira[2] s’est accrue avec la baisse des recettes pétrolières et l’augmentation des sorties de capitaux. Le gouverneur de la banque centrale, Godwin Emefiele, a ainsi annoncé une dévaluation du Naira pour faire face à la diminution des réserves nigérianes en devises étrangères.
Pour contrer ces effets les autorités nigérianes étaient représentées lors des discussions par des membres du secteur privé, le gouverneur de la Central Bank of Nigeria, et la Ministre de l’Economie et des finances. Cette dernière, ancienne vice-présidente de la Banque Mondiale, perçoit la chute du court du baril de pétrole comme une opportunité garantissant la diversification de l’économie nigérienne, pour l’heure, trop dépendante du pétrole dont la vente représente près de 70% des recettes de l’Etat. La ministre estime également qu’une baisse des dépenses publiques sur le long terme est nécessaire.
Ce sont donc les jalons d’un plan de rigueur que les experts internationaux et le gouvernement nigérian ont posé.
L’enjeu pour le Nigéria : tirer parti de ces recommandations en les adaptant à ses spécificités institutionnelles et économiques.
Le Nigéria dispose d’une faible marge de manœuvre en matière de réduction de la dépense publique et de tampons budgétaires. Ces leviers avaient été deux des principaux piliers de l’économie nigériane lors de la crise de 2009. A cette époque, l’Excess Crude Acount (ECA)[3] du pays qui s’élevait, à 21 milliards de dollars contre 3 milliards aujourd’hui, avait permis à l’Etat d’éviter une crise de liquidité. De plus, lors de la crise financière précédente, le gouvernement avait pu mener une politique budgétaire expansionniste reposant sur le Fiscal Responsability Act (FRA) dont l’objectif était d’assainir les finances publiques et de ramener le déficit public sous la barre des 3% sans nuire à l’investissement public. Parallèlement, la politique monétaire se concentrait sur une cible d’inflation inférieure à 10% en menant une politique de contraction de la masse monétaire qui ne portait pas atteinte à l’accès au crédit grâce à l’afflux de capitaux. Aujourd’hui, au contraire, du fait de la nouvelle donne macroéconomique, la politique de hausse des taux menée par la Central Bank of Nigeria conduit à une hausse du coût du crédit nuisible à l’investissement.
Par ailleurs, le fédéralisme budgétaire du Nigéria nécessite d’adopter une vision consolidée de la situation macroéconomique du pays. Le système institutionnel nigérian repose sur trois paliers que sont le gouvernement fédéral, le gouvernement des Etats et les gouvernements locaux. La répartition des recettes pétrolières entre ces trois strates est définie par un organe constitutionnel, la Commission de répartition et d’allocation des dépenses et des recettes. Ce système qui veille à la répartition des recettes entre régions pétrolières et régions non pétrolières, tend à accroître la dépendance des régions non dotés en hydrocarbure qui, préfèrent souvent se contenter de cette manne financière au lieu de développer leur avantage comparatif dans des secteurs divers. Face à ce constat, une modernisation du système financier public est requise pour assurer la soutenabilité des finances publiques tant au niveau fédéral qu’au niveau local. Le FMI a rappelé que l’ensemble des mesures prises au niveau de la fédération en 2009 doivent être étendues aux Etats fédéraux de 2015 à 2017 afin de mieux encadrer les risques.
Enfin, le plan de rigueur comporte un volet fiscal contesté dans la mesure où la hausse programmée de la Taxe sur la Valeur Ajoutée constituerait une double peine pour les entreprises faisant déjà face à d’importants problèmes de ravitaillement énergétique. La remise en cause des crédits d’impôts achève de fragiliser le secteur pétrolier en faisant perdre aux sociétés pétrolières pionnières les avantages dont elles bénéficiaient[4].
Le FMI accompagne actuellement le Nigéria pour l’aider à surmonter la crise monétaire et budgétaire déclenchée par l’effondrement des prix du pétrole. Parmi les mesures figurent des recommandations traditionnelles visant à assainir les finances publiques et à stabiliser le taux de change et l’inflation. Si ces réformes ont permis à l’économie nigériane de traverser la crise financière internationale de 2009, elles montrent aujourd’hui leurs limites et mettent en lumière la nécessité pour le Nigéria – pays fédéral largement dépendant de ses exportations pétrolières – d’adopter une vision plus consolidée de ses finances publiques tout en développant les avantages comparatifs dont il dispose (dans l'industrie, dans le cinéma, dans l'agriculture; etc.).
Daphnée Sétondji
[1] Cf IMF Staff Concludes 2014 Article IV – Mission to Nigeria
[2] Monnaie nigériane.
[3] Compte crée en 2004, alimenté grâce au surplus de recettes pétrolières. Il équivaut à la différence entre le prix de référence du baril fixé par le Parlement et son prix effectif sur les marchés internationaux
[4] Cf Article publié par l’agence Ecofin le 18 décembre 2014.