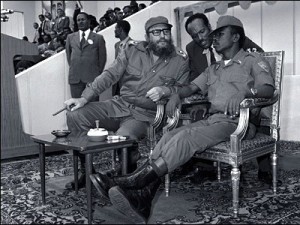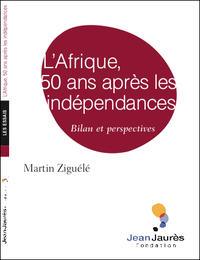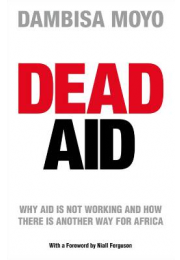C’est sans doute l’un des grands enseignements des débats liés à l’Afrique lors du FSM 2011 : l’agriculture est revenue au centre de toutes les préoccupations de développement économique et social. La mode de l’industrie industrialisante est passée, de même que celle, plus récente, des NTIC et de la financiarisation des économies africaines comme moteur central du développement. 70% de la population africaine vit directement ou indirectement de l’activité agricole, la plus grande partie de manière non capitalistique, puisqu’il s’agit d’une agriculture d’autosubsistance. Toutefois, le quart de la population du continent africain demeure sous-alimentée selon les statistiques internationales en cours. Selon la FAO, 21 pays africains sont exposés de façon permanente à des risques alimentaires. L’augmentation de la demande internationale en produits alimentaires tirée par les pays émergents, le boom démographique en Afrique, la spéculation sur les matières premières, rendent la question agraire particulièrement explosive. Dans cinquante ans, si les tendances se poursuivent au rythme actuel, plusieurs parties du monde seront incapables de répondre à leurs besoins alimentaires, et notamment l’Afrique.
C’est sans doute l’un des grands enseignements des débats liés à l’Afrique lors du FSM 2011 : l’agriculture est revenue au centre de toutes les préoccupations de développement économique et social. La mode de l’industrie industrialisante est passée, de même que celle, plus récente, des NTIC et de la financiarisation des économies africaines comme moteur central du développement. 70% de la population africaine vit directement ou indirectement de l’activité agricole, la plus grande partie de manière non capitalistique, puisqu’il s’agit d’une agriculture d’autosubsistance. Toutefois, le quart de la population du continent africain demeure sous-alimentée selon les statistiques internationales en cours. Selon la FAO, 21 pays africains sont exposés de façon permanente à des risques alimentaires. L’augmentation de la demande internationale en produits alimentaires tirée par les pays émergents, le boom démographique en Afrique, la spéculation sur les matières premières, rendent la question agraire particulièrement explosive. Dans cinquante ans, si les tendances se poursuivent au rythme actuel, plusieurs parties du monde seront incapables de répondre à leurs besoins alimentaires, et notamment l’Afrique.
Le continent africain est pourtant l’un des plus grands bassins agricoles du monde. Il présente une extraordinaire diversité agro-écologique, d’importantes ressources en eau (certes mal réparties sur le continent), des ressources humaines importantes, des capacités énergétiques encore non-exploitées. Mais faute de capitaux, de moyens techniques et peut-être tout simplement de volontarisme collectif, l’agriculture africaine reste sous-productive[1] et ne permet pas de faire face à la demande locale en produits alimentaires.
Le discours développementaliste actuellement en cours consiste à prôner à tout crin la hausse de la productivité agricole, la concentration foncière entre les mains d’entrepreneurs de l’agro-business, seuls à même d’investir et de devenir internationalement compétitifs. Les propos tenus lors du FSM tranchaient avec cette position de principe. Comme le soulignait Samir Amin au cours de l’une de ses interventions, « le développement du capitalisme est fondé sur l’accélération de l’expropriation des paysans. Or, le capitalisme réellement existant en Afrique n’est pas en mesure de donner des emplois à ces millions de paysans dépossédés. C’est donc un capitalisme régressif socialement. Nous faisons face au danger d’un développement exclusif de la population, laissant de côté des millions de paysans qui n’arriveront pas à se reconvertir. »
 De nombreux représentants de syndicats agricoles de différents pays africains ont fait part des mêmes préoccupations. Un représentant du syndicat paysan béninois Synergie Paysanne a ainsi raconté le lobbying de son mouvement qui essaye de protéger les espaces agricoles de la concentration foncière, laquelle tuerait la petite paysannerie. Ils auraient poussé le gouvernement béninois à faire en sorte qu’un investisseur individuel ne puisse pas acheter plus de 50 hectares de terrain. Selon ce représentant syndical, « des cadres gouvernementaux travaillent contre la paysannerie de leur propre pays au nom de la modernisation de leur agriculture. » Selon une étude de la Banque mondiale, les grandes transactions foncières ont concerné environ 50 millions d’hectares dans le monde en 2009, dont une majeure partie en Afrique. En 2008, le projet de la Corée du Sud de rachat à Madagascar d’1,3 million d’hectares non-exploités (l’équivalent de 40% des terres cultivées du pays) pour produire du maïs et des agro-carburants reste un exemple paroxystique de ce mouvement de concentration foncière et capitaliste dans l’agriculture africaine, avec un risque certain de perte de souveraineté agricole.
De nombreux représentants de syndicats agricoles de différents pays africains ont fait part des mêmes préoccupations. Un représentant du syndicat paysan béninois Synergie Paysanne a ainsi raconté le lobbying de son mouvement qui essaye de protéger les espaces agricoles de la concentration foncière, laquelle tuerait la petite paysannerie. Ils auraient poussé le gouvernement béninois à faire en sorte qu’un investisseur individuel ne puisse pas acheter plus de 50 hectares de terrain. Selon ce représentant syndical, « des cadres gouvernementaux travaillent contre la paysannerie de leur propre pays au nom de la modernisation de leur agriculture. » Selon une étude de la Banque mondiale, les grandes transactions foncières ont concerné environ 50 millions d’hectares dans le monde en 2009, dont une majeure partie en Afrique. En 2008, le projet de la Corée du Sud de rachat à Madagascar d’1,3 million d’hectares non-exploités (l’équivalent de 40% des terres cultivées du pays) pour produire du maïs et des agro-carburants reste un exemple paroxystique de ce mouvement de concentration foncière et capitaliste dans l’agriculture africaine, avec un risque certain de perte de souveraineté agricole.
Pour le directeur de l’Institut africain des études agraires (AIAS, Harare, Zimbabwe), Sam Moyo, le modèle d’intégration néolibérale de l’espace économique international a « intensifié non pas seulement la financiarisation mais aussi le monopole capitaliste au niveau agricole, au niveau des ressources naturelles comme l’eau, la propriété terrienne. Dans ce modèle, il ne peut pas y avoir de futur sans concentration des moyens de production agricole dans des grandes fermes, et les petits agriculteurs n’ont pas de place dans ce futur. Il faut faire une alliance entre classes pour trouver une solution médiane où les paysans trouvent leur place. »
Pour l’anthropologue malien Issaka Bagayoko, cette solution médiane pourrait consister en la mise en place d’un système de mise en valeur collective des terres. En prenant pour exemple l’accaparement de centaines de milliers d’hectares de terres de la vallée du fleuve Niger par l’office du Niger, dans le cadre du projet de développement agricole soutenu par la CEDEAO, I. Bagayoko appelle à renverser la tendance actuelle qui profite essentiellement aux groupes privés maliens, au détriment de petits producteurs déplacés de leurs lieux de vie traditionnels et laissés sans perspectives d’avenir.
L’équation reste cependant compliquée : comment d’un côté augmenter la productivité agricole africaine et devenir autosuffisant, objectif que tout le monde partage, et de l’autre côté inclure dans ce modèle de développement les nombreux paysans sous-productifs actuellement ? Pour Samir Amin, « si l’on veut que cette agriculture familiale ne permette non pas de survivre, mais de progresser réellement et d’assurer la souveraineté nationale en matière alimentaire et d’assurer une vie décente aux paysans, il faut concevoir des formes d’industrialisation qui la soutiennent. Dire que des pays sont condamnés à rester paysans sans industrie est inacceptable : il n’y a pas de progrès possible même dans l’agriculture sans développement industriel. Mais quel développement industriel ? Il n’est pas seulement question de la forme de propriété, mais de l’articulation de l’économie paysanne avec l’économie nationale, régionale et mondiale. Il faut inventer les solutions à ces problèmes à travers des expériences incluant l’ensemble des forces sociales. »
Emmanuel Leroueil
[1] : En Afrique de l’Ouest, le rendement d’un hectare de maïs est d’une tonne et demi, contre 6 à 8 tonnes dans les pays en développement d’Asie du Sud-Est et 20 à 30 tonnes en Europe.