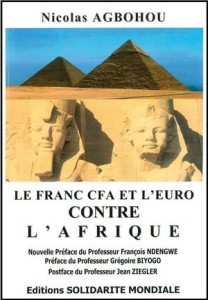Deuxième partie: Vie et mort d'un libérateur national
 Amilcar Cabral est né le 12 septembre 1924 à Bafatà, dans l’est de la Guinée-Bissau. Le pays dans lequel il voit le jour, la Guinée portugaise, est décimé par plusieurs siècles de traite négrière. Vaste de 40.000 km², il ne comptait que 500.000 habitants en 1960. Toutes les forces vives du pays sont mobilisées dans la production d’une monoculture d’arachide : les populations sont réquisitionnées de force et amenées à négliger leur production agricole traditionnelle, ce qui se traduit par des famines répétées. L’espérance de vie moyenne est de 30 ans au moment de l’indépendance. Contrairement aux colonies anglaises et françaises, les Portugais n’investissent quasiment pas dans les infrastructures, ce qui aggrave encore la situation locale.
Amilcar Cabral est né le 12 septembre 1924 à Bafatà, dans l’est de la Guinée-Bissau. Le pays dans lequel il voit le jour, la Guinée portugaise, est décimé par plusieurs siècles de traite négrière. Vaste de 40.000 km², il ne comptait que 500.000 habitants en 1960. Toutes les forces vives du pays sont mobilisées dans la production d’une monoculture d’arachide : les populations sont réquisitionnées de force et amenées à négliger leur production agricole traditionnelle, ce qui se traduit par des famines répétées. L’espérance de vie moyenne est de 30 ans au moment de l’indépendance. Contrairement aux colonies anglaises et françaises, les Portugais n’investissent quasiment pas dans les infrastructures, ce qui aggrave encore la situation locale.
Dans ce contexte général, Amilcar Cabral naît dans un milieu relativement privilégié. Il est issu d’une famille originaire du Cap-Vert. Son père est instituteur, membre de la catégorie sociale des assimilados, terme qui désigne ces métis culturels et/ou biologiques qui sont les principaux auxiliaires des colons durant cette période (fonctionnaires subalternes, petits commerçants, etc.). Il accède de ce fait à l’éducation occidentale dans une école de missionnaires située à Bissau. En 1931, sa famille retourne vivre au Cap-Vert et le jeune Amilcar poursuit ses études primaires puis secondaires à Praia. La situation économique et sociale du Cap-Vert, également sous domination coloniale portugaise, n’est pas meilleure que celle de la Guinée-Bissau. Du fait du détournement de la production agricole traditionnelle par les colons et du manque d’eau lié à la pluviométrie, de nombreuses famines meurtrières ébranlent ces îles rocailleuses.
Cette situation marquera profondément le jeune Cabral qui décidera d’orienter ses études vers l’agronomie afin de remédier aux problèmes agricoles qui empoisonnent l’existence de ses compatriotes. En 1945, à l’âge de 21 ans, il obtient une bourse pour poursuivre ses études supérieures à Lisbonne au Portugal. Le jeune homme arrive dans la métropole coloniale à un moment particulier de son histoire, celui de l’hégémonie du pouvoir du dictateur Salazar, qui suscite en réaction une résistance critique anti-fasciste, notamment dans les milieux universitaires.
L’étudiant Cabral à Lisbonne : rencontres, lectures, formation
En plus d’être la capitale du Portugal, Lisbonne est à cette époque la capitale de l’empire colonial portugais, où se retrouvent des étudiants en provenance des différentes colonies africaines. C’est donc dans ce climat intellectuel et ce contexte historique qu’Amilcar Cabral est amené à rencontrer des condisciples étudiants qui, comme lui, écriront les pages d’histoire de leurs pays respectifs : Agostinho Neto (leader de l’indépendance de l’Angola) et Eduardo Mondlane (fondateur du Frelimo, mouvement de libération nationale du Mozambique) sont quelques-uns de ses camarades de l’époque. Ensemble, ils s’initient au principal courant de pensée critique de l’impérialisme et du colonialisme à leur époque, le marxisme-léninisme, qui influencera profondément leur pensée et leur engagement politique.
Cabral et ses amis africains ressentent également la nécessité d’une « réafricanisation des esprits », s’intéressent aux travaux pionniers des écrivains de la négritude, fondent le « Centro de Estudos Africanos » qui leur sert de think-tank dans cette perspective de retour aux sources culturelles africaines. Ce processus de "réafricanisation intellectuelle" est d’autant plus nécessaire pour eux qu’ils sont pour la plupart des assimilados, et donc qu’il leur faut éviter le piège de l’acculturation et de la distanciation avec les populations africaines qui n’ont pas été alphabétisées et mises au contact de la pensée de la Modernité.
 Amilcar Cabral achève ses études en 1950 et devient ingénieur agronome. Il entame tout d’abord une période d’apprentissage pendant deux ans au centre d’agronomie de Santarem (Portugal). Mais bien vite, sa destinée recroise celle de son pays natal : en 1952, il retourne en Guinée portugaise pour travailler aux services de l’agriculture et des forêts et plus particulièrement au centre expérimental agricole de Bissau, qu’il dirige dès l’âge de 29 ans. Amilcar Cabral entreprend dans ce cadre un projet extrêmement ambitieux : recenser le patrimoine agricole de la Guinée pour s’imprégner des réalités de la population paysanne de son pays, comprendre ses difficultés et ses besoins, dans la perspective de s’appuyer ensuite sur elle lors de la lutte pour l’indépendance (selon une stratégie révolutionnaire d’inspiration maoïste).
Amilcar Cabral achève ses études en 1950 et devient ingénieur agronome. Il entame tout d’abord une période d’apprentissage pendant deux ans au centre d’agronomie de Santarem (Portugal). Mais bien vite, sa destinée recroise celle de son pays natal : en 1952, il retourne en Guinée portugaise pour travailler aux services de l’agriculture et des forêts et plus particulièrement au centre expérimental agricole de Bissau, qu’il dirige dès l’âge de 29 ans. Amilcar Cabral entreprend dans ce cadre un projet extrêmement ambitieux : recenser le patrimoine agricole de la Guinée pour s’imprégner des réalités de la population paysanne de son pays, comprendre ses difficultés et ses besoins, dans la perspective de s’appuyer ensuite sur elle lors de la lutte pour l’indépendance (selon une stratégie révolutionnaire d’inspiration maoïste).
La création du Parti africain pour l’indépendance – Union des peuples de Guinée et des îles du Cap-Vert (PAIGC) et la lutte pour l’indépendance.
Les activités politiques « séditieuses » de Cabral n’échappent pas aux autorités portugaises qui le contraignent à s’exiler en Angola, où il rejoint ses anciens camarades étudiants et participe à la fondation de Mouvement populaire de libération de l’Angola (MPLA, parti politique toujours au pouvoir aujourd’hui). Durant son année d’exil, Amilcar Cabral travaille dans une entreprise sucrière. Fort de l’exemple du MPLA, Cabral fonde à Bissau le 19 septembre 1956 avec 5 compagnons le Parti africain pour l’indépendance (PAI), qui deviendra bientôt le PAIGC en intégrant la thématique de l’union nécessaire des peuples de Guinée et des îles du Cap-Vert.
En lien avec les autres organisations d’indépendance des colonies portugaises (futur Frelimo, MPLA), Amilcar Cabral crée tout d’abord des cellules clandestines de formation de militants et de communication sur les enjeux de l’indépendance, principalement dans les villes. Il participe également à la structuration du mouvement syndical et jouera un rôle important dans l’organisation d’une grève ouvrière le 3 août 1959, violemment réprimée par les colons portugais. Suite à cet échec, et face à l’impuissance d’un mouvement de contestation politique traditionnel (manifestations, grèves, etc.) qui s’explique par le caractère particulier du régime dictatorial portugais qui n’a aucune intention de suivre l’exemple de la France et du Royaume-Uni, Amilcar Cabral décide d’engager une lutte armée pour accéder à l’indépendance. La guérilla débute en 1963.
Cette lutte armée est menée principalement à partir des campagnes que Cabral connaît désormais très bien. Positionnant ses bases-arrières en Guinée Conakry et en Casamance, le PAIGC se lance progressivement dans la consolidation de son emprise des campagnes et de l’adhésion des populations rurales en Guinée-Bissau. Face à lui, le pouvoir colonial portugais peut compter sur une force militaire présente sur place de plus de 30 000 hommes bien équipés. Le combat est donc inégal, mais malgré ce handicap la stratégie d’insurrection rurale et d’enclavement des villes par les campagnes se révèle payante, comme ce fut le cas en Chine.
 Bientôt, c’est tout le Sud du pays qui est sous le contrôle du PAIGC. Amilcar Cabral fait alors preuve de toute son originalité. Il met en place dans les zones libérées des structures politico-administratives et un cadre économique qui préfigure le système qu’il compte développer ensuite. Cela dans un contexte de guerre ouverte, donc très instable et difficile. Rappelons également que dans la même situation, un personnage comme Jonas Savimbi en Angola mettra les populations « libérées » sous coupe réglée, les asservissant à ses objectifs militaires, politiques et économiques. Au contraire, Cabral crée les infrastructures étatiques de base (écoles, dispensaires), met en place des « magasins du peuple » pour que la population ait accès aux produits de premières nécessités à coûts raisonnables afin de mettre un terme à la situation de pénurie qui prévalait. Le leader socialiste met également en place des « brigades mobiles » qui diffusent au sein de la population les principes et les valeurs défendues par le PAIGC : transformations politiques, économiques, sociales et culturelles à venir dans la nouvelle société postcoloniale.
Bientôt, c’est tout le Sud du pays qui est sous le contrôle du PAIGC. Amilcar Cabral fait alors preuve de toute son originalité. Il met en place dans les zones libérées des structures politico-administratives et un cadre économique qui préfigure le système qu’il compte développer ensuite. Cela dans un contexte de guerre ouverte, donc très instable et difficile. Rappelons également que dans la même situation, un personnage comme Jonas Savimbi en Angola mettra les populations « libérées » sous coupe réglée, les asservissant à ses objectifs militaires, politiques et économiques. Au contraire, Cabral crée les infrastructures étatiques de base (écoles, dispensaires), met en place des « magasins du peuple » pour que la population ait accès aux produits de premières nécessités à coûts raisonnables afin de mettre un terme à la situation de pénurie qui prévalait. Le leader socialiste met également en place des « brigades mobiles » qui diffusent au sein de la population les principes et les valeurs défendues par le PAIGC : transformations politiques, économiques, sociales et culturelles à venir dans la nouvelle société postcoloniale.
A la fin des années 1960, le PAIGC contrôle les 2/3 du territoire bissau-guinéen. En 1972, le mouvement déclare unilatéralement l’indépendance de la Guinée-Bissau. Du fait de ses succès militaires, de l’adhésion des populations et également de son activisme diplomatique, la communauté internationale reconnait en novembre de cette même année, par la voix des Nations unies, le PAIGC comme « véritable et légitime représentant des peuples de la Guinée et du Cap-Vert » et exige du Portugal de mettre un terme à la guerre coloniale. Amilcar Cabral touche au but. Les militaires portugais sont aux abois. Ils tentent de réagir en mettant en place des politiques sociales, en promouvant les élites autochtones qui leur viennent en aide, en incorporant de nombreux Africains dans leur armée coloniale, et en augmentant sans cesse les équipements militaires.
La mort d’un guérillero, la naissance d’un martyr de l’indépendance
Le 20 janvier 1973, Amilcar Cabral est assassiné à Conakry par des membres de son propre parti, qui expliqueront leur geste par leur volonté de mettre un terme à l’hégémonie des assimilados (pour la plupart originaire des îles du Cap-Vert) sur le mouvement indépendantiste. Les théories abondent quant à d’éventuels commanditaires de cet assassinat, des plus probables (les colonialistes Portugais) aux plus improbables (le « frère » Ahmed Sékou Touré, président de la Guinée-Conakry). Quoi qu’il en soit, cet assassinat met à jour l’une des principales contradictions sociales du mouvement de libération national, dont Cabral lui-même était bien conscient, à savoir la coexistence entre la petite-bourgeoisie fer de lance de la révolution et le reste de la population. C’est cette même contradiction entre assimilados et Africains qui explique en partie les antagonismes ayant conduit à la longue guerre civile en Angola.
L’œuvre d’Amilcar Cabral lui a cependant survécu. Le 24 septembre 1973, l’ONU reconnait officiellement l’indépendance de l’Etat de la Guinée-Bissau – Iles du Cap Vert. Devant l’impasse de leur situation militaire, les hauts-gradés du corps expéditionnaire portugais à Bissau, avec à leur tête le général Spinola, provoquent un coup d’Etat militaire pour renverser le pouvoir fasciste portugais de Marcelo Caetano, ce qui conduit à la reconnaissance par le Portugal de l’indépendance de ses colonies le 10 septembre 1974.
Emmanuel Leroueil
N.B : Dans la troisième et dernière partie de ce portrait, nous reviendrons plus précisément sur la pensée politique de Cabral et son inscription dans l'histoire globale du socialisme.