Ken, une amie sénégalaise – peut-être la connaissez-vous, elle est entre autres l’auteure du Baobab Fou, de la Folie et la Mort, de Aller et Retour – m’a confié attendre l’interview de Shari Hammond.
Shari, notre sœur ghanéenne-ougandaise qui était entre ses deux pays pour des raisons professionnelles, a, dès qu’elle a pu convenablement s’installer, pris le temps de nous consacrer un peu du sien. Polyglotte, je lui ai emprunté les mots des langues qu’elle parle ou perfectionne pour vous souhaiter mukulike (luganda), tusemerirwe kukulora (lutooro), akwaaba (twi et ga), wilkommen (allemand), welcome (anglais), bienvenue dans une réalité – celle d’une femme africaine, instruite, professionnelle, globe-trotter, intelligente, comme me l’a dit un certain ambassadeur honoraire en parlant d’elle – bienvenue dans une réalité qui n’est point fiction.
Pour mémoire, ceci est la suite de mon papier diffusée dimanche 6 juillet. Papier dans lequel je vous entretenais via une interview avec Serge Noukoue, de la deuxième édition du Nollywood Week Festival qui a eu lieu du 5 au 8 juin au cinéma parisien l’Arlequin.
Cet évènement a été l’occasion de me faire des nœuds au cerveau, pour reprendre l’expression d’une autre amie, en voulant analyser l’interpénétration entre fiction et réalité. En attendant de partager avec vous mes réflexions profondes, je vous remercie de trouver dans les lignes qui suivent mon e-interview avec Shari Hammond, Responsable Partenariats au sein de l’association Okada Media. Association qui organise le Nollywood Week Festival.
Clic-Text-Send avec Shari Hammond, Responsable Partenariats
 Gaylord Lukanga Feza : Shari, quel est votre parcours ? Votre histoire ? Votre relation avec les industries créatives ?
Gaylord Lukanga Feza : Shari, quel est votre parcours ? Votre histoire ? Votre relation avec les industries créatives ?
Shari Hammond : J’ai fait des études de droit international en me focalisant sur l’Afrique. J’ai toujours aimé me cultiver en lisant, aller à des expositions et découvrir différents artistes. Je m’interrogeais beaucoup sur les différentes scènes artistiques africaines et j’ai donc débuté en m’impliquant dans une revue en ligne d’art contemporain africain (Afrikadaa), en 2011. Par la suite, j’ai rencontré Serge et les autres co-fondateurs de la Nollywood Week.
Dernièrement, j’ai pu collaborer au sein d’un festival d’arts littéraires en Ouganda (Writivism).
Promouvoir, stimuler et développer les industries créatives africaines, qu’il s’agisse des arts visuels, du monde de l’édition ou du cinéma s’avère être pour moi une nécessité, de par leurs contributions au panthéon culturel et à l’essor économique d’un pays.
GLF : Votre formation vous a-t-elle été utile dans vos activités ?
SH : Ma formation de juriste m’a donné discipline et organisation dans mes activités. Il m’est plus facile par exemple de rédiger et relire des contrats de partenariats et autres. Ou encore de prendre en compte les diverses options et mesures juridiques à garantir.
GLF : Quels conseils pouvez-vous donner à ceux qui voudraient se lancer dans les industries créatives, pour leur éviter des écueils ?
SH : Je dirai juste qu’il faut oser relever ses manches et se mettre à la tache dès que l’on a une vision de ce que l’on veut accomplir. Avoir une idée c’est bien, mais une vision c’est mieux. La vision est cette feuille de route qui permettra à tout entrepreneur culturel de ne pas flancher dans les moments difficiles, car il y en a, comme dans toute entreprise. Ce genre d’industrie souffre hélas d’un manque de financements et cela est encore plus difficile en Afrique. Il faut croiser les bonnes personnes : Celles qui croiront en votre projet et qui seront prêtes à s’investir moralement et financièrement.
GLF : Comment choisissez-vous vos partenaires ? Je pense notamment à Total qui a soutenu l’évènement et à l’Arlequin qui l’a de nouveau accueilli.
SH : Nous aimons travailler avec des personnes qui mettent en avant des produits et services de qualité à destination d’une audience africaine ou portée vers l’Afrique. Des personnes qui ont conscience du potentiel et des évolutions, tout comme des avancées exceptionnelles qui ont lieu sur le continent. Des personnes, des mécènes qui promeuvent cette Afrique-là.
Nous ne sommes pas restrictifs quant à nos collaborations. Nous souhaitons stimuler des relations sur le long terme avec des entreprises qui ont fait leurs preuves et qui ne lésinent pas sur la qualité et le respect de leurs clients.
Notre rencontre avec Total a eu lieu par le biais de nos partenaires de l’Association France-Nigéria en 2013. Nous avons depuis engagé de multiples discussions afin de mieux connaître les valeurs et visions de chacun. La Fondation Total a décidé de nous soutenir cette année en raison de notre contribution à un dialogue interculturel et parce que nous créons de nouveaux accès pour de nouvelles audiences.
Le Cinéma l’Arlequin, lieu emblématique au cœur de Paris, nous a donné notre chance lors de la première édition et nous ont fait confiance après cette première réussite. Leur soutien tout au long de la préparation à l’aboutissement du Festival nous a été précieux et nous leur remercions à nouveau pour cela.
GLF : A qui, à quoi seront alloués les bénéfices de ce festival ?
SH : Une chose à savoir est que les festivals de cette envergure ne font pas encore de bénéfices. Le peu d’argent récolté sera affecté à la préparation de l’édition prochaine et à des activités connexes de l’association portant le Festival : Okada Media.
 GLF : Présente la journée de samedi au festival, j’ai pu constater l’engouement du public. Nombreux sont ceux à qui on a répondu « Séance complète ! », même pour celles du lendemain. Où tous ceux qui n’ont pu se rendre au festival ou accéder aux différentes séances, peuvent-ils retrouver les films de la sélection ?
GLF : Présente la journée de samedi au festival, j’ai pu constater l’engouement du public. Nombreux sont ceux à qui on a répondu « Séance complète ! », même pour celles du lendemain. Où tous ceux qui n’ont pu se rendre au festival ou accéder aux différentes séances, peuvent-ils retrouver les films de la sélection ?
SH : En effet, comme dans la plupart des festivals, il est préférable de bien identifier les projections auxquelles on veut assister et prendre son billet dès que possible. Beaucoup de séances ont affiché complet et nous en sommes ravis. Ce festival a pu proposer des premières de films inaccessibles en France et le public qui y était présent a témoigné de son intérêt et de son envie de voir plus de films provenant de l’industrie nigériane.
Notre plus grand souhait, ainsi que celui des directeurs et producteurs présents lors du festival, est d’avoir ces films disponibles sur le plus de plateformes possibles. Des partenaires comme Canal + ou Nollywood TV envisagent d’acquérir les droits de diffusion de certains de ces films. Il reste donc à attendre et voir.
GLF : Si c’était à refaire que changeriez-vous à cette édition 2014 ? Peut-on déjà prendre rendez-vous pour l’année prochaine ?
SH : Question difficile ! Les challenges ne sont là que pour nous faire grandir et nous en apprendre. J’accentuerais peut-être plus la communication, notamment pour inviter le public à prendre ses billets dès la veille du Festival ou en Early Bird comme nous l’avions déjà fait.
Oui. Vous pouvez déjà prendre rendez-vous pour l’année prochaine avec, nous l’espérons, encore plus de films qui vous toucheront et encore plus de rencontres avec ceux qui font Nollywood.
GLF : Le cinéma, grâce à une technique et des moyens de diffusion, met à notre disposition des images, des sons, nous dépeignant un tableau vivant, imitant ou distinguant la réalité. Quelle est selon vous le rôle de ceux qui créent ces images ?
SH : Le cinéma porte bien son surnom de septième art.
Le cinéma étant un art, il est là pour sublimer, dévoiler, dépeindre ou adapter une réalité. L’artiste, ici le réalisateur ou le producteur n’a le devoir que de suivre sa propre ambition et vision, même si cet art est un vecteur considérable d’influences que nous ne pouvons négliger. C’est pour cela qu’il y aura toujours des messages plus ou moins directs dans les films. Le rôle des créateurs selon moi n’est pas d’aboutir à une mission spécifique, mais de faire ce qu’ils font avec brio et ardeur, en définitive de laisser leur marque en ne cessant d’inspirer.
GLF : Shari Hammond, merci.
SH : Merci à vous
Propos recueillis par Gaylord Lukanga Feza

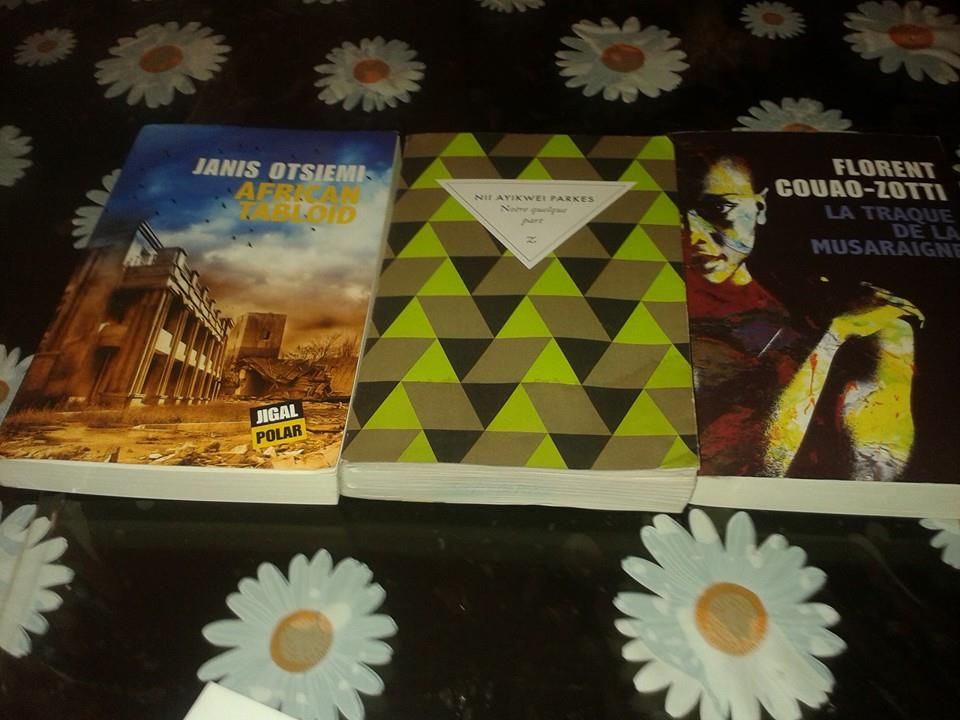

 Nii Ayikwei Parkes, vous ne le connaissiez pas avant, n’est-ce pas ? Moi non plus. Ma lecture du roman ghanéen en était restée à Kodjo Laing et ses airs de ”social science fiction”. Mais voilà qu’avec ce livre traduit de l’anglais par la béninoise Sika Fakambi, je découvre un auteur de polar bien sous tous rapports. Notre quelque part (Zulma, 2014) se lit comme un épisode de la série Les Experts transplanté sous les tropiques. Une jeune fille en vadrouille dans le village de Sonokrom poursuit un bel oiseau au plumage bleu et entre par hasard dans une case. Ce qu’elle découvre ? Un amas de chair et de viscères, de lymphe, une chose innommable qui bouge. Alertée, la police d’Accra débarque et conclut à un possible meurtre. Le propriétaire de la case, un certain Kofi Ata, parti en brousse, selon les villageois, ne serait pas encore de retour. L’affaire est confiée par le patron de la criminelle au jeune inspecteur Kayo, médecin légiste formé en Angleterre, qui trompe son ennui dans un laboratoire de biologie à Accra. Kayo, qui a toujours rêvé de rejoindre la criminelle et s’est fait blackbouler à chaque tentative rechigne. Il sera contraint d’accepter le job, par le chantage. Car cette affaire est une aubaine pour l’inspecteur Donkor, patron de la criminelle : il s’agit de retrouver qui se cache derrière la chose innommable, et, si possible, prouver qu’il s’agit d’un meurtre, en exhibant un coupable à n’importe quel prix ! Ce qui a priori a l’air simple va se révéler corsé comme une devinette akan. Ici, l’enquête est sophistiquée, basée sur l’utilisation de la recherche ADN. Mais que vaut la science devant la roublardise des villageois ? Toute la substantifique moelle du récit d’Ayikwei Parkes est là, dans ce jeu de cache-cache entre le jeune inspecteur et les villageois, notamment entre Kayo et le narrateur, le rusé Yao Pokou. « Nos Sages disent toujours que, parfois, lorsque le mal commis est plus grand que nous, la justice doit quitter nos mains. » L’enquêteur découvre vite ce que la maxime cache de terrible vérité. Notre quelque part est écrit comme un spoken word en ewe et en twi, mieux un slam intelligent qui a des phases de suspense digne des grands récits initiatiques. Les chapitres suivent l’ordre des jours de la semaine : nawƆtwe, kwasida, dwodwa… fida… Clin d’œil à ceux qui comprennent la langue !
Nii Ayikwei Parkes, vous ne le connaissiez pas avant, n’est-ce pas ? Moi non plus. Ma lecture du roman ghanéen en était restée à Kodjo Laing et ses airs de ”social science fiction”. Mais voilà qu’avec ce livre traduit de l’anglais par la béninoise Sika Fakambi, je découvre un auteur de polar bien sous tous rapports. Notre quelque part (Zulma, 2014) se lit comme un épisode de la série Les Experts transplanté sous les tropiques. Une jeune fille en vadrouille dans le village de Sonokrom poursuit un bel oiseau au plumage bleu et entre par hasard dans une case. Ce qu’elle découvre ? Un amas de chair et de viscères, de lymphe, une chose innommable qui bouge. Alertée, la police d’Accra débarque et conclut à un possible meurtre. Le propriétaire de la case, un certain Kofi Ata, parti en brousse, selon les villageois, ne serait pas encore de retour. L’affaire est confiée par le patron de la criminelle au jeune inspecteur Kayo, médecin légiste formé en Angleterre, qui trompe son ennui dans un laboratoire de biologie à Accra. Kayo, qui a toujours rêvé de rejoindre la criminelle et s’est fait blackbouler à chaque tentative rechigne. Il sera contraint d’accepter le job, par le chantage. Car cette affaire est une aubaine pour l’inspecteur Donkor, patron de la criminelle : il s’agit de retrouver qui se cache derrière la chose innommable, et, si possible, prouver qu’il s’agit d’un meurtre, en exhibant un coupable à n’importe quel prix ! Ce qui a priori a l’air simple va se révéler corsé comme une devinette akan. Ici, l’enquête est sophistiquée, basée sur l’utilisation de la recherche ADN. Mais que vaut la science devant la roublardise des villageois ? Toute la substantifique moelle du récit d’Ayikwei Parkes est là, dans ce jeu de cache-cache entre le jeune inspecteur et les villageois, notamment entre Kayo et le narrateur, le rusé Yao Pokou. « Nos Sages disent toujours que, parfois, lorsque le mal commis est plus grand que nous, la justice doit quitter nos mains. » L’enquêteur découvre vite ce que la maxime cache de terrible vérité. Notre quelque part est écrit comme un spoken word en ewe et en twi, mieux un slam intelligent qui a des phases de suspense digne des grands récits initiatiques. Les chapitres suivent l’ordre des jours de la semaine : nawƆtwe, kwasida, dwodwa… fida… Clin d’œil à ceux qui comprennent la langue !





 Musique, cinéma, séries tv, mode : des secteurs liés à l'image. Des secteurs qui rapportent. Des secteurs à la vitalité économique témoin de la capacité et du besoin du continent de créer de la valeur ajoutée à partir de ses cultures et pour répondre à ses préoccupations. Des secteurs rangés sous le fanion : Industries créatives.
Musique, cinéma, séries tv, mode : des secteurs liés à l'image. Des secteurs qui rapportent. Des secteurs à la vitalité économique témoin de la capacité et du besoin du continent de créer de la valeur ajoutée à partir de ses cultures et pour répondre à ses préoccupations. Des secteurs rangés sous le fanion : Industries créatives.
 GLF : Serge, quel est votre parcours ? Votre histoire ? Votre relation avec les industries créatives ?
GLF : Serge, quel est votre parcours ? Votre histoire ? Votre relation avec les industries créatives ?
 GLF : Dans un avenir plus ou moins lointain, le Nigéria pourrait-il devenir un centre de formation cinématographique pour le continent ?
GLF : Dans un avenir plus ou moins lointain, le Nigéria pourrait-il devenir un centre de formation cinématographique pour le continent ?
 GLF : Quel est l'accès des Nigérians à son cinéma ? Que reflète ce cinéma de ce pays ?
GLF : Quel est l'accès des Nigérians à son cinéma ? Que reflète ce cinéma de ce pays ?
 Chers internautes, Shari Hammond est en ce moment entre deux voyages, non pas de type astral, mais professionnel et d'ordre privé. Dès qu'elle posera un pied sur la terre ferme d'Ile-de-France (région administrative de France au coeur de laquelle se niche sa capitale : Paris), je m'en irai lui porter un verre d'eau fraîche, lui transmettrai vos meilleures salutations et lui demanderai de m'accorder pour vous un entretien.
Chers internautes, Shari Hammond est en ce moment entre deux voyages, non pas de type astral, mais professionnel et d'ordre privé. Dès qu'elle posera un pied sur la terre ferme d'Ile-de-France (région administrative de France au coeur de laquelle se niche sa capitale : Paris), je m'en irai lui porter un verre d'eau fraîche, lui transmettrai vos meilleures salutations et lui demanderai de m'accorder pour vous un entretien.
 Bofane ou l’art du contrepied
Bofane ou l’art du contrepied
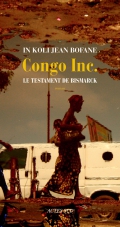 Isookanga ou la mondialisation des cynismes
Isookanga ou la mondialisation des cynismes
 Dakar a vécu au rythme de la création contemporaine avec cinq expositions « IN » : l’exposition internationale, celle sur la diversité culturelle, celle sur l’art vert, les expositions hommage à Mbaye Diop, à Mamadou Diakhaté et au sculpteur Moustapha Dimé et environ 270 expositions « OFF ».
Dakar a vécu au rythme de la création contemporaine avec cinq expositions « IN » : l’exposition internationale, celle sur la diversité culturelle, celle sur l’art vert, les expositions hommage à Mbaye Diop, à Mamadou Diakhaté et au sculpteur Moustapha Dimé et environ 270 expositions « OFF ». Le jeune Mehdi-Georges Lahlou, avec ses « 72 (virgins) on the sun » tourne en dérision les croyances, les fantasmes pour un appel à la résistance aux « sirènes du fanatisme ».
Le jeune Mehdi-Georges Lahlou, avec ses « 72 (virgins) on the sun » tourne en dérision les croyances, les fantasmes pour un appel à la résistance aux « sirènes du fanatisme ». Kader Attia, avec « Independance Tchao », installation représentative d’une forme d’architecture ridiculement imposante d’un lieu toutefois désaffecté qui met en avant l’échec des régimes post indépendance. L’artiste a interrogé les élites africaines : qu’avons-nous fait de nos souverainetés recouvrées dans les années 60 ?
Kader Attia, avec « Independance Tchao », installation représentative d’une forme d’architecture ridiculement imposante d’un lieu toutefois désaffecté qui met en avant l’échec des régimes post indépendance. L’artiste a interrogé les élites africaines : qu’avons-nous fait de nos souverainetés recouvrées dans les années 60 ? Ancien titulaire de la chaire d’études francophones et ancien directeur du Centre international d’études francophones de la Sorbonne, aujourd’hui président de l’A.D.E.L.F (Association Des Écrivains de Langue Française), le professeur émérite Jacques Chevrier est responsable du jury du Grand prix littéraire d’Afrique noire. Au cours d’un échange édifiant, il a bien voulu nous éclairer sur l’attribution de ce prix et donner son avis sur la réception de cette littérature africaine ainsi que l’intérêt qui lui est porté aujourd’hui dans le milieu de l’enseignement notamment.
Ancien titulaire de la chaire d’études francophones et ancien directeur du Centre international d’études francophones de la Sorbonne, aujourd’hui président de l’A.D.E.L.F (Association Des Écrivains de Langue Française), le professeur émérite Jacques Chevrier est responsable du jury du Grand prix littéraire d’Afrique noire. Au cours d’un échange édifiant, il a bien voulu nous éclairer sur l’attribution de ce prix et donner son avis sur la réception de cette littérature africaine ainsi que l’intérêt qui lui est porté aujourd’hui dans le milieu de l’enseignement notamment.

 Noël Kouagou est Togolais. Né en 1975 à Boukombé, il est docteur en littérature allemande et moderne. Il vit et enseigne en Allemagne comme le signale la quatrième de couverture de son roman sèchement titré Les Saprophytes (Editions Jets d’Encre, 2012). Dans ce roman, il s’agit d’une histoire d’immigration, pas clandestine mais mesquine à bien des égards. Une histoire d’immigration donc, avec ce qu’elle charrie habituellement : rêves et ferveurs d’avant-voyage, misères et désenchantements d’après-voyage. Le tableau est identique dans le roman de Noël Kouagou. Seulement l’angle d’attaque de ce dernier mérite qu’on s’y attarde. L’immigration sous sa plume ne se décline pas dans la logique Afrique-Europe ou Afrique-Etats-Unis. L’auteur nous transporte vers un autre coin du monde : Dubaï !
Noël Kouagou est Togolais. Né en 1975 à Boukombé, il est docteur en littérature allemande et moderne. Il vit et enseigne en Allemagne comme le signale la quatrième de couverture de son roman sèchement titré Les Saprophytes (Editions Jets d’Encre, 2012). Dans ce roman, il s’agit d’une histoire d’immigration, pas clandestine mais mesquine à bien des égards. Une histoire d’immigration donc, avec ce qu’elle charrie habituellement : rêves et ferveurs d’avant-voyage, misères et désenchantements d’après-voyage. Le tableau est identique dans le roman de Noël Kouagou. Seulement l’angle d’attaque de ce dernier mérite qu’on s’y attarde. L’immigration sous sa plume ne se décline pas dans la logique Afrique-Europe ou Afrique-Etats-Unis. L’auteur nous transporte vers un autre coin du monde : Dubaï !
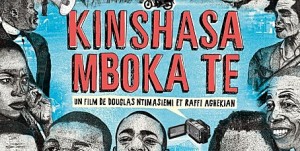 Kin’sasa Mboka te ! Cette phrase que tous les kinois ont fait leur, a été signée par le plus fin et le plus grand des sociologues que la ville ait porté, en la personne de Franco Lwambo Makiadi. Nul autre n’a su mieux que lui, traduire dans ses chansons l’ambiance cacophonique et tonitruante de Kin, la-belle. Dans Kinshasa Makambo, le Grand-Maître montrait déjà comment dans cette ville le faux était terriblement vrai ; l’éphémère avait ce caractère pérenne et persistant et devant lui, tout se faisait et se défaisait, porté par une inextinguible rumeur, qui monstrueusement, se nourrissait d’elle-même et vivait de sa mort.
Kin’sasa Mboka te ! Cette phrase que tous les kinois ont fait leur, a été signée par le plus fin et le plus grand des sociologues que la ville ait porté, en la personne de Franco Lwambo Makiadi. Nul autre n’a su mieux que lui, traduire dans ses chansons l’ambiance cacophonique et tonitruante de Kin, la-belle. Dans Kinshasa Makambo, le Grand-Maître montrait déjà comment dans cette ville le faux était terriblement vrai ; l’éphémère avait ce caractère pérenne et persistant et devant lui, tout se faisait et se défaisait, porté par une inextinguible rumeur, qui monstrueusement, se nourrissait d’elle-même et vivait de sa mort.
 Après quatre jours de vie de troubadour, de littérature et de rires la première Caravane du Livre de la sous-région touche à sa fin. Quatre jours durant lesquels la Caravane, composée des auteurs Dominique Mwankumi (RDC), Alain Amrah Horutanga (Burundi/RDC) et Dorcy Rugamba (Rwanda), mais aussi du centre culturel Ishyo et de la librairie Ikirezi, a fait le tour des jeunes et moins jeunes rwandais dans le but de promouvoir la lecture et la littérature.
Après quatre jours de vie de troubadour, de littérature et de rires la première Caravane du Livre de la sous-région touche à sa fin. Quatre jours durant lesquels la Caravane, composée des auteurs Dominique Mwankumi (RDC), Alain Amrah Horutanga (Burundi/RDC) et Dorcy Rugamba (Rwanda), mais aussi du centre culturel Ishyo et de la librairie Ikirezi, a fait le tour des jeunes et moins jeunes rwandais dans le but de promouvoir la lecture et la littérature.
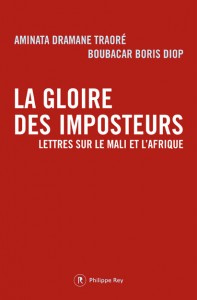 Certains livres méritent qu’on s’arrête sur rayon, qu’on cède au désir d’en connaître le contenu, ne serait-ce que parce que le menu est annonciateur de rupture, d’originalité et par conséquent de discours nouveaux. L’éditeur français Philippe Rey s’est associé au projet de voir deux intellectuels africains de premier plan pousser leurs réflexions, dans le cadre d’un échange épistolaire sur près de deux ans. Cet échange porte sur des faits qui ont marqué récemment le continent africain, plaçant ce dernier au cœur de l’actualité internationale : le « printemps » arabe (avec une acuité particulière portée sur l’épisode libyen) et la longue crise malienne. Aminata Dramane Traoré (1), altermondialiste déterminée, essayiste, ancienne ministre de la culture au Mali a pris le temps d’échanger durant près de deux ans avec le romancier et essayiste sénégalais Boubacar Boris Diop, auteur du fameux Murambi, Le livre des ossements et du roman en ouolof Doomi Golo.
Certains livres méritent qu’on s’arrête sur rayon, qu’on cède au désir d’en connaître le contenu, ne serait-ce que parce que le menu est annonciateur de rupture, d’originalité et par conséquent de discours nouveaux. L’éditeur français Philippe Rey s’est associé au projet de voir deux intellectuels africains de premier plan pousser leurs réflexions, dans le cadre d’un échange épistolaire sur près de deux ans. Cet échange porte sur des faits qui ont marqué récemment le continent africain, plaçant ce dernier au cœur de l’actualité internationale : le « printemps » arabe (avec une acuité particulière portée sur l’épisode libyen) et la longue crise malienne. Aminata Dramane Traoré (1), altermondialiste déterminée, essayiste, ancienne ministre de la culture au Mali a pris le temps d’échanger durant près de deux ans avec le romancier et essayiste sénégalais Boubacar Boris Diop, auteur du fameux Murambi, Le livre des ossements et du roman en ouolof Doomi Golo.
 Il est intéressant de remarquer que la première correspondance d’Aminata Traoré intervient après le coup d’état de Mars 2012, mené par le capitaine Sanogo. Il est important pour l’auteure de signifier l’antériorité de ce projet de correspondances. Cela étant précisé, les événements douloureux dans son pays vont fortement centrer le regard d’Aminata Traoré sur le Mali faisant de cet aspect de la correspondance le noyau d’un atome autour duquel la pensée de Boubacar Boris Diop, tel un électron, va graviter tout en apportant une ouverture intéressante de son propos au reste de la sous région et du continent. Pour revenir sur ces lettres sur le Mali, elles permettent au lecteur de mesurer l’impact du coup d’état, son évidence, quand on prend une meilleure connaissance du massacre d’Aguelhok(3), de la marche des femmes du camp militaire de Kati sur Bamako, la prise de contrôle de la rébellion du Nord par les islamistes. Ces lettres tentent d’expliquer la reconnaissance enthousiaste et l’accueil triomphal du peuple Malien fait aux éléments de l’Opération Serval.
Il est intéressant de remarquer que la première correspondance d’Aminata Traoré intervient après le coup d’état de Mars 2012, mené par le capitaine Sanogo. Il est important pour l’auteure de signifier l’antériorité de ce projet de correspondances. Cela étant précisé, les événements douloureux dans son pays vont fortement centrer le regard d’Aminata Traoré sur le Mali faisant de cet aspect de la correspondance le noyau d’un atome autour duquel la pensée de Boubacar Boris Diop, tel un électron, va graviter tout en apportant une ouverture intéressante de son propos au reste de la sous région et du continent. Pour revenir sur ces lettres sur le Mali, elles permettent au lecteur de mesurer l’impact du coup d’état, son évidence, quand on prend une meilleure connaissance du massacre d’Aguelhok(3), de la marche des femmes du camp militaire de Kati sur Bamako, la prise de contrôle de la rébellion du Nord par les islamistes. Ces lettres tentent d’expliquer la reconnaissance enthousiaste et l’accueil triomphal du peuple Malien fait aux éléments de l’Opération Serval.
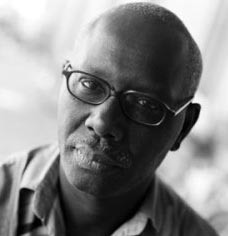 Boubacar B. Diop peut ainsi donner plus de relief aux points développés par Aminata Traoré. Mieux, il tente de pousser la réflexion dans une pensée plus globale, plus panafricaine rappelant les thèses de Cheikh Anta Diop dont il revendique un profond héritage. Il développe son regard sur les printemps arabes, en observe les dérapages funestes au Mali. Le propos de l’intellectuel est percutant sur chaque point qu’il veut bien soumettre au crible de son analyse. Un chat est un chat, il ne saurait l’appeler autrement. Dénoncer ainsi l’imposture française au Mali, regrettant l’ignorance des peuples maliens acclamant l’ancien maître venu en libérateur, il déporte son propos au Rwanda pour offrir un autre type de posture qui, selon lui, n’est malheureusement pas assez peu reconnu par les africains eux-mêmes. Celle de Kagamé, despote éclairé qui redresse le Rwanda après le génocide tutsi dans ce pays. Naturellement, citer le Rwanda quand on échange sur les interventions françaises en Afrique, c’est lourd de sens, l’essayiste sénégalais en a conscience et cela donne de la force à son propos soulignant une réelle liberté de pensée trop rare dans l'espace francophone.
Boubacar B. Diop peut ainsi donner plus de relief aux points développés par Aminata Traoré. Mieux, il tente de pousser la réflexion dans une pensée plus globale, plus panafricaine rappelant les thèses de Cheikh Anta Diop dont il revendique un profond héritage. Il développe son regard sur les printemps arabes, en observe les dérapages funestes au Mali. Le propos de l’intellectuel est percutant sur chaque point qu’il veut bien soumettre au crible de son analyse. Un chat est un chat, il ne saurait l’appeler autrement. Dénoncer ainsi l’imposture française au Mali, regrettant l’ignorance des peuples maliens acclamant l’ancien maître venu en libérateur, il déporte son propos au Rwanda pour offrir un autre type de posture qui, selon lui, n’est malheureusement pas assez peu reconnu par les africains eux-mêmes. Celle de Kagamé, despote éclairé qui redresse le Rwanda après le génocide tutsi dans ce pays. Naturellement, citer le Rwanda quand on échange sur les interventions françaises en Afrique, c’est lourd de sens, l’essayiste sénégalais en a conscience et cela donne de la force à son propos soulignant une réelle liberté de pensée trop rare dans l'espace francophone.
 Alors que le monde entier célèbre le vingtième anniversaire du tragique génocide rwandais, au Burundi, on déplore le vingtième anniversaire d’un assassinat. Celui de Melchior Ndadaye, président du Burundi de juin à octobre 1993, qui faisait partie de la majorité Hutu. Une tentative de coup d’Etat suivie de près par le massacre de milliers de Tutsi, minoritaires au Burundi, puis d’une escalade de violence qui fait écho à celle qui sévissait au Rwanda à la même période. Frontalier du Rwanda, avec lequel il partage certains aspects démographiques, le Burundi a lui aussi été le théâtre de massacres entre Hutu et Tutsi. Représentant de l'Organisation Mondiale de la Santé à Bujumbura au moment des faits, le Dr Mouhtare Ahmed revient sur les constats réalisés par une équipe de l'ONU dépêchée sur les lieux entre 1994 et 1995, et sur sa propre expérience.
Alors que le monde entier célèbre le vingtième anniversaire du tragique génocide rwandais, au Burundi, on déplore le vingtième anniversaire d’un assassinat. Celui de Melchior Ndadaye, président du Burundi de juin à octobre 1993, qui faisait partie de la majorité Hutu. Une tentative de coup d’Etat suivie de près par le massacre de milliers de Tutsi, minoritaires au Burundi, puis d’une escalade de violence qui fait écho à celle qui sévissait au Rwanda à la même période. Frontalier du Rwanda, avec lequel il partage certains aspects démographiques, le Burundi a lui aussi été le théâtre de massacres entre Hutu et Tutsi. Représentant de l'Organisation Mondiale de la Santé à Bujumbura au moment des faits, le Dr Mouhtare Ahmed revient sur les constats réalisés par une équipe de l'ONU dépêchée sur les lieux entre 1994 et 1995, et sur sa propre expérience.
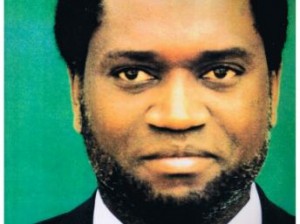 Ndadaye : « ils ont tué Ndadaye, mais ils n’ont pas tué tous les Ndadaye ».
Ndadaye : « ils ont tué Ndadaye, mais ils n’ont pas tué tous les Ndadaye ».