 Au lendemain des élections de l’Assemblée Constituante tunisienne, l’omniprésence médiatique du parti islamiste Ennahda – certes justifiée par sa victoire incontestable, avec 91 sièges sur les 217 que comptera la future assemblée[1] – a laissé dans l’ombre un important acteur de ces élections : Moncef Marzouki, président du Congrès pour la République, formation arrivée seconde avec 30 sièges. Fort de cette seconde place, de plus de trente ans d’opposition, d’un exil prolongé, et de son indéniable charisme tribunicien, Marzouki est assurément l’un des hommes forts de la future Constituante – et, depuis sa déclaration de candidature le 17 janvier 2011, un prétendant sérieux au poste de Président de la République.
Au lendemain des élections de l’Assemblée Constituante tunisienne, l’omniprésence médiatique du parti islamiste Ennahda – certes justifiée par sa victoire incontestable, avec 91 sièges sur les 217 que comptera la future assemblée[1] – a laissé dans l’ombre un important acteur de ces élections : Moncef Marzouki, président du Congrès pour la République, formation arrivée seconde avec 30 sièges. Fort de cette seconde place, de plus de trente ans d’opposition, d’un exil prolongé, et de son indéniable charisme tribunicien, Marzouki est assurément l’un des hommes forts de la future Constituante – et, depuis sa déclaration de candidature le 17 janvier 2011, un prétendant sérieux au poste de Président de la République.
Des droits de l’homme à la politique, itinéraire d’un intransigeant
C’est dans la défense des droits de l’homme que Moncef Marzouki commence son engagement politique : il intègre en 1980 la Ligue Tunisienne des Droits de l’Homme (LTDH), dont il deviendra président en 1989. Toute sa vie, en parallèle de ses engagements politiques, il demeure impliqué dans les organisations de défense des droits de l’homme présentes en Tunisie, principalement la section tunisienne d’Amnesty International et surtout le Conseil National pour les Libertés en Tunisie (CNLT), qui prend en 1998 le relai d’une LDTH jugée trop sensible aux pressions du régime de Ben Ali.
Durant ces années, il fréquente les figures de la défense des droits de l’homme en Tunisie, notamment Sana Ben Achour (membre puis présidente de l’Association Tunisienne des Femmes Démocrates), Kamel Jendoubi (actuellement président de l’Instance supérieure indépendante pour les élections), ou encore Sihem Bensedrine et Naziha Rjiba (alias Oum Zied), journalistes et cofondatrices de la radio libre Kalima. Cependant, à partir de 1994 et de son exclusion du bureau de la LTDH, il prend ses distances avec ce milieu, dont il fustige volontiers les coups bas, l’absence de vue politique, la compromission occasionnelle avec un régime qui se présente alors comme réformateur, et le mépris pour la question sociale.
En effet, à cette époque déjà, les idées politiques de Marzouki sont bien arrêtées, et solidement ancrées à gauche. Il associe aux valeurs traditionnelles des organisations auxquelles il appartient – État de droit, liberté d’expression, laïcité et féminisme – une préoccupation constante pour les revendications sociales, notamment celles de l’intérieur du pays (il est originaire d’un village de Bédouins du sud), qu’ignore trop souvent la bourgeoisie intellectuelle de la côte[2]. Lorsqu’il fait, en 1994, une entrée tardive en politique (il a alors presque cinquante ans), son corpus idéologique est entièrement formé et cohérent.
C’est son exclusion de la LTDH, au profit d’une tendance plus compréhensive envers le régime Ben Ali, qui déclenche sa véritable prise de conscience politique. Le médecin qu’il est réalise alors que la défense des droits de l’homme, seule, ne traite que les symptômes, et pas la maladie[3] : les moyens de l’État policier de Ben Ali sont infinis, et les organisations de la société civile ne peuvent qu’être écrasées ou survivre en collaborant plus ou moins. Le régime est le véritable et unique ennemi.
Lorsqu’il participe à la création du CNLT, plus radical que la LTDH, il a déjà acquis ses galons de tribun politique, à travers une candidature de témoignage – bien vite avortée – à la Présidence de la République. En Tunisie, puis à l’étranger lorsqu’il est forcé à l’exil, il se fait un dénonciateur virulent du régime de Ben Ali[4]. Jusqu’aux élections de 2009, qu’il appellera à boycotter, il ne cesse d’affirmer qu’aucun compromis n’est possible avec la dictature, qu’aucun droit ne doit être acquis par compromission avec le régime, et que sa chute est le préalable à toute discussion sur l’avenir de la Tunisie. Il n’hésite pas à égratigner dans ses discours d’autres représentants de l’opposition, qui croient – ou ont cru – à une évolution graduelle du régime vers plus de démocratie.
Pour structurer son activité politique, il lui faut un parti : ce sera le Congrès pour la République (CPR), qu’il crée avec Naziha Rjiba. « La » République, parce qu’il entend fonder la première véritable République Tunisienne – celle de Bourguiba n’étant, dit-il, qu’une dictature, et celle de Ben Ali une dictature pire encore.
Les islamistes, alliés stratégiques ou idéologiques ?
Jusqu’au-boutiste dans son opposition à Ben Ali, Marzouki se montre nettement plus enclin au compromis lorsqu’il s’agit de négocier avec les autres forces de l’opposition – particulièrement les islamistes d’Ennahda, qui en constituent la frange la plus cohérente et la mieux organisée. Il s’est déjà rapproché des islamistes lors de son passage à la LTDH, où il a pu constater qu’ils étaient, comme les militants gauchistes et libéraux, victimes de la répression du régime, mais attiraient moins la sympathie des élites intellectuelles et laïques.
Cependant, s’il sympathise avec des islamistes dont il défend les droits, Marzouki est encore, au début des années 1990, méfiant envers cette tendance politique. En effet, au-delà de son attachement à la laïcité, alors toujours vivace, il soupçonne les islamistes de ne pas accorder la même valeur que lui à la liberté individuelle, de rechercher des points de convergence avec le régime en place, et de s’accommoder de l’autoritarisme pourvu qu’ils y soient associés – comme les Frères Musulmans dans l’Égypte de Sadate.
Le renversement s’amorce en 2001 : en créant le CPR, Marzouki intègre plusieurs anciens islamistes à son parti, qu’il présente comme un front ayant vocation à rassembler toutes les sensibilités de l’opposition. C’est toutefois en mai 2003 que se produit la véritable rupture. À Aix-en-Provence, lors d’une rencontre rassemblant pour la première fois toute l’opposition tunisienne, le CPR s’associe aux islamistes d’Ennahda dans l’écriture d’une charte commune, qui sera la base de la Déclaration de Tunis du 17 juin 2003, dont Marzouki est l’un des maîtres d’œuvre, et qui demeure, encore aujourd’hui, le fondement de leur alliance.
Cette Déclaration suscite la réprobation des autres partis de l’opposition de gauche. Les laïcs les plus radicaux, regroupés autour du Mouvement Ettajdid, refusent d’entrée de jeu de participer à son élaboration. Les deux grands partis de gauche, le Parti Démocrate Progressiste (PDP) et le Forum Démocratique pour le Travail et les Libertés (FDLT) participent aux travaux préparatoires de la Déclaration, mais s’abstiennent finalement de la signer[5]. En effet, bien que largement consensuelle, et affirmant l’égalité entre hommes et femmes, la Déclaration n’utilise jamais le mot de « laïcité » et préfère exiger, de manière plus ambiguë, « le respect de l’identité du peuple et de ses valeurs arabo-musulmanes, la garantie de la liberté de croyance à tous et la neutralisation politique des lieux de culte ».
Marzouki se retrouve alors dans une position particulière : avec la défection du PDP et du FDTL, il devient involontairement le représentant non-officiel de cette gauche qui accepte de s’allier avec les islamistes – un statut qui lui sera, tour à tour, un compliment de la part de ceux qui louent son sens du compromis, et un reproche dans la bouche de ses anciens alliés laïcs qui l’accusent de trahison.
Car ce compromis avec les islamistes, qui apparaît de prime abord comme une décision purement stratégique de rassemblement de l’opposition (stratégie qui est celle de Marzouki depuis la création du CPR), semble progressivement prendre une dimension idéologique : sans s’aligner sur les positions d’Ennahda en ce qui concerne la place de la religion dans la sphère publique, Marzouki leur cède néanmoins du terrain sur la question de la laïcité.
En particulier, dans un ouvrage publié en 2005[6], Marzouki expose une vision de la question religieuse largement compatible avec celle des islamistes. Il y affirme que l’islam, l’appartenance à la Oumma, est la « clef de voûte » de l’identité tunisienne, comme de toutes les identités arabes, et qu’au contraire la laïcité, c’est-à-dire la relégation de la religion dans la sphère privée, est un concept propre à un Occident chrétien, où l’Église formait une entité facile à définir et par conséquent, facile à exclure du champ politique. Ainsi, Bourguiba aurait « violent[é] » la Tunisie en voulant lui imposer une laïcité occidentale. Et Marzouki d’affirmer : « À la question, comment peut-on être laïque en terre d’islam, la réponse est qu’on ne peut pas l’être, à moins de l’être à la façon d’un corps étranger dans un organisme ».
Il est vrai que dans le même ouvrage, et plusieurs fois encore par la suite, il ne manque pas de préciser que, bien qu’il ne défende pas l’instauration d’une laïcité « à la française » en Tunisie, il entend néanmoins en voir appliquée « non la forme, mais l’essence », et notamment l’égalité entre hommes et femmes. Cependant dans ses discours, s’il insiste systématiquement sur la nécessité de défendre cette égalité des sexes, il s’abstient de mentionner d’autres droits qui appartiennent pourtant à « l’essence » de la laïcité, notamment une liberté d’expression incluant le droit de critiquer la religion[7].
Dans un livre d’entretiens publié en 2009[8], les positions politiques de Marzouki, qui conjuguent une sensibilité de gauche affirmée – notamment du point de vue social et institutionnel – et un rappel constant des spécificités qu’impose « l’identité arabo-musulmane » de la Tunisie, sont à nouveau réaffirmées. Le choix du coauteur n’est du reste pas innocent. Vincent Geisser est en effet un grand spécialiste de la politique tunisienne, mais considère également, dans plusieurs écrits, qu’une laïcité trop affirmée est une forme d’autoritarisme, et que les mouvements islamistes constituent un espoir démocratique contre les dictatures laïques ou pseudo-laïques du monde arabe.
Après 2011 : une indépendance à conquérir
Après la chute de Ben Ali, en janvier 2011, la volonté de Marzouki de constituer un gouvernement d’union nationale incluant notamment les islamistes n’est pas un secret. Lorsque le CPR crée la surprise en arrivant second aux élections de l’Assemblée Constituante, (malgré un financement beaucoup plus limité que celui d’autres partis), son alliance avec Ennahda au sein de la future assemblée ne fait aucun doute.
Étrangement, le discours de Marzouki envers les islamistes se fait alors moins souple. S’il refuse de les diaboliser et accepte de gouverner avec eux, il ne cesse, depuis le 23 octobre 2011, d’affirmer que lui-même et son parti resteront extrêmement vigilants sur les atteintes aux libertés publiques en général, et à l’égalité entre hommes et femmes en particulier. Il s’oppose en outre à l’instauration d’un régime parlementaire où une unique Assemblée détiendrait tous les pouvoirs, position que les islamistes défendent pourtant depuis les premiers jours qui ont suivi la fuite de Ben Ali.
C’est que Moncef Marzouki a compris que la faiblesse relative du CPR par rapport à Ennahda risque de le marginaliser au sein de la coalition, de le transformer en caution droit-de-l’hommiste d’un gouvernement islamiste. Il doit donc faire valoir ses spécificités : des convictions de gauche en matière économique, alors qu’Ennahda est plutôt libéral économiquement et socialement, et surtout un bilan irréprochable en matière de défense des libertés individuelles, alors que le Mouvement de la Tendance Islamique, ancêtre d’Ennahda, s’était compromis à la fois par des positions anti-laïques radicales et par une collaboration avec la dictature de Ben Ali entre 1987 et 1988.
Durant plus de quinze ans d’activisme politique, la stratégie de Marzouki se distinguait par son manichéisme assumé : la dictature de Ben Ali était l’ennemi à abattre sans compromissions, et le rassemblement de l’opposition justifiait le dépassement de toutes les divergences idéologiques. À présent que l’ancien opposant se voit donner une chance de tester l’exercice des responsabilités, il s’apprête à s’opposer à sa famille politique originelle, et à composer avec celle qui est sans doute la plus éloignée de ses convictions.
Dans ses relations avec son allié islamiste, il lui faudra apprendre à combiner la rigidité morale dont il s’est longtemps prévalu, avec la force de compromis dont il s’est montré capable. Un équilibre délicat pour Marzouki l’intransigeant, le tribun, le dénonciateur. Un défi à relever pour Marzouki le tacticien. Un dernier espoir, à 66 ans, de servir son pays, pour un homme politique dont l’originalité ne s’est pas démentie depuis plus de quinze ans.
Par David APELBAUM, article initiallement paru chez ArabsThink
[1] Cet article ne mentionne que les nombres de sièges, qui traduisent le mieux la répartition du pouvoir au sein de la constituante. En effet, les pourcentages en nombres de sièges ne représentent pas toujours les pourcentages de suffrages exprimés : ainsi, Ennahda occupera plus de 41% des sièges, mais a obtenu moins de 37% des votes. Les chiffres donnés dans cet article correspondent aux résultats électoraux provisoires.
[2] Préoccupation pertinente, puisque les mouvements qui ont provoqué la chute du régime de Ben Ali ont pris leurs racines dans la contestation sociale des régions intérieures du pays – contestation qui avait déjà été amorcée par les émeutes ouvrières de Gafsa et Redeyef en 2008.
[3] Il emploiera lui-même cette métaphore à plusieurs reprises.
[4] Moncef Marzouki a ainsi été
l’invité de l’association Sciences Po Monde Arabe, partenaire de
ArabsThink.com, à trois reprises durant l’année 2009 : le 5 mars pour intervenir lors d’une conférence sur la lutte contre la corruption dans le Maghreb, le 2 avril pour débattre avec des étudiants sur la possible démocratisation du monde arabe, et enfin le 10 octobre pour participer à un colloque exceptionnel confrontant les figures de l’opposition tunisienne à des représentants du régime.
[5] Le Mouvement Ettajdid, rassemblé avec ses alliés au sein du Pôle Démocratique Moderniste (PDM), a obtenu 5 sièges à l’Assemblée Constituante ; le PDP a obtenu 17 sièges ; le FDTL (
alias Ettakatol) a obtenu 21 sièges. Idéologiquement, ces trois partis se rattachent à la social-démocratie laïque. Alors que le Mouvement Ettajdid et le PDP avaient axé une grande partie de leur campagne sur la dénonciation d’Ennahda et de l’islam politique, le FDLT a adopté une position modérée, sans pour autant se poser en allié potentiel d’Ennahda. Au lendemain des élections, Mustapha Ben Jafaar, secrétaire général du FDLT, a indiqué que son parti examinait la possibilité de participer à un gouvernement de coalition aux côtés d’Ennahda et du CPR.
[6] Le mal arabe – Entre dictatures et intégrismes : la démocratie interdite, 2005, l’Harmattan ; les réflexions qui suivent sont tirées du chapitre intitulé « Préalable à une greffe réussie », pp. 136 à 153.
[7] La liberté d’expression a été remise au cœur des débats sur la place de la religion en Tunisie, suite à des manifestations islamistes contre la diffusion, le 7 octobre 2011, par la chaîne Nessma TV, du film
Persépolis, où Dieu apparaît sous les traits d’un vieillard barbu, alors que la représentation de Dieu est interdite par l’islam.
[8] Dictateurs en sursis : une voie démocratique pour le monde arabe, entretiens avec Vincent Geisser, Éditions de l’Atelier, 2009 ; une seconde édition revue et augmentée a été publiée en mai 2011, sous le titre Dictateurs en sursis : la revanche des peuples arabes.
 En septembre 2015, les pays arabes devront s’engager à contribuer aux ambitieux objectifs de développement durable (ODD). Les atteindre représente d’autant plus un défi que les Printemps arabes ont mis à mal les progrès sociaux et économiques que ces pays avaient connu au début du XXIe siècle. Une approche originale en nexus devrait être développée, mettant l’accent sur les priorités de l’emploi des jeunes, de la décentralisation et de l’aménagement du territoire.
En septembre 2015, les pays arabes devront s’engager à contribuer aux ambitieux objectifs de développement durable (ODD). Les atteindre représente d’autant plus un défi que les Printemps arabes ont mis à mal les progrès sociaux et économiques que ces pays avaient connu au début du XXIe siècle. Une approche originale en nexus devrait être développée, mettant l’accent sur les priorités de l’emploi des jeunes, de la décentralisation et de l’aménagement du territoire.



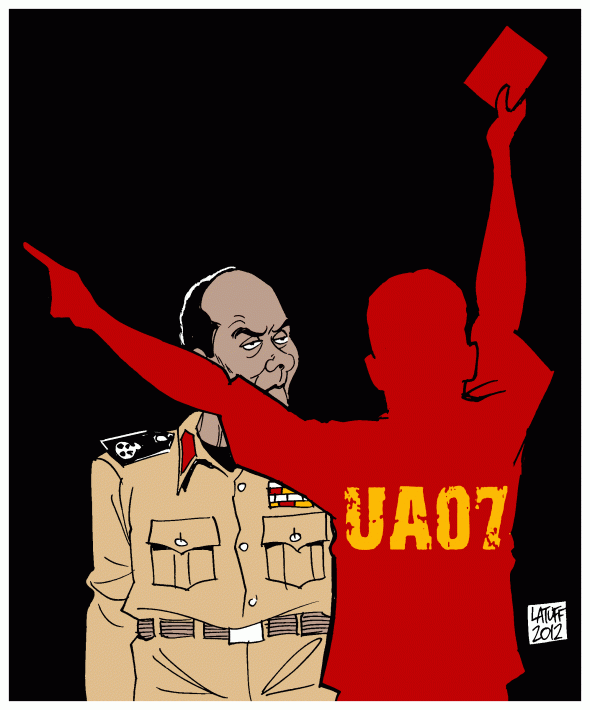
 Certains livres méritent qu’on s’arrête sur rayon, qu’on cède au désir d’en connaître le contenu, ne serait-ce que parce que le menu est annonciateur de rupture, d’originalité et par conséquent de discours nouveaux. L’éditeur français Philippe Rey s’est associé au projet de voir deux intellectuels africains de premier plan pousser leurs réflexions, dans le cadre d’un échange épistolaire sur près de deux ans. Cet échange porte sur des faits qui ont marqué récemment le continent africain, plaçant ce dernier au cœur de l’actualité internationale : le « printemps » arabe (avec une acuité particulière portée sur l’épisode libyen) et la longue crise malienne. Aminata Dramane Traoré (1), altermondialiste déterminée, essayiste, ancienne ministre de la culture au Mali a pris le temps d’échanger durant près de deux ans avec le romancier et essayiste sénégalais Boubacar Boris Diop, auteur du fameux Murambi, Le livre des ossements et du roman en ouolof Doomi Golo.
Certains livres méritent qu’on s’arrête sur rayon, qu’on cède au désir d’en connaître le contenu, ne serait-ce que parce que le menu est annonciateur de rupture, d’originalité et par conséquent de discours nouveaux. L’éditeur français Philippe Rey s’est associé au projet de voir deux intellectuels africains de premier plan pousser leurs réflexions, dans le cadre d’un échange épistolaire sur près de deux ans. Cet échange porte sur des faits qui ont marqué récemment le continent africain, plaçant ce dernier au cœur de l’actualité internationale : le « printemps » arabe (avec une acuité particulière portée sur l’épisode libyen) et la longue crise malienne. Aminata Dramane Traoré (1), altermondialiste déterminée, essayiste, ancienne ministre de la culture au Mali a pris le temps d’échanger durant près de deux ans avec le romancier et essayiste sénégalais Boubacar Boris Diop, auteur du fameux Murambi, Le livre des ossements et du roman en ouolof Doomi Golo.
 Il est intéressant de remarquer que la première correspondance d’Aminata Traoré intervient après le coup d’état de Mars 2012, mené par le capitaine Sanogo. Il est important pour l’auteure de signifier l’antériorité de ce projet de correspondances. Cela étant précisé, les événements douloureux dans son pays vont fortement centrer le regard d’Aminata Traoré sur le Mali faisant de cet aspect de la correspondance le noyau d’un atome autour duquel la pensée de Boubacar Boris Diop, tel un électron, va graviter tout en apportant une ouverture intéressante de son propos au reste de la sous région et du continent. Pour revenir sur ces lettres sur le Mali, elles permettent au lecteur de mesurer l’impact du coup d’état, son évidence, quand on prend une meilleure connaissance du massacre d’Aguelhok(3), de la marche des femmes du camp militaire de Kati sur Bamako, la prise de contrôle de la rébellion du Nord par les islamistes. Ces lettres tentent d’expliquer la reconnaissance enthousiaste et l’accueil triomphal du peuple Malien fait aux éléments de l’Opération Serval.
Il est intéressant de remarquer que la première correspondance d’Aminata Traoré intervient après le coup d’état de Mars 2012, mené par le capitaine Sanogo. Il est important pour l’auteure de signifier l’antériorité de ce projet de correspondances. Cela étant précisé, les événements douloureux dans son pays vont fortement centrer le regard d’Aminata Traoré sur le Mali faisant de cet aspect de la correspondance le noyau d’un atome autour duquel la pensée de Boubacar Boris Diop, tel un électron, va graviter tout en apportant une ouverture intéressante de son propos au reste de la sous région et du continent. Pour revenir sur ces lettres sur le Mali, elles permettent au lecteur de mesurer l’impact du coup d’état, son évidence, quand on prend une meilleure connaissance du massacre d’Aguelhok(3), de la marche des femmes du camp militaire de Kati sur Bamako, la prise de contrôle de la rébellion du Nord par les islamistes. Ces lettres tentent d’expliquer la reconnaissance enthousiaste et l’accueil triomphal du peuple Malien fait aux éléments de l’Opération Serval.
 Boubacar B. Diop peut ainsi donner plus de relief aux points développés par Aminata Traoré. Mieux, il tente de pousser la réflexion dans une pensée plus globale, plus panafricaine rappelant les thèses de Cheikh Anta Diop dont il revendique un profond héritage. Il développe son regard sur les printemps arabes, en observe les dérapages funestes au Mali. Le propos de l’intellectuel est percutant sur chaque point qu’il veut bien soumettre au crible de son analyse. Un chat est un chat, il ne saurait l’appeler autrement. Dénoncer ainsi l’imposture française au Mali, regrettant l’ignorance des peuples maliens acclamant l’ancien maître venu en libérateur, il déporte son propos au Rwanda pour offrir un autre type de posture qui, selon lui, n’est malheureusement pas assez peu reconnu par les africains eux-mêmes. Celle de Kagamé, despote éclairé qui redresse le Rwanda après le génocide tutsi dans ce pays. Naturellement, citer le Rwanda quand on échange sur les interventions françaises en Afrique, c’est lourd de sens, l’essayiste sénégalais en a conscience et cela donne de la force à son propos soulignant une réelle liberté de pensée trop rare dans l'espace francophone.
Boubacar B. Diop peut ainsi donner plus de relief aux points développés par Aminata Traoré. Mieux, il tente de pousser la réflexion dans une pensée plus globale, plus panafricaine rappelant les thèses de Cheikh Anta Diop dont il revendique un profond héritage. Il développe son regard sur les printemps arabes, en observe les dérapages funestes au Mali. Le propos de l’intellectuel est percutant sur chaque point qu’il veut bien soumettre au crible de son analyse. Un chat est un chat, il ne saurait l’appeler autrement. Dénoncer ainsi l’imposture française au Mali, regrettant l’ignorance des peuples maliens acclamant l’ancien maître venu en libérateur, il déporte son propos au Rwanda pour offrir un autre type de posture qui, selon lui, n’est malheureusement pas assez peu reconnu par les africains eux-mêmes. Celle de Kagamé, despote éclairé qui redresse le Rwanda après le génocide tutsi dans ce pays. Naturellement, citer le Rwanda quand on échange sur les interventions françaises en Afrique, c’est lourd de sens, l’essayiste sénégalais en a conscience et cela donne de la force à son propos soulignant une réelle liberté de pensée trop rare dans l'espace francophone.
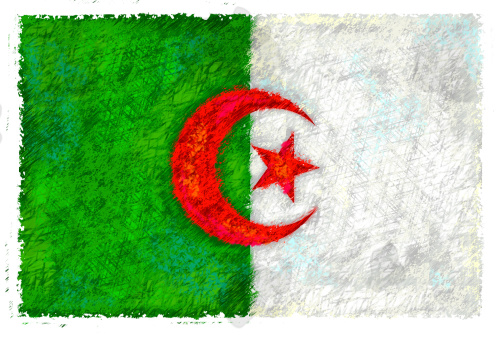 Occuper l’espace public en Algérie ? Cette idée demeure inconcevable pour le régime algérien. Depuis la signature par l’ex-chef du gouvernement, Ali Benflis, le 18 juin 2001, d’un arrêté interdisant les marches à Alger, l’appareil répressif est déployé en vue de mater toute activité organisée dans la rue. Les organisations qui tentent de manifester ou qui essayent d’observer des rassemblements dans la capitale, voient leurs militants arrêtés, embarqués à bord de fourgons de police et incarcérés dans les cellules de commissariats. Le scénario se perpétue depuis une décennie avec son lot multiforme de violations des libertés.
Occuper l’espace public en Algérie ? Cette idée demeure inconcevable pour le régime algérien. Depuis la signature par l’ex-chef du gouvernement, Ali Benflis, le 18 juin 2001, d’un arrêté interdisant les marches à Alger, l’appareil répressif est déployé en vue de mater toute activité organisée dans la rue. Les organisations qui tentent de manifester ou qui essayent d’observer des rassemblements dans la capitale, voient leurs militants arrêtés, embarqués à bord de fourgons de police et incarcérés dans les cellules de commissariats. Le scénario se perpétue depuis une décennie avec son lot multiforme de violations des libertés.

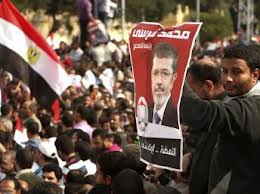



 Au lendemain des élections de l’Assemblée Constituante tunisienne, l’omniprésence médiatique du parti islamiste Ennahda – certes justifiée par sa victoire incontestable, avec 91 sièges sur les 217 que comptera la future assemblée
Au lendemain des élections de l’Assemblée Constituante tunisienne, l’omniprésence médiatique du parti islamiste Ennahda – certes justifiée par sa victoire incontestable, avec 91 sièges sur les 217 que comptera la future assemblée Derrière les
Derrière les  Khadafi l’Africain qui apportait
Khadafi l’Africain qui apportait 