Lors d'un échange passionnant avec Mr Bonaventure MVE ONDO, Philosophe, ancien recteur de la Francophonie et de l'université Omar Bongo, nous nous sommes arrêtés sur des chiffres alarmants : plus de 120 millions de jeunes sortiront des systèmes éducatifs d'ici 2020 en Afrique subsaharienne et les 3/4 de ces jeunes ne trouveront pas d'emploi. Si le marché de l’emploi se raréfie en Europe par exemple, a t-il jamais existé en Afrique ?
Quelles y ont les réelles perspectives d'emploi ? Les entreprises internationales joueront-elles le jeu en créant des emplois dans la sous région ?
Les autorités africaines et internationales ont-elles prévu des plans d'actions opérationnels ? Est-ce que l'entreprenariat ne serait pas une solution efficace pour permettre à un plus grand nombre d'occuper une place d'acteur économique dans une Afrique en pleine croissance ?
Je crois personnellement que l'entrepreunariat est une conséquence logique de la mutation de notre société. En quittant l'ère industrielle pour passer à l'ère de l'information, le nord et le sud se retrouvent dans une situation presque similaire : la nécessité de revoir leurs fondamentaux socio-économiques et l'obligation de concevoir de nouvelles approches dans le domaine du travail. J’imagine parfois que dans un futur proche où nos petits-enfants et arrière-petits-enfants découvriront le « salariat » en allant visiter les musées ! En effet notre économie, fondée sur l’industrialisation et la consommation date du début du 19ème siècle, soit plus de 200 ans ce qui est infiniment petit à l’échelle de l’histoire de l’humanité. Il y a eu d’autres modèles avant et il y a aujourd’hui l’opportunité de créer de nouveaux modèles durables. Ceci est un enjeu majeur pour l’Afrique et une grande responsabilité. Mais c’est surtout une grande chance car contrairement à l’époque industrielle qui nécessitait de gros investissements et des équipements lourds, on peut aujourd’hui créer son entreprise seul chez soi avec un téléphone, un ordinateur, une connexion internet et surtout de la matière grise ! C’est sans précédent. Et pendant que les monopoles perdus nous parlent de « la crise », il n’y a jamais eu autant d’initiatives et de success stories. Même si créer son entreprise nécessite certaines aptitudes et compétences, notamment la gestion, nous serons de plus en plus nombreux à tenter notre chance en « Terre entrepreneuriale». De la révolution industrielle à la révolution individuelle, quelle sera le modèle de développement de l’Afrique à l’aube du 22ème siècle ?
C'est pour faire un tour d'horizon de la situation globale et des spécificités de chaque pays que je me suis tournée vers des opérateurs économiques confirmés ou débutants pour prendre le pouls de cette économie africaine qui fait l'objet de toutes les convoitises.
Episode 1 : Au Bénin les jeunes diplômés créent leur job !
Lors d'un séjour à Cotonou, j'ai eu le plaisir de rencontrer une équipe de jeunes diplômés qui a décidé de prendre son avenir en main en créant sa propre structure. Ils partagent leur expérience et leur vision du futur. Une génération ambitieuse qui est à l'écoute d'un monde qui bouge mais qui doit composer avec ses réalités et les usages locaux.
Entretien avec Steve Hoda, Directeur des opérations et Vianio Kougblenou Directeur Général du cabinet Intellect Consulting
Présentez-nous votre structure
Intellect Consulting est le seul cabinet-conseil pluridisciplinaire du Bénin géré par de jeunes Béninois. Fondé en Janvier 2012, le cabinet propose ses expertises en vue de favoriser le développement économique des pays africains. Les activités du cabinet tournent autour de 7 départements (Recherche-Formation et Développement – Informatique – Communication et Stratégie – Ingénierie solaire – Management des Projets – Juridique – Évènementiel & Création) et repose sur les valeurs telles que la responsabilité, la réactivité, l’éthique et la qualité. Le cabinet, à ce jour, travaille en partenariat avec plus d’une dizaine de partenaires à travers le monde. (Consulter www.intellect-consulting.com pour plus d’informations)
Quelle est globalement la situation des jeunes diplômés au Bénin ?
La question de l’emploi est un véritable problème dans notre pays le Bénin. Il suffit simplement de voir le nombre de candidats lors des concours de la fonction publique pour s’en rendre compte.
Quels sont les dispositifs mis en place pour favoriser l'emploi ? Sont-ils opérationnels ?
Pour favoriser l’emploi, l’État a mis en place des Business Promotion Center (BPC) qui sont des cadres qui incitent les jeunes à la création de leur emploi. Ces BPC accompagnent les micro-entrepreneurs dans leur idée d’entreprise.
En dehors de cela, l’État a mis en place l’Agence Nationale pour le Promotion de l’Emploi qui accompagne également les jeunes dans la mise en œuvre de leur propre entreprise et aussi pour l’employabilité dans une entreprise qu’elle soit privée ou publique. Mais il faut noter que ces structures ne sont pas tellement opérationnelles.
Comment vous est venue l'idée de créer votre entreprise ?
Nous sommes pour la plupart membres de l’Association des Volontaires du développement Durable (AVD-Bénin) qui est une organisation non gouvernementale que nous avons créée en 2011. Vu qu’il était difficile d’avoir des financements et que la plupart d’entre nous étaient diplômés dans divers domaines, nous nous sommes dit « pourquoi ne pas mettre en place un cabinet-conseil pour financer nos activités ? » C’est ainsi que nous avons crée Intellect Consulting.
Comment ont réagi vos familles ?
La génération de nos parents ne sait rien de ce qu’on appelle « entrepreneuriat ». Ils préfèrent voir leurs enfants au sein d’une grande entreprise, signe de réussite pour eux. C’est donc normal qu’ils soient restés sceptiques au départ. Maintenant, ils nous apportent leurs bénédictions puisqu’ils sont conscients qu’il n’est plus facile de trouver un emploi.
Quelles sont les difficultés que vous rencontrez ?
Nous avons deux grandes difficultés. La première est qu’il est difficile pour les banques de nos pays d’accompagner les start-up. Vous êtes donc bien conscients qu’une jeune entreprise qui se bat seule risque de disparaitre. Ce qui fait que le taux de « mortalité » des entreprises est très élevé. À côté de cela, il faut dire que la fiscalité dans notre pays n’est pas une fiscalité de développement. Elle tue plutôt les entreprises.
Deuxième difficulté : Nous sommes très jeunes et la génération des personnes aux affaires ne fait pas confiance à la jeunesse qu’elle estime immature et incompétente.
Comment a été accueillie votre initiative ? Que pensent vos camarades de promotion de votre projet ?
C’est une initiative qui a été bien accueillie et qui force l’admiration autour de nous. Nos amis de promotion sont fiers de nous même s’ils trouvent le pari trop risqué.
Quels sont vos atouts ?
Nos atouts : Nous sommes jeunes diplômés dans plusieurs domaines (droit, informatique, journalisme, économie, gestion, finance, ingénierie solaire, e-marketing…). Nous avons fait pour la plupart des expériences dans de grandes entreprises de la place.
Intellect-Consulting s’est également entouré de personnes qui ont du succès dans leur domaine d’expertise, afin de bénéficier d’une formation continue pour notre équipe car nous souhaitons apporter un service de haute qualité sur le marché africain. Nous avons noué des partenariats avec des entrepreneurs & des experts en France, en Suisse, au Sénégal, au Togo, au Canada et en Inde. Ils nous apportent leur concours sur le plan méthodologique et sur le plan des idées.
Pour nous faire connaître et vulgariser le métier de consultant et plus largement la prestation de service intellectuel, nous avons également un magazine économique en ligne « LeConsultant » : http://intellect-consulting.com/la-mediatheque/bulletin/
Qu'apportez-vous à vos clients ?
Nous accompagnons nos clients pour développer leur chiffre d’affaires tout en adoptant une attitude éco-responsables. Tout le monde fait du business au Bénin, mais combien d’entreprises sont vraiment rentables ? Nous les aidons à préparer l’avenir en étant plus performantes.
Quels objectifs souhaitez-vous atteindre ?
Notre objectif : accompagner sur les trois prochaines années plus de 100 entreprises à développer leurs activités et leur chiffre d’affaires dans la sous-région.
Vous êtes-vous déjà imaginé ce que vous deviendrez dans 10 ans ?
Dans 10 ans, nous envisageons devenir un grand groupe qui accompagne les chefs d’États africains dans les processus de développement économique. C’est pourquoi, nous avons travaillé sur la vision de l’Afrique à l’orée 2050 que vous pouvez lire en allant sur ce lien : http://stevehoda.over-blog.com/2014/04/quand-intellect-consulting-vous-plonge-dans-l-afrique-de-2050.html
Quelles sont les aptitudes indispensables pour réussir ?
Pour réussir, il faut avoir une vision, des objectifs clairs et mettre les moyens nécessaires pour atteindre ces objectifs. Cela demande beaucoup de discipline, de rigueur et surtout de persévérance.
Quels conseils donneriez-vous à des jeunes qui veulent se lancer ?
Pour les jeunes qui veulent se lancer, nous les encourageons et nous leur disons qu’ils ont fait le meilleur choix. Maintenant, il leur revient de bien mûrir leur idée de projet, de s’entourer de personnes qui partagent la même vision qu’eux et de maintenir l’esprit d’équipe.
Ils rencontreront certainement des difficultés qui sont des marches vers le succès. Ils ont donc besoin d’un esprit guerrier pour avancer.
Quels sont vos prochains défis ?
- Mettre en place différentes micro-entreprises à travers le projet CAFE (Conférence/Plan d’Action Africain sur l’Entrepreneuriat). À cet effet, nous travaillons avec Lawson Investissements pour la mise en place d’une ferme agricole à Zinvié au Bénin.
- Servir de foyer d’opérationnalisation pour aider la diaspora à investir au Bénin.
- Amener tous les professionnels, élèves et étudiants à maitriser les logiciels de leur domaine respectif.
- Installer l’énergie solaire dans bon nombre de foyers béninois.
Article de Jenny-Jo Delblond Coach financière et passionnée d’entrepreneuriat elle est spécialiste de l’éducation financière. Elle intervient en France, aux Antilles et en Afrique pour accompagner les entrepreneurs et les chefs d’entreprises. Conférencière, consultante et formatrice elle démystifie l’argent et permet aux gens de développer leur créativité financière pour augmenter leurs revenus et améliorer leur qualité de vie. Jenny-Jo a coutume de dire qu’elle est diplômée de la Haute École de la Vie, car autodidacte, c’est dans les entreprises qu’elle acquiert son expertise pratique dans le domaine des affaires et de la vente.











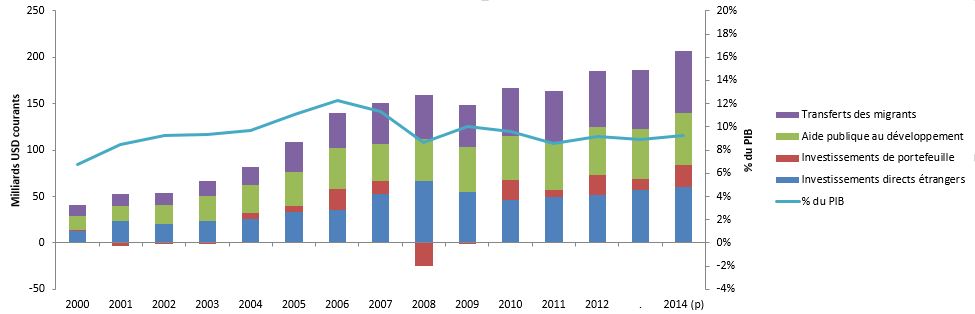



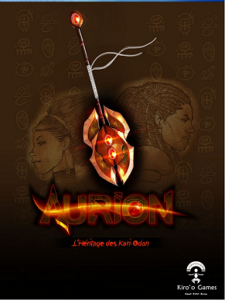 L’industrie des jeux vidéo en Afrique est encore embryonnaire, contrairement aux autres régions du monde où elle représente un secteur clé de l’économie. Cependant, cette industrie voit aujourd’hui l’émergence de
L’industrie des jeux vidéo en Afrique est encore embryonnaire, contrairement aux autres régions du monde où elle représente un secteur clé de l’économie. Cependant, cette industrie voit aujourd’hui l’émergence de 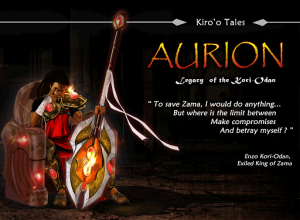 Le jeu Aurion de Kiro’o Games
Le jeu Aurion de Kiro’o Games
 Racine Demba, membre de Terangaweb – L'Afrique des Idées, a récemment rencontré les responsables du Synapse Center, une organisation basée à Dakar qui accompagne les jeunes Sénégalais dans leurs projets d'entreprenariat. Résumé de leur entretien.
Racine Demba, membre de Terangaweb – L'Afrique des Idées, a récemment rencontré les responsables du Synapse Center, une organisation basée à Dakar qui accompagne les jeunes Sénégalais dans leurs projets d'entreprenariat. Résumé de leur entretien.
 Le 12 Octobre, l’association
Le 12 Octobre, l’association  On a ainsi appris que les difficultés des femmes africaines ne sont pas toujours là où on pourrait le penser : entreprendre et être une femme africaine n’est ni impossible, ni incompatible. Les jeunes femmes et hommes africains ont des capacités et des possibilités : ils se doivent de les exploiter !
On a ainsi appris que les difficultés des femmes africaines ne sont pas toujours là où on pourrait le penser : entreprendre et être une femme africaine n’est ni impossible, ni incompatible. Les jeunes femmes et hommes africains ont des capacités et des possibilités : ils se doivent de les exploiter !
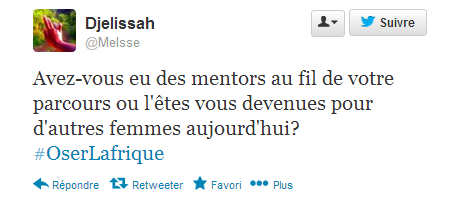
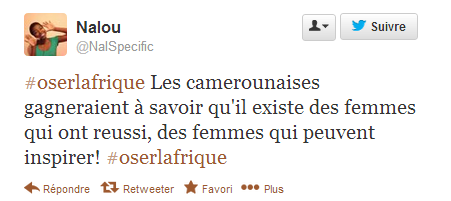
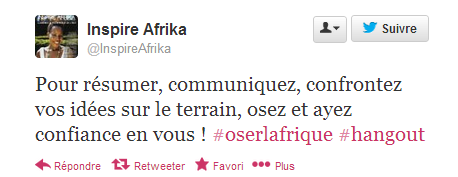
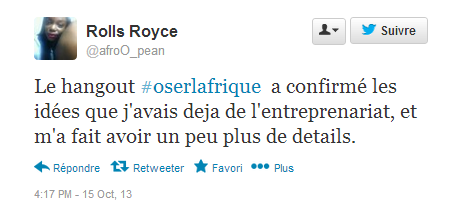
 L’entrepreneuriat, un concept développé par l’économiste Joseph Schumpter en 1950 a de nos jours le vent en poupe sur le continent africain. Au lancement de sa tournée africaine portant sur le social business en 2006, Muhammad Yunus Professeur économiste et prix Nobel de la paix a déclaré que l’entreprenariat serait la clé du développement de l’Afrique.
L’entrepreneuriat, un concept développé par l’économiste Joseph Schumpter en 1950 a de nos jours le vent en poupe sur le continent africain. Au lancement de sa tournée africaine portant sur le social business en 2006, Muhammad Yunus Professeur économiste et prix Nobel de la paix a déclaré que l’entreprenariat serait la clé du développement de l’Afrique.

 Laurent Liautaud, peux-tu te présenter à nos lecteurs ?
Laurent Liautaud, peux-tu te présenter à nos lecteurs ?
 Yannick Ebibié est le président de l’association One Gabon, qui promeut la culture de l’entreprenariat et soutient des entrepreneurs dans leur montage de projet et leur recherche de financement au Gabon. Il se confie aux lecteurs de Terangaweb – l’Afrique des idées sur l’action de son association et sa lecture des potentialités qu’offre le financement participatif – crowdfunding en anglais – pour les entrepreneurs africains.
Yannick Ebibié est le président de l’association One Gabon, qui promeut la culture de l’entreprenariat et soutient des entrepreneurs dans leur montage de projet et leur recherche de financement au Gabon. Il se confie aux lecteurs de Terangaweb – l’Afrique des idées sur l’action de son association et sa lecture des potentialités qu’offre le financement participatif – crowdfunding en anglais – pour les entrepreneurs africains.

 Il y a des modèles de financement différents suivant les plateformes. Sur certaines, ce sont des prêts avec intérêts. Pour Kiva et ONE Gabon, tu donnes de l’argent, qui te sera remboursé progressivement, sans intérêt. Kickstarter est plus dans le don. De manière générale, je pense que ce nouveau procédé, rendu possible grâce à la technologie et aux nouveaux réseaux virtuels, représente une opportunité très important dont beaucoup d’Africains pourraient profiter. Au sein de notre association, nous souhaitons étudier la question pour comprendre quels sont les freins au développement du financement participatif au Gabon. Une première observation, c’est que souvent les institutions de micro-finance ne parviennent pas à atteindre les standards exigés par les plateformes tels que Kiva. Il y a donc sans doute un travail à mener pour mieux accompagner les différentes acteurs engagés dans le microfinancement, et sans doute faire évoluer le cadre réglementaire qui entoure ce secteur.
Il y a des modèles de financement différents suivant les plateformes. Sur certaines, ce sont des prêts avec intérêts. Pour Kiva et ONE Gabon, tu donnes de l’argent, qui te sera remboursé progressivement, sans intérêt. Kickstarter est plus dans le don. De manière générale, je pense que ce nouveau procédé, rendu possible grâce à la technologie et aux nouveaux réseaux virtuels, représente une opportunité très important dont beaucoup d’Africains pourraient profiter. Au sein de notre association, nous souhaitons étudier la question pour comprendre quels sont les freins au développement du financement participatif au Gabon. Une première observation, c’est que souvent les institutions de micro-finance ne parviennent pas à atteindre les standards exigés par les plateformes tels que Kiva. Il y a donc sans doute un travail à mener pour mieux accompagner les différentes acteurs engagés dans le microfinancement, et sans doute faire évoluer le cadre réglementaire qui entoure ce secteur.

