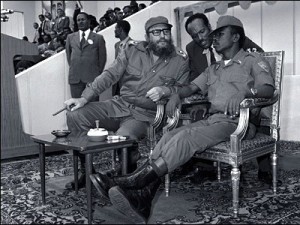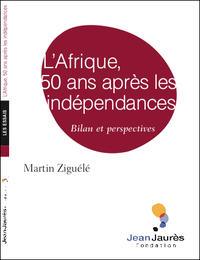La principale critique que l’on puisse adresser à l’afro-pessimisme est son fatalisme. L’Afrique serait incapable de valoriser ses ressources humaines à venir. Les taux de croissance élevés des pays émergents s’expliquent avant tout par la réallocation du facteur travail – la main d’œuvre – de l’économie du secteur primaire ou de l’économie informelle d’autosubsistance vers le secteur secondaire et tertiaire, à forte valeur ajoutée. Selon les afro-pessimistes, l’Afrique serait incapable d’une telle réallocation de sa main-d’œuvre. Alors que l’histoire récente nous offre des exemples d’une telle réussite ailleurs dans le monde, quel est l’argument qui expliquerait que l’Afrique ne puisse y arriver ? Un biais culturel ? Des institutions irrémédiablement faibles et des politiques intrinsèquement corrompus ?
La principale critique que l’on puisse adresser à l’afro-pessimisme est son fatalisme. L’Afrique serait incapable de valoriser ses ressources humaines à venir. Les taux de croissance élevés des pays émergents s’expliquent avant tout par la réallocation du facteur travail – la main d’œuvre – de l’économie du secteur primaire ou de l’économie informelle d’autosubsistance vers le secteur secondaire et tertiaire, à forte valeur ajoutée. Selon les afro-pessimistes, l’Afrique serait incapable d’une telle réallocation de sa main-d’œuvre. Alors que l’histoire récente nous offre des exemples d’une telle réussite ailleurs dans le monde, quel est l’argument qui expliquerait que l’Afrique ne puisse y arriver ? Un biais culturel ? Des institutions irrémédiablement faibles et des politiques intrinsèquement corrompus ?
Il est important à cet égard d’analyser les ressorts psychologiques et idéologiques qui animent l’afro-pessimisme et l’afro-optimisme. L’afro-pessimisme s’inscrit bien sûr dans la tendance longue d’une certaine forme de paternalisme occidental, l’équation démographie galopante et non résilience du tissu économique ne servant qu’à envelopper poliment un regard culturaliste dépréciateur sur les Africains qui ne seraient « pas encore entrés dans l’Histoire »[1] pour certains, qui seraient tout simplement une race inférieure pour d’autre. Mais l’afro-pessimisme, tel qu’il s’énonce notamment en Europe à partir des années 1990, présente aussi une grande nouveauté par rapport à cette tradition, et n’en est parfois pas même issu. Ce discours s’inscrit aussi aujourd'hui dans le courant des catastrophistes et angoissés du nouveau millénaire. La dérive sécuritaire et les politiques anti-immigrés des démocraties du monde développé en sont quelques-uns des symptômes. Le monde court à sa perte : développement des virus transfrontaliers, réchauffement climatique et catastrophes naturelles, choc des cultures et des civilisations, prolifération du terrorisme, menaces contre l’identité et les valeurs de l’Occident. Dans cette vision, l’Afrique serait le chaudron de toutes ces catastrophes : une masse d’affamés du Sud qui cherchent à tout prix un avenir meilleur au Nord qu’ils mettent en danger ; des gens culturellement différents qui attisent les peurs et la violence, bref, une menace directe ou indirecte au modèle Occidental. L’afro-pessimisme découle en partie du sentiment d’assiégé et de déclin qui se propage chez certains groupes d’opinion en Europe et en Amérique du Nord. Il appelle à un interventionnisme occidental : il faut aider les Africains qui courent à leur perte, incapables qu’ils sont de se prendre en main tout seul, et qui risquent en plus de nous entraîner avec eux dans leur abysse de problèmes. Cet interventionnisme afro-pessimiste peut se parer des mêmes atours de bons sentiments et de réelle bonne volonté qui caractérisait en son temps la mission civilisatrice des puissances coloniales. Il débouche parfois même sur des initiatives louables, sous la forme d’appels à l’aide au développement ou à l’aide humanitaire d’urgence.
Il serait toutefois extrêmement réducteur d’affirmer que l’afro-pessimisme soit l’apanage des non-Africains, des Occidentaux. En effet, nombre d’Africains sont des afro-pessimistes. Cinquante années de désillusions ont nourri ce sentiment chez beaucoup d’enfants du continent noir. Le bouc-émissaire habituel est trouvé en la personne des élites africaines : corrompues, non patriotiques, asservies à l’Occident, elles seraient les principales fossoyeurs de l’Afrique postcoloniale. Le problème est que ce constat ne s’applique pas seulement au personnel politique au pouvoir, mais affecte également l’opposition, les milieux d’affaires, les intellectuels, et par extension toute personne qui sort du lot et qui pour cette raison est suspecte. Tous corrompus, tous pourris ! Et ceux qui ne le sont pas, c’est juste parce qu’ils n’en auraient pas eu l’occasion… Les afro-pessimistes du continent ne croient pas en eux et aux Africains. Beaucoup se sont également réappropriés des clichés culturels comme celui sur l’indolence supposée des Africains par rapport aux Chinois. Mais la principale source de l’afro-pessimisme reste l’incompréhension de la situation actuelle, des facteurs explicatifs du « sous-développement » africain et des moyens à mettre en œuvre pour restaurer une fierté et une puissance sur la scène internationale que chacun caresse secrètement. Les mécanismes de la Modernité du système socio-économique dans lequel nous vivons échappent à la plupart des habitants du continent qui, faute d’explications et de discours prospectifs clairs, peuvent éventuellement s’enfermer dans le pessimisme et la prostration.
L'afro-optimisme, discours des marchés
Le discours de l’afro-optimisme, notamment dans sa variante actuelle sur l’ « émergence » de l’Afrique, est quant à lui un discours des marchés financiers et des classes entrepreneuriales, un discours d’auto-persuasion, destiné à susciter la confiance, et notamment celle des investisseurs. Le problème de ce discours est qu’il est aveugle à beaucoup trop d’éléments qui constituent la réalité africaine. Ainsi de la déconnexion croissante entre d’une part une infime partie de la société, connectée au système financier et économique mondialisé, qui bénéficie des facilités d’accès aux financements, de déplacement des biens et des personnes ; et d’autre part l’écrasante majorité de la population qui reste dans une économie d’autosubsistance précapitaliste, ou même de la catégorie basse de la classe moyenne, celle des fonctionnaires d’Etat et des petits employés, qui vivent avec de faibles salaires souvent irréguliers, et dont le quotidien est fait de débrouilles et autres combines pour assurer le mode de vie de leur statut social semi-privilégié.
Aveuglement aussi sur les lacunes d’un agrégat comme la croissance moyenne des pays africains, qui cache d’énormes disparités entre les taux de croissance des pays exportateurs de pétrole et de gaz (Angola, 20% de croissance du PIB en 2007) et des pays en crise comm le Zimbabwe (contraction de -6,9% du PIB en 2007). Aveuglement sur l’impact social extrêmement faible de ces taux de croissance élevés quand ils existent : la situation sociale en Angola, en Guinée-Equatoriale ou en Tunisie est à ce titre très parlante. De plus, la plupart des économies qualifiées d’émergentes en Afrique[2] ne sont pas des économies diversifiées et sont donc à la merci de tout retournement du marché sur lequel s’appuient leurs exportations.
L'aveuglement de l'afro-optimisme face à la dégradation sociale
Le problème de l’afro-optimisme est qu’il s’extasie devant des moyens (l’accès aux capitaux en Afrique, le renforcement relatif des institutions politiques et économiques) qui ne servent pourtant pas encore à répondre aux fins légitimes attendues par les populations africaines : assurer du travail au plus grand nombre, assurer les conditions minimales du bien-être de tous. L’Afrique est encore bien loin d’approcher ces objectifs, et n’en prend pas forcément la direction.
Ce discours libéral, en plus d’être simpliste à l’extrême, dangereux socialement, est aussi contre-productif économiquement en proposant l’extraversion de l’économie africaine, réduite au statut d’eldorado du retour sur investissement pour capitaux étrangers. Si l’Afrique souhaite réellement se réapproprier les règles du jeu du capitalisme en particulier et de la Modernité en général, il faudra que son développement soit endogène, s’appuie sur la mobilisation de ses propres ressources, résorbe ses propres tensions internes. Cette mobilisation n’a rien d’évident mais n’est pas impossible.
Emmanuel Leroueil
[1] : Discours de Dakar de Nicolas Sarkozy
[2] : le cabinet de conseil BCG a publié une étude qui répertorie comme économies africaines émergentes l’Afrique du Sud, l’Algérie, le Botswana, l’Egypte, l’île Maurice, la Lybie, le Maroc et la Tunisie.