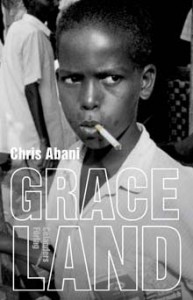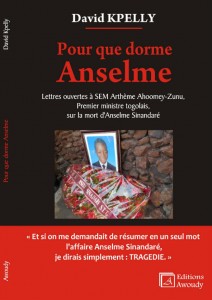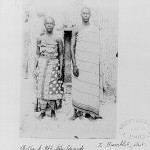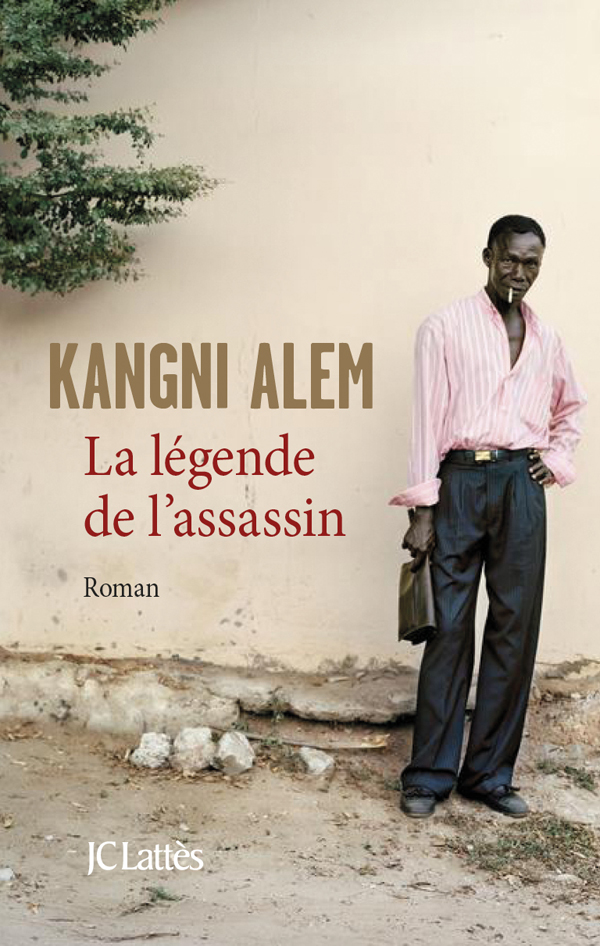Dans le cadre d’un partenariat avec le festival Nollywood, l’Afrique des idées s’est proposée d’être présente sur les lieux du spectacle, à savoir le cinéma l’Arlequin, pour observer les discours de celles et ceux qui font Nollywood, capter les mots du spectateur, prendre le pouls de l'événement. Avec Ndeye Diobaye, nous avons donc été les yeux, les oreilles et occasionnellement la voix de notre thinktank sur la place du cinéma nigérian. Cet article apporte nos regards sur plusieurs oeuvres présentées au Festival Nollywood Week à Paris : Les film Gone too far de Destiny Ekaragha, Dazzling mirage de Tunde Kelani, le documentaire Jimmy goes to Nollywood (avec Jimmy Jean-Louis) et les deux épisodes de Before 30.
Before 30 / Parole de Ndeye
Le hasard fait que ma première séance n’est pas celle d’un film, mais d’une série. Au Nigéria, comme partout dans le monde, m’explique OC Ukeje, acteur dans la série Before 30, « il y a une vraie demande pour du contenu télévisé aujourd’hui ». Le binge-watching n’a donc pas de frontières.
Au vu de son synopsis, Before 30 me rappelle vaguement An African City, une série ghanéenne qui a fait beaucoup de bruits sur les réseaux sociaux l’an dernier. L’histoire est narrée par une jeune avocate, la vingtaine finissante, confrontée aux pressions familiales et sociales qui accablent les femmes nigérianes (voire africaines de façon plus globale) à se marier avant la trentaine.
Même s’il est difficile de conclure sur une série dont il nous a été donnés de voir que le pilote et le second épisode, Before 30 met en avant de manière peu subtile, le cliché de la femme nigériane accomplie cherchant désespérément un potentiel mari. Pour accompagner notre narratrice, Before 30 met en scène une palette de différentes déclinaisons de la femme africaine des temps modernes : une femme musulmane mariée, une chrétienne assez infantile qui ment sur sa virginité et pour finir une femme qui semble bien se moquer des moeurs et entend vivre librement sa sexualité.
Et si j’ai apprécié le ton franc parfois employé par les personnages, le tropisme sur le sujet des hommes était peut-être redondant. A force de tourner en dérision le cliché de femmes accomplies à la recherche du bonheur, on peut parfois se demander si la série est vraiment dénonciatrice de la pression subie par certaines femmes vis-à-vis de la nécessité de se marier. Nous saurons toutefois apprécier la mise en avant de l’histoire d’un groupe de femmes, narré par une femme : OC Ukeje, qui figure dans la série, interrogé après la diffusion répond « Il est temps que l’on parle plus des histoires des femmes dans cette industrie».
Là où Before 30 innove également, c’est dans sa représentation d’une élite nigériane, elle-même d’ordinaire peu friande des productions audiovisuelles nationales. L’accent du décor est exagéré, entre chaussures de marques, restaurants de luxe et mariages à l’étranger :
Il présente « une Afrique au visage différent de celui généralement montré dans les médias ou dans les films» explique OC Ukeje.
« Il est important que les films soient désormais représentatifs de l’Afrique qui bouge ».
Cette Afrique qui bouge est-elle celle qui fréquente les hôtels de luxe comme présentée dans Before 30 ? Si cette série a le mérite, en effet, de montrer les étendus du boom économique que le continent africain connaît aujourd’hui, il est tout aussi important de dénoncer le fait que les femmes sont toujours confrontées aux aléas de sociétés patriarcales.
Si Before 30 a choisi de le faire par la comédie, Dazzling Mirage, de Tunde Kelani, prend un ton plus sérieux. Le film lauréat de l’édition 2015 de la Nollywood Week est saisissant en ce qu’il présente une double problématique en mettant en scène l’histoire d’une femme atteinte de la drépanocytose. Ce drame romantique, adapté du roman d’Oyinka Egbokhare montre la capacité de Nollywood a devenir une vitrine de la culture et de la littérature nigériane. Pour Tunde Kelani, qui a trouvé sa niche dans l’adaptation de romans, Dazzling Mirage a également la lourde tâche de déconstruire les préjugés qui visent les personnes atteints de cette maladie et dénoncer plus particulièrement la condition des femmes atteintes. Bien que tourné dans un anglais parfois maladroit, on peut penser que ce choix de langue est lié à la volonté de permettre à la notoriété du film de dépasser les frontières du Nigéria.
Gone too far vu par Ndeye
Cette comédie, tournée à Londres, qui met en avant le talentueux OC Ukeje, nous expose à la capacité de Nollywood aujourd’hui à franchir les frontières et s’adresser à la diaspora. Dans Gone Too Far, Yemi, un adolescent originaire du Nigéria qui n’a jamais connu Lagos, est confronté à de nombreuses questions identitaires, alimentées par la rivalité existante entre caribéens et africains en Grande-Bretagne. L’arrivée de son grand frère, resté à Lagos, n’arrange en rien les choses pour l’adolescent. La salle est conquise, prise de fous rires et on se prend rapidement à ce déversement de cliché sur le « blédard » tout droit débarquer du continent-mère.
Gone too far vu par Laréus
https://www.youtube.com/watch?v=IEbIkZJgNGgLe premier film qui m’introduit dans le festival s’intitule Gone too far de Destiny Ekaragha. Deux frères séparés par les coutumières contraintes administratives se retrouvent à Londres. L’un a été élevé avec sa mère à Peckham, un quartier difficile de la capitale anglaise et l’autre a évolué dans un internat à Lagos. Tout heureux d’être enfin à Londres. Ce film est une sympathique comédie au coeur d’un Londres qu’on ne connait que très peu et qui met en scène le blédard absolu joué remarquablement par OC Ukéjé qui doit être un acteur de référence à Nollywood. Il est tout simplement étincelant. La réalisatrice de ce film met en scène le choc des identités au sein de ce que beaucoup appelle la communauté noire de Londres. Entre Africains et caribéens, les clichés et zones d’incompréhension sont très nombreux et, de mon point de vue, légitimes. Je ne pense pas m’avancer trop imprudemment en disant que Destiny Ekaragha a été nourrie par les univers de Spike Lee. On retrouve dans l’expédition complexe, que ces deux frères qui ne se connaissent pas, monte pour acheter le « gombo » maternel, un état de lieux, une revue de quartiers qui rappelle des plans si chers au réalisateur américain. Porté par l’humour d’OC Ukéjé, ce film remarquablement tourné traite aussi de l’immigration avec intelligence. Sur la forme, il est très peu crédible d’envisager en moins de 24 heures, autant de péripéties autour de notre blédard bien heureux. Toutefois, quel plaisir de voir un bon film…africain.
Jimmy goes to Nollywood
 C'est le film documentaire qui a lancé le festival. Jimmy Jean-Louis y raconte son voyage à Lagos où il doit diriger une importante cérémonie de remises de prix récompensant les meilleures productions de Nollywood, les AMAA. Avec beaucoup d’humour, il raconte cette expédition mais surtout, il donne la parole aux acteurs de cette industrie dynamique, jeune et balbutiante. Car si en terme de volumétrie, Nollywood est bien la seconde source de production cinématographique au monde, les intervenants interrogés sont assez lucides pour souligner le manque de professionnalisme et la faiblesse des moyens qui ont longtemps accompagné les productions nigérianes. Ce qui explique le fait que les films sortent très peu en dehors du périmètre africain. Ici, il y a avant tout le constat d’une adhésion d’un public local à ce cinéma. Engouement qui s’appuie sur le fait que ces films parlent avant tout de sujets dans lesquels le public se reconnait. D’ailleurs, il n’est pas surprenant que la salle de l’Arlequin soit pleine.
C'est le film documentaire qui a lancé le festival. Jimmy Jean-Louis y raconte son voyage à Lagos où il doit diriger une importante cérémonie de remises de prix récompensant les meilleures productions de Nollywood, les AMAA. Avec beaucoup d’humour, il raconte cette expédition mais surtout, il donne la parole aux acteurs de cette industrie dynamique, jeune et balbutiante. Car si en terme de volumétrie, Nollywood est bien la seconde source de production cinématographique au monde, les intervenants interrogés sont assez lucides pour souligner le manque de professionnalisme et la faiblesse des moyens qui ont longtemps accompagné les productions nigérianes. Ce qui explique le fait que les films sortent très peu en dehors du périmètre africain. Ici, il y a avant tout le constat d’une adhésion d’un public local à ce cinéma. Engouement qui s’appuie sur le fait que ces films parlent avant tout de sujets dans lesquels le public se reconnait. D’ailleurs, il n’est pas surprenant que la salle de l’Arlequin soit pleine.
Nollywood est le deuxième secteur économique du Nigeria. En travaillant sur un imaginaire spécifique dans lequel beaucoup se reconnaissent, cette industrie a tissé une vraie relation avec le public. D’ailleurs, quand Jimmy Jean-Louis sillonne les grands marchés de la capitale économique nigériane, les vcd sont partout. D’ailleurs s’agit-il des productions authentiques ou de piratages ? Les copies sont une plaie qui plombe l’économie de ce secteur d’activités. Ici, une interpellation est faite à l’endroit de l’état fédéral qui suit de loin l’émergence de ce modèle. La plue value de Nollywood étant reconnue à l’extérieur, très peu par les autorités du pays. La question importante qui revient est celle de savoir, comment passe-t-on de la quantité à la qualité, comment porte-t-on par une certaine esthétique un discours qui dépasse les frontières du Nigéria et du continent. On ressent dans le propos des intervenants qui répondent à Jimmy, à la fois la conscience d'avoir un contenu original et en même temps une soif de reconnaissance à l’international. Ce qui fait naturellement réfléchir. Parce qu’il est difficile de dire que Nollywood ne se résume qu’à un cinéma local nigérian. Son influence en Afrique subsaharienne est indiscutable. Que cache cette quête d'une reconnaissance occidentale? Est-ce que les indiens se posent une telle question?
En fait, le reportage de Jimmy Jean-Louis surprend par l’extrême lucidité des intervenants nigérians. Et c’est extrêmement positif. Car, avec cette prise de conscience, les choses peuvent évoluer de manière rapide.
Notes de Ndeye Diarra et Lareus Gangoueus