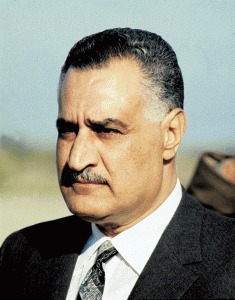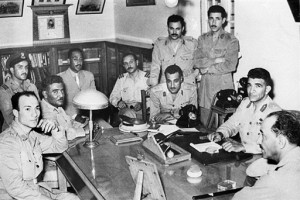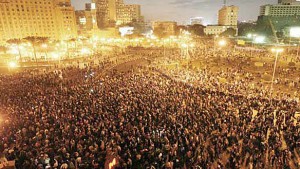Le Professeur Bonaventure MVE-ONDO est né en 1951 au Gabon. Philosophe, il est actuellement l'un des Vice-recteurs de l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF). Depuis 2009, cet ancien Recteur de l’université de Libreville, particulièrement engagé pour le développement de l’enseignement supérieur en Afrique, dirige l’Institut Panafricain de la Gouvernance Universitaire (IPAGU). Le Professeur Bonaventure MVE-ONDO a reçu les rédacteurs de Terangaweb, Nicolas Simel Ndiaye et Lamia Bazir, dans son bureau parisien pour cette interview.
Le Professeur Bonaventure MVE-ONDO est né en 1951 au Gabon. Philosophe, il est actuellement l'un des Vice-recteurs de l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF). Depuis 2009, cet ancien Recteur de l’université de Libreville, particulièrement engagé pour le développement de l’enseignement supérieur en Afrique, dirige l’Institut Panafricain de la Gouvernance Universitaire (IPAGU). Le Professeur Bonaventure MVE-ONDO a reçu les rédacteurs de Terangaweb, Nicolas Simel Ndiaye et Lamia Bazir, dans son bureau parisien pour cette interview.
Vous êtes Vice-recteur de l’Agence Universitaire de la Francophonie, pouvez-vous nous présenter le long parcours qui vous a mené jusqu’à ce poste ?
Cela a été un parcours long et difficile car il s'agit au fond du parcours de toute une vie d'études, de recherche, d'enseignement et de gestion d'institutions d'enseignement supérieur. Après avoir fait mes études en Afrique, notamment à Oyem et à Libreville au Gabon, j’ai ensuite poursuivi ma formation à l’université de Bordeaux 3 où j’ai passé tous mes diplômes universitaires, dont une thèse pour le doctorat de 3ème cycle en philosophie et une thèse pour le doctorat ès Lettres. Parallèlement, j’ai été assistant en philosophie à la faculté de Bordeaux avant d'enseigner pendant 15 ans à la faculté des lettres et sciences humaines de Libreville la logique mathématique, l’histoire de la philosophie et la métaphysique.
Tout en assumant cette mission, j’ai été appelé à diriger l’Institut de recherche en sciences humaines du Gabon. J’ai ensuite été nommé doyen de la faculté des Lettres de l’université de Libreville, puis vice-recteur de l’université, avant de diriger l’université en tant que recteur au début des années 1990. Cette période était du reste particulièrement difficile pour l’enseignement supérieur en Afrique pour trois raisons principales. D'abord, nous vivions les années de la démocratisation politique, marquées par le passage d’une logique de parti unique à celle de multipartisme avec une culture de la démocratie qui n’était pas encore vraiment implantée chez les différents acteurs de la vie universitaire. Ensuite, l’enseignement supérieur subissait le choc des plans d’ajustement structurel imposés alors par les bailleurs de fonds. Enfin, les universités traversaient une crise de croissance et d'identité. Elles commençaient à s'interroger sur leurs missions et leur rôle dans la société.
A la fin de mon mandat de recteur qui a duré quatre ans, j’ai été nommé conseiller de Président de la république du Gabon avant d’aller diriger à Dakar, à partir d’octobre 1994, le bureau régional d’Afrique de l’Ouest de l’Agence Universitaire de la Francophonie.
Quelles ont été vos principales lignes d’action en tant que Directeur du bureau régional d’Afrique de l’Ouest ?
Arrivé à Dakar, le constat était simple: plus on s’éloignait de Dakar, siège du Bureau régional pour toute l'Afrique, moins la présence de l'AUF était perceptible. Nous avons donc appuyé la création d’autres bureaux régionaux et c’est ainsi que, dès 1995, l'Agence a ouvert le bureau de Yaoundé. Le but était notamment de se rapprocher davantage de l'ensemble des universités membres d’autant que cette période constituait une phase majeure durant laquelle les Etats ont commencé à créer de plus en plus d’universités. En 1993 par exemple, au Cameroun l’Etat a créé cinq nouvelles universités pour faire face à l'explosion de la démographie étudiante. Tout cela sans compter le début de création des établissements d'enseignement supérieur privés.
Nous avons ensuite déployé les programmes de l’Agence dont notamment celui des campus numériques francophones qui sont des plateaux techniques localisés au sein des universités et équipés d’une centaine d’ordinateurs. Ces centres constituent des bibliothèques virtuelles avec l'accès à des bases de données scientifiques constamment réactualisées qui permettent de faire face aux difficultés d’accès aux informations scientifiques et techniques auxquels sont souvent confrontés étudiants et enseignants. Ces plateformes permettent également de mettre en place des e-formations à distance entre des universités partenaires du réseau alors même que les universités en Afrique n’offraient pour l’essentiel que des formations classiques et pas toujours innovantes. Les campus numériques constituent aussi des lieux dans lesquels les enseignants peuvent produire du savoir scientifique et des connaissances (revues virtuelles) accessibles à des étudiants du monde entier. On peut également y effectuer des soutenances de mémoire ou de thèse à distance. Ces campus numériques sont donc de véritables outils de décloisonnement de l’enseignement supérieur.
L'Agence a mis en place des pôles d’excellence en Afrique de l’ouest pour réduire l’isolement des étudiants et enseignants d’une part et d’autre part pour consolider les équipes de recherche, leur donner une dimension régionale en leur apportant des moyens complémentaires. Il existe ainsi à Dakar un pôle d’excellence sur l’esclavage où convergent toutes les études et qui est devenu une référence internationale dans ce domaine. A Bamako se trouve également un pole d’excellence sur le paludisme réunissant près de 130 chercheurs dont la moitié issus de pays d’Afrique et l’autre moitié des meilleures universités du monde comme Harvard. Les chercheurs de ce pôle d’excellence publient chaque année une trentaine d’articles de qualité dans les revues scientifiques de tout premier plan tels que Science et Nature. L'Agence a aussi déployé des projets de coopération scientifique interuniversitaire qui ont permis d'aider des générations de chercheurs, de valoriser leurs compétences dans une dynamique régionale et internationale.
Il est évident que ces partenariats du savoir ont changé le regard des bailleurs de fonds sur l’enseignement supérieur en Afrique, ce qui a permis à l’AUF de renforcer sa notoriété et sa légitimité à être un acteur majeur dans le développement de l'enseignement supérieur en Afrique.
Après 10 ans à Dakar, vous avez été promu à votre poste actuel de Vice-recteur de l’AUF. Quels sont les missions de l’AUF et les principaux axes sur lesquels l’Agence travaille aujourd’hui?
L’AUF est à la fois une association et un opérateur de la Francophonie. Dans sa nature associative, elle a été fondée à Montréal le 13 septembre 1961. Elle fête cette année ses 50 ans. A l'époque de sa création, le contexte de décolonisation organisait la coopération autour des relations nord sud. L'AUF, dans sa construction, n'est jamais apparue comme une association néocoloniale ou une association d'universités riches contre les universités pauvres. Elle a été créée et organisée, aussi bien dans sa gouvernance que dans sa logique d’actions, autour des principes de solidarité et d'excellence. Elle s'est engagée à créer des liens entre ses universités membres, à les structurer et à les aider en prenant en compte leurs complémentarités.
La plupart des universités africaines ont été créées dans les années 1970 avec des corps enseignants en nombre insuffisant. L’AUF a donc encouragé une logique de mutualisation dans laquelle les universités dont le corps enseignant était suffisamment étoffé partageaient des enseignants avec celles qui en étaient moins pourvues. Cette mutualisation n’était pas une relation d’assistance mais plutôt une relation de coopération tripartite dans laquelle aussi bien l’AUF, l’université demandeuse que celle qui fournissait le professeur participaient financièrement au projet. Cela donne un autre état de coopération qui ne s’inscrit pas dans une logique d’assistance ou de subordination et dont l’intérêt est d’amener tous les acteurs à s’engager dans un processus commun.
L’AUF travaille aussi à l’amélioration de la gouvernance dans les universités ?
Oui, et dans ce domaine, on comprendra que les enjeux sont là aussi très importants pour les universités africaines. Aujourd’hui gouverner une université est devenu un métier complexe auquel aucun enseignant n'est préparé. On s'aperçoit de plus en plus aujourd'hui que le métier ne prépare pas à celui de dirigeant d'un établissement d'enseignement supérieur. Il s’agit de métiers complètement différents et le fait d’être un bon professeur ne signifie pas qu’on sera un bon recteur. Le travail qu’on demande aujourd’hui à un Président d’université consiste à diriger une communauté, à engager son université dans le développement local, à discuter avec des organismes internationaux, des bailleurs de fond et enfin à conseiller les responsables politiques sur les politiques à adopter pour l’enseignement supérieur. A cela s’ajoute aussi la prise en compte des changements inhérents à tout établissement d'enseignement supérieur. On se rend donc bien compte que les attentes des autorités universitaires sont complètement différentes de celles qu’on pouvait avoir dans le passé. Depuis 2001, les acteurs de la gouvernance universitaire ont demandé à l’AUF et à ses autres instances, des actions de formations spécifiques adaptées pour des jeunes recteurs.
A ce propos, depuis juillet 2009, vous dirigez pour l’AUF l’Institut Panafricain de la Gouvernance Universitaire basée à Yaoundé? De quoi s’agit-il exactement ?
En 2003, l’AUF a monté un programme qui permet d’amener les acteurs de la gouvernance universitaire en Afrique à réfléchir sur les grandes questions liées à l’évolution de leur métier. Ces questions devenant de plus en plus techniques et stratégiques, nous avons ensuite jugé opportun de créer l’Institut Panafricain de la Gouvernance Universitaire (IPAGU), officiellement inauguré le 15 juin 2010. Il a été créé en 2009 en partenariat avec l'ACU. Cet institut est panafricain dans la mesure où il ne réunit pas seulement les universités francophones mais inclut aussi des universités anglophones. Il est localisé au Cameroun – pays qui a la particularité d’être bilingue – au sein de l’université de Yaoundé 2, dans les locaux de l’Atrium Senghor.
Dès sa création, l’Institut a commencé par lancer une large enquête auprès des 260 établissements d’enseignement supérieur d’Afrique afin de mieux comprendre les schémas et pratiques de gouvernance dans l’ensemble de leurs institutions universitaires. Les résultats sont à la fois pertinents et pratiques. Cette enquête a montré que globalement la gouvernance universitaire en Afrique a une histoire qu’il était facile d’appréhender en fonction du système des anciens pays colonisateurs. Aujourd’hui en revanche, la pratique de gouvernance s’est localisée géographiquement, c'est-à-dire que les universités d’Afrique de l’ouest ont quasiment les mêmes modes qui sont différents de ceux d’Afrique centrale, eux mêmes différents de ceux d’Afrique australe. Il est donc particulièrement important de comprendre et de définir la gouvernance de l’enseignement supérieur qui touche le cadre juridique, les formations, l’organisation, les acteurs, les missions de l’université, son rôle par rapport au développement de la société avant d'apporter des moyens et des appuis.
Et sur quoi repose essentiellement cette nouvelle gouvernance que vous cherchez à promouvoir ?
L'IPAGU n'a pas de posture idéologique. Il s’agit maintenant de donner à l’université un autre souffle en s’appuyant sur deux concepts : la responsabilité et l’imputabilité. Il faut que l’université et l’ensemble de ces acteurs soient plus responsables, que les enseignants et les étudiants changent de posture. Tout est possible même si en même temps les choses évoluent et que les établissements souhaitent bénéficier de plus d'autonomie, de plus de responsabilité et soient capables de rendre des comptes à la société. Il faut qu'elles acceptent d'évoluer de la formation pour la formation à des formations professionnelles et tournées sur le développement concret.
Il s’agit aussi d’inscrire la culture d’évaluation au cœur de l’université. Notre Institut va mettre en place deux produits particulièrement utiles : le guide de présidents, recteurs et doyens d’université ainsi que le manuel d’évaluation qui constitue une sorte de check up. Pour nous, le plus implorant est d’amener les universités à s’inscrire dans ce processus.
Par ailleurs l’Institut réalise, à la demande des Etats et des universités, des études d’évaluation de la gouvernance universitaire et d’accompagnement pour une amélioration des pratiques de gouvernance. C’est ainsi que nous en avons réalisé une étude d’évaluation de la gouvernance universitaire au Mali.
Dans le cadre de ce projet, un de vos principaux défis consiste à faire des universités africaines de vrais acteurs de développement. Comment vous y prenez vous concrètement ?
Au sortir des indépendances, les pays africains avaient besoin de former des agents administratifs et des cadres techniciens scientifiques. Aujourd’hui, on demande aux universités de se moderniser et de devenir des lieux d’innovation et de création qui constituent des leviers majeurs. Il faut donc créer des logiques qui permettent d’aller dans ce sens alors même que de telles réformes ne sont ni populaires ni affichables au maximum. C’est cela qui explique que les universités soient écartelées entre deux tendances : donner aux étudiants l’ensemble des outils pour s’adapter à l’innovation et donner à ceux qui le souhaitent des structures qui les aident à concrétiser leurs projets. Il faut convaincre les acteurs à faire confiance aux jeunes qui présentent des projets innovants et adaptés aux besoins locaux. C’est aussi pour cela que le nouveau talent demandé aux recteurs inclut aussi l’aptitude à convaincre les autres acteurs car l’université n’est pas seulement un client mais un partenaire.
Et en matière de perspectives, comment appréhendez-vous l’avenir de l’éducation supérieure en Afrique ?
Nous sommes aujourd’hui dans une phase dans laquelle les universités africaines ont parfaitement compris tous ces enjeux. On constate de plus en plus que les états d’esprit ont changé et pas seulement au niveau des responsables des universités mais aussi au niveau des étudiants qui s’engagent dans leur rôle social et il faut que cet engagement soit valorisé par les responsables universitaires. En guise de viatique pour l'avenir, je souhaite que l'on passe du paradigme de l’étudiant assisté à celui de l’étudiant engagé : c’est cela l’avenir de l’Afrique. Nos étudiants doivent être responsables, engagés et fiers d’être au service du développement de leurs pays. C'est cela que je souhaite ardemment pour notre système d'enseignement supérieur. L'université doit plus que jamais devenir un lieu où l'intelligence attire l'intelligence.
Interview réalisée par Nicolas Simel Ndiaye et Lamia Bazir
 Après avoir voté « oui » au référendum de 1958 portant sur la Constitution française de la Vème République, le Sénégal est par la suite devenu membre de la communauté franco-africaine. Cette forme juridique d’Etat n’obéit nullement aux modèles classiques de la Fédération ou de la confédération, c’est un modèle « sui-generis » qui semblerait vouloir cultiver « le lien de solidarité liant la France » à ses anciennes colonies. En 1959, l’Assemblée territoriale donne au gouvernement la possibilité de rédiger un projet de constitution, quand bien même la souveraineté internationale n’était pas acquise. C’est ainsi que l’Assemblée territoriale, érigée en Assemblée Constituante, adopte à la majorité de ses membres la Constitution du 24 Janvier 1959. Socle idéologique et juridique de l’Etat du Sénégal, il pose les principes fondamentaux autour desquels veut se réunir le peuple du Sénégal. C’est notamment la forme républicaine de l’Etat, l’entérinement de la laïcité ou encore la protection des droits et libertés fondamentaux.
Après avoir voté « oui » au référendum de 1958 portant sur la Constitution française de la Vème République, le Sénégal est par la suite devenu membre de la communauté franco-africaine. Cette forme juridique d’Etat n’obéit nullement aux modèles classiques de la Fédération ou de la confédération, c’est un modèle « sui-generis » qui semblerait vouloir cultiver « le lien de solidarité liant la France » à ses anciennes colonies. En 1959, l’Assemblée territoriale donne au gouvernement la possibilité de rédiger un projet de constitution, quand bien même la souveraineté internationale n’était pas acquise. C’est ainsi que l’Assemblée territoriale, érigée en Assemblée Constituante, adopte à la majorité de ses membres la Constitution du 24 Janvier 1959. Socle idéologique et juridique de l’Etat du Sénégal, il pose les principes fondamentaux autour desquels veut se réunir le peuple du Sénégal. C’est notamment la forme républicaine de l’Etat, l’entérinement de la laïcité ou encore la protection des droits et libertés fondamentaux. 





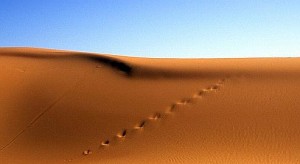



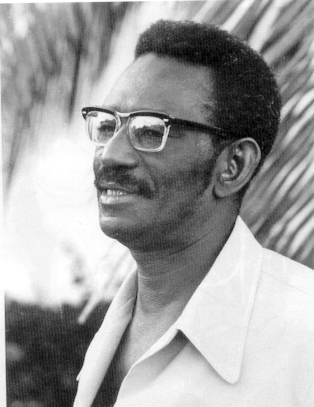 Un quart de siècle après sa mort, celui que d’aucuns ont surnommé le dernier pharaon continue à être méconnu par une bonne partie des jeunes Africains. Son œuvre immense n’est toujours pas enseignée dans les programmes scolaires du continent noir. Cheikh Anta Diop nous a par exemple démontré, par des preuves irréfutables, bien qu’il y ait encore quelques résistances, que les anciens Egyptiens auteurs de la première des civilisations qui par la suite engendra toutes les autres, étaient noirs et Africains. Qu’en avons-nous fait ?
Un quart de siècle après sa mort, celui que d’aucuns ont surnommé le dernier pharaon continue à être méconnu par une bonne partie des jeunes Africains. Son œuvre immense n’est toujours pas enseignée dans les programmes scolaires du continent noir. Cheikh Anta Diop nous a par exemple démontré, par des preuves irréfutables, bien qu’il y ait encore quelques résistances, que les anciens Egyptiens auteurs de la première des civilisations qui par la suite engendra toutes les autres, étaient noirs et Africains. Qu’en avons-nous fait ?