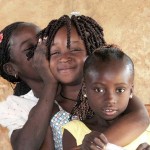Vous est-il arrivé, ces derniers mois, d’ouvrir un journal, d’allumer votre télévision, de suivre votre fil Twitter ou de commencer votre liste des meilleurs romans de la rentrée littéraire 2015… ? Si c’est le cas, il est fort à parier que les noms de Dany Lafférière, Léonora Miano, Marc-Alexandre Oho Bambe, Alain Mabanckou, Sony Labou Tansi, Fatou Diome, Charline Effah (la liste ne saurait être exhaustive) aient réveillé vos tympans, fait trébucher votre langue ou encouragé une potentialité encore somnolente.
Vous est-il arrivé, ces derniers mois, d’ouvrir un journal, d’allumer votre télévision, de suivre votre fil Twitter ou de commencer votre liste des meilleurs romans de la rentrée littéraire 2015… ? Si c’est le cas, il est fort à parier que les noms de Dany Lafférière, Léonora Miano, Marc-Alexandre Oho Bambe, Alain Mabanckou, Sony Labou Tansi, Fatou Diome, Charline Effah (la liste ne saurait être exhaustive) aient réveillé vos tympans, fait trébucher votre langue ou encouragé une potentialité encore somnolente.
L’actualité littéraire française le montre : les auteurs francophones africains et caribéens ont le vent en poupe. Le journal l’Humanité invite cinquante écrivains parmi les grands noms de la littérature francophone à « lire le pays » dans sa série de l’été[1], Marianne dédie une double page à la « Harlem Renaissance » et son pendant, la Négritude [2], RFI propulse six auteurs contemporains venus d’Afrique et des Caraïbes au festival d’Avignon [3], tandis que Fatou Diome subjugue le public du plateau de France télévision dans l’émission « Ce soir ou jamais »[4] avec son intervention remarquée sur l’état des politiques européennes d’immigration.
Quelle est la source du regain d’intérêt pour les littératures « postcoloniales» ?
Heureux hasard ? Effet de mode ? Prise de conscience générale? La question mérite d’être soulevée. Face à la montée des extrémismes religieux, du front national et au repli identitaire ambiant, nos leaders d’opinion seraient-ils en manque d’inspiration? Auraient-ils enfin, consenti à écouter les « bouches des malheurs qui n’ont point de bouche » ou « le cri des oiseaux fous », qui depuis plus de 10 ans, raflent, dans la plus grande discrétion, les prix littéraires les plus courus du monde francophone [5] ?
Soixante ans après les indépendances, cet engouement des journalistes pour les auteurs francophones africains et caribéens issus de l’ère postcoloniale, surtout publiés à Paris, et touchant avant tout un lectorat européen et africain immigré, est manifeste. La négritude d’Aimé Césaire, de Léon Gontran Damas et de Léopold Sédar Senghor a quitté la sphère intellectuelle pour aller vers des sphères plus populaires, des lieux de culture publique. En d’autres termes, Césaire est devenu un poète slogan, véhiculé par les mass media français.
Cet élan d’affection nouvelle pour la littérature postcoloniale peut s’expliquer par l’évolution du regard porté sur l’Afrique depuis 2011 [6], mais aussi par la présence et l’activisme des écrivains francophones sur le sol français, qui donnent à voir et à penser un Continent hors de ses réalités locales, en interaction permanente avec le monde. Une aubaine pour les médias à l’heure où « the rising continent » est sous les feux des projecteurs.
« De ces peuples, il était temps de savoir autre chose que le rire aux éclats, le rythme dans le sang.
Il était temps de connaître leur âme blessée, de fraterniser suffisamment avec eux pour embrasser leur complexité […] il fallait creuser pour saisir, sous la parole portée, le non-dit qui palpitait ».
Les aubes écarlates, « Latérite », Léonora Miano.
L’introduction de cette nouvelle manière d’être en relation, de repenser le lien indéfectible qui unit le continent africain avec le continent européen pour pouvoir construire demain est donc au cœur des réflexions. Ces nouveaux regards se retrouvent-ils dans le champ scolaire et universitaire ? Les littératures postcoloniales y sont-elles enseignées ? Connaissent-elles le même accueil ? Sont-elles perçues comme un outil capable d’apporter des grilles de lecture pertinentes aux générations futures ? Paradoxalement, il semblerait qu’un silence entoure encore ces littératures.
En effet, dans l’enseignement secondaire, la crainte de manipuler ces œuvres littéraires en milieu scolaire est souvent évoquée par les professeurs. Les questions liées au post-colonialisme sont traitées sous des angles d’approche différents, par manque de formation. Les termes « francophonie » et « postcolonial » sont délaissés tout comme leur essence même au profit de thématiques plus larges telles que l’altérité, le racisme ou encore l’ouverture sur le monde. L’absence de support permettant une application en classe est également flagrante : si 64% des manuels étudiés dans le secondaire et publiés avant 2011 font mention d'auteurs postcoloniaux, seulement 23% des manuels utilisent ces textes dans des problématiques liées à l'altérité, l'histoire coloniale et postcoloniale [7]. Le problème n'est donc plus la reconnaissance des auteurs francophones africains, mais la reconnaissance du champ littéraire dans lequel ils évoluent, ainsi que l’apport qu’ils pourraient représenter pour l’éducation.
Dans le champ universitaire, le constat n’est guère plus optimiste. La fermeture récente de la chaire « Littérature comparée des Suds » à l’Université de Cergy Pontoise [8], est un exemple inquiétant, et non isolé, de la réduction des formations centrées sur ce thème.
Un souffle nouveau porté par une nouvelle génération
Pourtant ces littératures sont au cœur d’enjeux historiques. En se saisissant de leur plume, les auteurs postcoloniaux invitent les citoyens à lever le voile sur les mémoires passées sous silence, les mémoires de l’exil, sous l’angle de regards croisés. Ils proposent un contre-discours au discours colonial pour créer un espace cicatriciel et construire demain. Aux prises avec l’actualité, de jeunes auteurs comme Mohamed Mbougar Sarr ou Fabienne Kanor prennent également en charge des problématiques résolument contemporaines comme le terrorisme islamiste ou l’immigration clandestine. En dépeignant des personnages en proie à la menace djihadiste dans Terre Ceinte, ou prêts à tout pour fouler l’eldorado européen dans Faire l’Aventure, ils font la jonction entre la réalité et l’imagination, changent les focaux traditionnels, et poussent les lecteurs à adopter une posture intellectuelle qui toujours interroge [9].
« -Si tout le Sénégal part du Sénégal, je serai le seul à rester, fit Diabang au bout d’un moment. C’était marmonné sans amertume mais l’œil vissé à cette mer qu’il ne prendrait jamais, ni pour quitter le pays, ni pour revenir. Des hommes de Mbour, il était bien le seul à ne pas rêver. Il fallait des jambes pour marcher le monde. C’était un minimum. La volonté, la chance, l’argent, n’intervenaient qu’après ».
Faire l’Aventure, Fabienne Kanor.
À partir de cette approche et de ce type de grille de lecture, les textes et les différents corpus, loin de s’opposer, se font écho. L’intertextualité des œuvres, leur travail de mémoire, et leur urgence de dire, entre autres, permet aux lecteurs et aux enseignants de faire des ponts entre les différentes cultures et de comprendre la construction de l’histoire contemporaine. Elles replacent le rôle du poète, de l’écrivain, de l’intellectuel dans nos sociétés et font se rejoindre littérature et politique.
On pourrait croire qu’il s’agit d’une évidence. Ce n’en est pas une, c’est un apprentissage de l’altérité (et de soi-même), qui, à notre heure, est vitale.
Marine Durand & Morgane Le Meur
Notes :
[1] « Il s’appelait Labou Tansi », hommage rendu à Sony Labou Tansi par Alain Mabanckou dans le journal l’Humanité du 30 juin 2015.
[2] Marianne du 22 au 28 mai 2015, rubrique « Penser », page 81 – « Immortelle Harlem Renaissance ».
[3] « Ça va, ça va le Monde ! » un cycle de lectures multimédias, organisé par RFI en partenariat avec le Festival d’Avignon et le soutien de la SACD dans le cadre de son action culturelle radio.
[4] Emission « Ce soir ou jamais » diffusée le 24 avril 2015 sur France Télévisions.
[5] Dany Lafférière : élu à l’Académie française, le 12 décembre 2013.
Léonora Miano : La Saison de l'ombre, Grasset, 2013 – Prix Fémina 2013 et Grand Prix du Roman Métis 2013.
Marc-Alexandre Oho Bambe : prix Paul Verlaine de l’Académie française.
Alain Mabanckou : prix Renaudot pour son roman Mémoires de porc-épic. Finaliste en 2015 du Man Booker International Prize et du Premio Strega Europeo.
[6] « The hopeful continent. Africa rising», Une du journal The Economist, publié le 3 décembre 2011.
[7] Magazine Afriscope n°37, « L'école 3.0, c'est pour bientôt ? », septembre-octobre 2014.
[8] La fermeture de la Chaire est intervenue suite au départ à la retraite de Madame Chaulet-Achour, professeure de Littérature Comparée et responsable du pôle Francophonies littéraires des Suds de l'Université de Cergy-Pontoise.
[9] Référence à l’ultime prière de Frantz Fanon, dans Peau noire, masques blancs, Editions Seuil, 1952 – « Ô mon corps, fais de moi toujours un homme qui interroge ! ».
Auteures :
Enseignante et amoureuse des littératures postcoloniales, c'est tout naturellement que Morgane Le Meur s'est interrogée quant à l’enseignement de ces dernières. Simple question en Master, cette problématique est rapidement devenue un sujet de thèse. Sous la direction d'Annie Rouxel et d'Anne Douaire-Banny, sa thèse s'articule en trois points: un état des lieux de cet enseignement, des propositions didactiques faites en classe et analysées et une réflexion sur la portée d'un tel enseignement sur le vivre ensemble notamment pour l'île de Mayotte.
Férue de poésie et de littérature francophone africaine, Marine Durand s’intéresse à la mouvance de la pensée postcoloniale et sa transmission. Diplômée d’un master en Science Politique, mention communication à l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ), elle a travaillé au Burkina Faso et au Sénégal, et est actuellement chargée de communication à l’Alliance française Paris Ile-de-France. En rejoignant l'Afrique de Idées elle souhaite s’enrichir d’autres visions que celles des centres décideurs et penser de nouvelles manières d’être en relation.
 En septembre 2015, les pays arabes devront s’engager à contribuer aux ambitieux objectifs de développement durable (ODD). Les atteindre représente d’autant plus un défi que les Printemps arabes ont mis à mal les progrès sociaux et économiques que ces pays avaient connu au début du XXIe siècle. Une approche originale en nexus devrait être développée, mettant l’accent sur les priorités de l’emploi des jeunes, de la décentralisation et de l’aménagement du territoire.
En septembre 2015, les pays arabes devront s’engager à contribuer aux ambitieux objectifs de développement durable (ODD). Les atteindre représente d’autant plus un défi que les Printemps arabes ont mis à mal les progrès sociaux et économiques que ces pays avaient connu au début du XXIe siècle. Une approche originale en nexus devrait être développée, mettant l’accent sur les priorités de l’emploi des jeunes, de la décentralisation et de l’aménagement du territoire.