Dr. Gilles Olakounlé Yabi est consultant indépendant sur les questions de conflits, de sécurité et de gouvernance en Afrique de l'Ouest. Il était auparavant directeur du projet Afrique de l'Ouest du think-tank International Crisis Group. Cet article a initialement été publié sur le site d'African Futures et sur son blog (http://gillesyabi.blogspot.com). Nous le republions ici avec son accord.
 Dans la première partie de cet article, l’auteur a décrit le contexte politique dans lequel se dérouleront les élections présidentielles dans les six pays d’Afrique de l’Ouest concernés par ces scrutins souvent à haut risque cette année et en 2015. Il a examiné en particulier l’intensité anticipée de la compétition électorale dans chacun des pays, un des trois éléments d’appréciation des risques de violence. Dans cette deuxième partie, il s’interroge sur le contexte sécuritaire actuel des différents pays et sur l’environnement institutionnel qui devra encadrer les processus électoraux.
Dans la première partie de cet article, l’auteur a décrit le contexte politique dans lequel se dérouleront les élections présidentielles dans les six pays d’Afrique de l’Ouest concernés par ces scrutins souvent à haut risque cette année et en 2015. Il a examiné en particulier l’intensité anticipée de la compétition électorale dans chacun des pays, un des trois éléments d’appréciation des risques de violence. Dans cette deuxième partie, il s’interroge sur le contexte sécuritaire actuel des différents pays et sur l’environnement institutionnel qui devra encadrer les processus électoraux.
Lorsqu’on s’intéresse au contexte sécuritaire général, un deuxième élément d’appréciation capital pour une analyse approximative des risques liés aux élections présidentielles à venir, il n’y a pas de quoi être rassuré. Parmi les déterminants principaux du contexte sécuritaire, on peut s’appesantir sur l’existence ou non dans le pays de groupes armés rebelles ou ex-rebelles, le degré de contrôle politique et d’intégrité professionnelle des forces de sécurité et des forces armées, le niveau d’alignement des affinités politiques avec l’appartenance ethnique et régionale, les conditions pacifiques ou non des élections présidentielles les plus récentes ainsi que l’ampleur et la forme de l’implication politique et/ou sécuritaire d’acteurs extérieurs importants.
Le Nigeria apparaît sans conteste comme l’environnement sécuritaire le plus fragile. L’élection de 2015 va se dérouler dans un pays déjà aux prises avec le groupe terroriste Boko Haram au Nord-Est, un pays qui abrite également des groupes armés organisés dans le Delta du Niger aussi prompts à soutenir politiquement qu’à exercer des pressions sur le président Jonathan lui-même issu de cette région du South-South, et un pays qui connaît des niveaux élevés de violence combinant des dimensions politiques, économiques, ethniques et religieuses dans le Middle Belt (centre du pays) et ailleurs sur le territoire. La fédération nigériane est aussi habituée à des lendemains d’élection meurtriers, comme ce fut le cas en 2011, alors même que le scrutin avait été jugé mieux organisé et plus crédible que tous les précédents.
Plus de 800 personnes avaient été tuées en trois jours d’émeutes et de furie dans douze Etats du nord de la fédération, l’élément déclencheur ayant été la défaite du candidat nordiste Muhammadu Buhari face à Jonathan. Le Nigeria n’avait pas besoin du terrorisme de Boko Haram pour atteindre de tels niveaux de violences mettant aux prises des concitoyens entre eux, avec certes une dose de spontanéité mais aussi un degré certain de préparation des esprits à la violence par des entrepreneurs politico-ethniques et des extrémistes religieux. Dans la perspective de 2015, le chantage à la violence a déjà commencé dans le pays, animé aussi bien par des groupes de militants du « si Jonathan n’est pas réélu, ce sera le chaos » que par ceux du « si Jonathan est réélu, ce sera le chaos ». Quand on ajoute à cette préparation mentale le très faible degré de confiance des populations nigérianes dans l’intégrité et le professionnalisme des forces de sécurité, la crainte d’un sombre début d’année 2015 dans la grande puissance de l’Afrique de l’Ouest paraît fort légitime.
La Guinée, du fait du prolongement ethno-régional de la polarisation politique et du passif de violences, est également très fragile du point de vue sécuritaire. Il convient de reconnaître les progrès indéniables qui ont été faits sous la présidence Condé dans la réforme du secteur de la sécurité qui se traduit par une amélioration de la capacité des forces de l’ordre à contenir des manifestations de rue sans tuer en une seule journée plusieurs dizaines de personnes. Ce n’est plus l’époque de Lansana Conté ou celle de Dadis Camara mais on n’est encore très loin d’un comportement exemplaire des forces de sécurité et d’une neutralité politique des responsables du maintien de l’ordre et de la haute administration territoriale. Les différentes manifestations qui avaient rythmé la longue et difficile marche vers les élections législatives de septembre dernier s’étaient tout de même traduites par des violences parfois meurtrières. On peut déjà anticiper un face-à-face explosif entre manifestants de l’opposition et forces de sécurité lorsque sera engagé le processus menant à l’élection présidentielle.
Le contexte sécuritaire n’est pas particulièrement rassurant non plus en Guinée Bissau et en Côte d’Ivoire. Dans le premier pays, les chefs de l’armée se sont toujours considérés autonomes par rapport au pouvoir politique civil et on parle de réforme du secteur de la sécurité depuis une dizaine d’années sans avoir jamais réussi à l’enclencher. En Côte d’Ivoire, des efforts significatifs ont été faits pour gérer les conséquences catastrophiques du conflit armé postélectoral de 2011, mais il faudra encore quelques années pour doter le pays de forces de défense et de sécurité cohérentes, efficaces et politiquement neutres. L’héritage difficile des années de rébellion et de conflit risque de peser lourdement dans l’environnement sécuritaire et les développements politiques… après l’élection de 2015. Aussi bien en Guinée Bissau qu’en Côte d’Ivoire, la présence d’acteurs extérieurs mandatés pour le maintien de la paix, la mission militaire de la CEDEAO (ECOMIB) et l’Opération des Nations unies en Côte d’Ivoire (ONUCI) respectivement, est un facteur d’apaisement relatif.
Le positionnement politique des forces de défense et de sécurité et le maintien de leur unité sont des éléments d’incertitude qui pèsent sur le contexte sécuritaire au Burkina Faso qui a connu de violentes mutineries en 2011. Impossible de savoir comment l’armée burkinabè et les différentes générations qui la composent vivent actuellement la situation inédite d’incertitude politique sur l’après 2015. Les hauts responsables militaires dont beaucoup ont été nommés au lendemain des mutineries de 2011 pour reprendre en main ce pilier essentiel du pouvoir de Compaoré considèrent-ils leur sort lié au maintien de ce dernier au palais présidentiel après 2015 ? Comment les officiers les plus proches du président qui l’ont accompagné depuis les premières années d’un régime alors très brutal appréhendent-ils l’avenir ? Beaucoup de questions et peu de réponses, ce qui ne devrait pas atténuer l’angoisse des Burkinabè et de nombre de leurs voisins ouest-africains. Au Togo, la question du positionnement politique des forces de sécurité et de l’armée se pose beaucoup moins : le verrouillage sécuritaire par le pouvoir de Lomé semble résister à l’usure du temps.
Il convient enfin de s’interroger sur le cadre institutionnel dans lequel se dérouleront les scrutins présidentiels dans les différents pays. Ce cadre désigne ici l’ensemble des règles, procédures, institutions qui sont mobilisées du début à la fin du processus électoral et qui jouent un rôle déterminant dans la crédibilité des scrutins, en particulier celle des résultats définitifs qui désignent le vainqueur. Si la crédibilité du processus électoral n’est pas une garantie d’absence de crise et de violences, la perception d’un déficit important de crédibilité est quasiment toujours un déclencheur de troubles. De plus, lorsque l’élection présidentielle se passe dans un pays dont l’environnement sécuritaire est déjà fragile et dans le contexte d’une intense compétition pour le pouvoir, la crédibilité du cadre institutionnel régentant l’élection peut être décisive pour sauver le pays d’un basculement quasiment certain dans une crise postélectorale.
Il ne faudra pas trop compter sur cela. Partout, les dispositions des lois électorales, les conditions d’établissement des fichiers d’électeurs, la neutralité politique et la compétence technique des institutions chargées d’organiser les élections et d’examiner les éventuels recours font l’objet de controverses. Aucun des pays concerné par une élection présidentielle en 2014 ou 2015 n’est un modèle dans la région en matière d’organisation de scrutins libres, transparents et crédibles. Certains ont accompli, à l’instar du Nigeria, des progrès notables en la matière au cours des dernières années, mais ils sont tous encore loin, bien loin, des modèles en Afrique de l’Ouest que sont le Ghana, le Cap-Vert et le Sénégal où des commissions électorales et/ou d’autres dispositifs et institutions ont su gérer et crédibiliser des élections parfois très compétitives.
Au Nigeria, nombre de réformes qui avaient été recommandées par les experts au lendemain des élections générales de 2011, certes mieux organisées que les précédentes, pour corriger les plus graves failles du système n’ont pas été mises en œuvre. En Guinée, il a fallu des médiations, une forte implication technique internationale et un accord politique âprement négocié pour arriver à organiser des élections législatives en septembre 2013. La liste des tâches à accomplir pour rendre le dispositif électoral plus crédible pour la présidentielle de 2015 est très longue. Elle comprend l’établissement d’un nouveau fichier électoral et la mise en place d’une institution cruciale comme la Cour constitutionnelle qui doit remplacer la Cour suprême dans le rôle de juge ultime du contentieux électoral. Même en Côte d’Ivoire, où l’actuel président avait promis une révision de la Constitution, rien n’a été fait pour fermer la page des dispositions spéciales issues des accords de paix et doter le pays d’un nouveau cadre électoral et d’un mode de composition de la commission électorale indépendante susceptible de créer davantage de confiance de la part de tous les acteurs politiques.
On ne peut, en guise de conclusion, que donner raison aux citoyens d’Afrique de l’Ouest déjà angoissés à l’approche des échéances électorales à venir. Lorsqu’on prend en compte simultanément les trois éléments d’appréciation, aucun des pays ne sera à l’abri de tensions fortes susceptibles de dégénérer en violences plus ou moins graves. En prenant le risque de se tromper, – qui peut vraiment prévoir tous les scénarios possibles dans chacun de ces pays plusieurs mois avant les différents scrutins ? -, il est raisonnable de classer le Nigeria et la Guinée dans une catégorie de pays à très haut risque, le Burkina Faso dans une catégorie de pays à haut risque et la Guinée Bissau, la Côte d’Ivoire et le Togo dans une catégorie de pays à risque modéré, ce qualificatif ne voulant surtout pas dire « faible » ou « inexistant ».
Les élections calamiteuses ne sont pas cependant des catastrophes naturelles imprévisibles et inévitables. Les citoyens de chacun des pays concernés, la CEDEAO et les acteurs internationaux importants ont les moyens de dompter l’angoisse par une forte mobilisation pour prévenir des crises violentes. Mais il y a aussi un risque à appréhender les élections uniquement ou principalement comme des moments de danger d’implosion des Etats, et à ne rechercher que des élections sans violence. Cela revient souvent, pour les organisations régionales et internationales, à préférer la manipulation des processus électoraux au profit du camp le plus puissant, et donc le plus à même de provoquer le chaos en cas de défaite, à des scrutins réellement ouverts à l’issue incertaine. Le risque est celui d’oublier et de faire oublier à quoi devraient servir les rituels électoraux dans des démocraties jeunes et fragiles : à ancrer petit à petit une culture démocratique dans la société. Si les populations doivent continuer à aller voter tous les quatre ou cinq ans, la peur au ventre, c’est l’adhésion populaire à l’idéal démocratique en Afrique de l’Ouest qui finira par être menacée.
Dr. Gilles Yabi
 La politique de décentralisation au Sénégal relève d’une tradition très ancienne. Initiée bien avant les indépendances, elle s’est traduite, dès l’accession à la souveraineté nationale et internationale du pays par plusieurs initiatives visant à l’approfondir.
La politique de décentralisation au Sénégal relève d’une tradition très ancienne. Initiée bien avant les indépendances, elle s’est traduite, dès l’accession à la souveraineté nationale et internationale du pays par plusieurs initiatives visant à l’approfondir.
 Qu’est-ce que la réforme de l’Etat ?
Qu’est-ce que la réforme de l’Etat ?
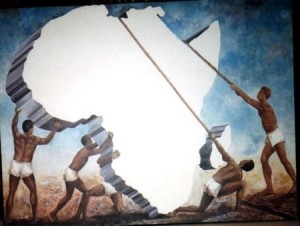

 Nelson Mandela est pleuré par les Sud-Africains, les Africains et la communauté internationale aujourd'hui comme le leader de notre génération qui se tenait la tête et les épaules au-dessus de ses contemporains – un colosse de moralité irréprochable et l'intégrité, figure publique la plus admirée et vénérée dans le monde.
Nelson Mandela est pleuré par les Sud-Africains, les Africains et la communauté internationale aujourd'hui comme le leader de notre génération qui se tenait la tête et les épaules au-dessus de ses contemporains – un colosse de moralité irréprochable et l'intégrité, figure publique la plus admirée et vénérée dans le monde.
 Racine Demba, membre de Terangaweb – L'Afrique des Idées, a récemment rencontré les responsables du Synapse Center, une organisation basée à Dakar qui accompagne les jeunes Sénégalais dans leurs projets d'entreprenariat. Résumé de leur entretien.
Racine Demba, membre de Terangaweb – L'Afrique des Idées, a récemment rencontré les responsables du Synapse Center, une organisation basée à Dakar qui accompagne les jeunes Sénégalais dans leurs projets d'entreprenariat. Résumé de leur entretien.

 Nous vivons aujourd’hui dans une société dont le principe de base est la liberté. C’est elle qui garantit le développement économique et social des nations.
Nous vivons aujourd’hui dans une société dont le principe de base est la liberté. C’est elle qui garantit le développement économique et social des nations. Aujourd'hui, soixante ans après, on peut dire que Jean Malonga était un visionnaire, car partir du sud, sa région natale, pour le nord qui est à l'opposé, est un symbole fort d'unité et du patriotisme qui doit animer tous les fils et les filles du Congo, quelle que soit leur groupe ethnique, quelle que soit leur région. Le Congolais doit se sentir partout chez lui, il ne doit pas se laisser berner par ceux qui veulent manipuler les masses en se servant de la tribu comme une arme implacable du diviser pour mieux régner. Les années quatre-vingt dix portent les traces sanglantes de l'instrumentalisation de l'ethnie.
Aujourd'hui, soixante ans après, on peut dire que Jean Malonga était un visionnaire, car partir du sud, sa région natale, pour le nord qui est à l'opposé, est un symbole fort d'unité et du patriotisme qui doit animer tous les fils et les filles du Congo, quelle que soit leur groupe ethnique, quelle que soit leur région. Le Congolais doit se sentir partout chez lui, il ne doit pas se laisser berner par ceux qui veulent manipuler les masses en se servant de la tribu comme une arme implacable du diviser pour mieux régner. Les années quatre-vingt dix portent les traces sanglantes de l'instrumentalisation de l'ethnie.
 Nous sommes revenus au Congo, sur le fleuve, avec des défenseurs de marque, l'honorable Sylvain Ngambolo, ancien député, promoteur du fleuve Congo, ainsi que le producteur Hassim Tall qui a fait un beau film sur le Congo. Les littéraires Boniface Mongo Mboussa et Liss Kihindou se sont attachés à montrer la présence du fleuve Congo dans la littérature. Le premier a souligné combien le Congo avait nourri l'imaginaire occidental, il a par exemple cité Le Coeur des ténèbres, de Conrad ou Voyage au Congo de Gide, mais c'est souvent une vision sombre qui est donnée du Congo, tandis qu'avec les nationaux, c'est une autre image qui est donnée. Le fleuve irrigue les écrits des Congolais, ai-je déclaré, et cela se voit parfois dans les titres : "Photo de groupe au bord du fleuve" de Dongala, "Le cri du fleuve" de Kathia Mounthault… Sans nous être concertés, Boniface Mongo Mboussa et moi avons donné une idée de la vision différente que l'on avait du fleuve dans la littératture, selon que l'on se place du point de vue de l'Occident ou des natifs du pays, mais le temps était compté et nous n'avons pu aller en profondeur, la discussion s'est poursuivie à l'extérieur, autour d'un pot, avec l'apport de tous cette fois, mais ce n'est pas sans avoir écouté au préalable des extraits de la nouvelle d'Emilie Flore Faignond "Je suis une Congolo-Congolaise, à paraître dans l'ouvrage collectif qui va marquer, de manière durable, ce soixantième anniversaire. Emilie-Flore Faignond magnifie le fleuve d'une manière si touchante, si poignante que l'on ne peut rester insensible, c'est tout simplement un hymne au Congo qu'elle chante, et le chant composé par l'artiste Jacques Loubelo, qui nous a quittés récemment, revient forcément à la mémoire : "Congo, ekolo monene, tolingana, toyokana, to salisana malamu, bongo to bongisa Congo…" (Congo, pays dont la valeur est si grande, Congolais, aimons-nous, qu'il y ait l'entente, la fraternité parmi nous, c'est ainsi que nous bâtirons notre pays, que nous le rendrons meilleur…)
Nous sommes revenus au Congo, sur le fleuve, avec des défenseurs de marque, l'honorable Sylvain Ngambolo, ancien député, promoteur du fleuve Congo, ainsi que le producteur Hassim Tall qui a fait un beau film sur le Congo. Les littéraires Boniface Mongo Mboussa et Liss Kihindou se sont attachés à montrer la présence du fleuve Congo dans la littérature. Le premier a souligné combien le Congo avait nourri l'imaginaire occidental, il a par exemple cité Le Coeur des ténèbres, de Conrad ou Voyage au Congo de Gide, mais c'est souvent une vision sombre qui est donnée du Congo, tandis qu'avec les nationaux, c'est une autre image qui est donnée. Le fleuve irrigue les écrits des Congolais, ai-je déclaré, et cela se voit parfois dans les titres : "Photo de groupe au bord du fleuve" de Dongala, "Le cri du fleuve" de Kathia Mounthault… Sans nous être concertés, Boniface Mongo Mboussa et moi avons donné une idée de la vision différente que l'on avait du fleuve dans la littératture, selon que l'on se place du point de vue de l'Occident ou des natifs du pays, mais le temps était compté et nous n'avons pu aller en profondeur, la discussion s'est poursuivie à l'extérieur, autour d'un pot, avec l'apport de tous cette fois, mais ce n'est pas sans avoir écouté au préalable des extraits de la nouvelle d'Emilie Flore Faignond "Je suis une Congolo-Congolaise, à paraître dans l'ouvrage collectif qui va marquer, de manière durable, ce soixantième anniversaire. Emilie-Flore Faignond magnifie le fleuve d'une manière si touchante, si poignante que l'on ne peut rester insensible, c'est tout simplement un hymne au Congo qu'elle chante, et le chant composé par l'artiste Jacques Loubelo, qui nous a quittés récemment, revient forcément à la mémoire : "Congo, ekolo monene, tolingana, toyokana, to salisana malamu, bongo to bongisa Congo…" (Congo, pays dont la valeur est si grande, Congolais, aimons-nous, qu'il y ait l'entente, la fraternité parmi nous, c'est ainsi que nous bâtirons notre pays, que nous le rendrons meilleur…)
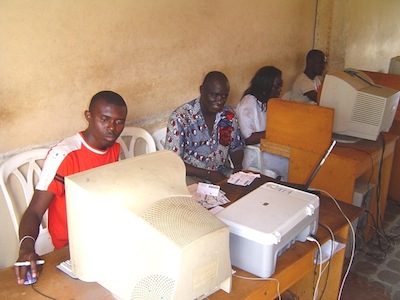


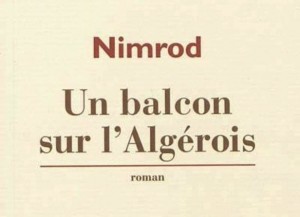
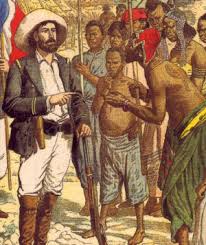 Bien avant les premières conquêtes et la période coloniale, l’éducation traditionnelle était l’institution en charge de l’enseignement. Il s’agit d’une forme d’éducation collective, où l’apprentissage se fait par voie orale et par l’observation. L’enfant apprend par l’expérience de ses pairs. C’est en s’imprégnant du milieu dans lequel il vit qu’il devient un être accompli. Cette vision initiale de l’enseignement a été modifiée par la colonisation. Les deux principales puissances colonisatrices, dont la France et la Grande Bretagne, se sont attelées à imposer leurs visions de l’éducation. Quel héritage ont-elles transmis à l’Afrique ?
Bien avant les premières conquêtes et la période coloniale, l’éducation traditionnelle était l’institution en charge de l’enseignement. Il s’agit d’une forme d’éducation collective, où l’apprentissage se fait par voie orale et par l’observation. L’enfant apprend par l’expérience de ses pairs. C’est en s’imprégnant du milieu dans lequel il vit qu’il devient un être accompli. Cette vision initiale de l’enseignement a été modifiée par la colonisation. Les deux principales puissances colonisatrices, dont la France et la Grande Bretagne, se sont attelées à imposer leurs visions de l’éducation. Quel héritage ont-elles transmis à l’Afrique ?
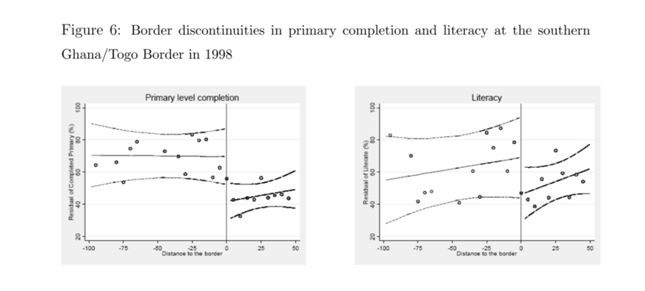
 Au fondement des ONG réside une mission, celle de participer aux efforts des populations et des citoyens à se prendre en charge dans la perspective d’une vie meilleure où les droits de chacune et chacun sont respectés. Les ONG ne sauraient se substituer aux populations, mais travaillent au renforcement de leurs capacités : elles les accompagnent, les appuient à concevoir et réaliser leur développement économique, politique, social et culturel. A cet effet, les ONG cherchent à influer sur les politiques publiques aux plans local, national et international pour la prise en charge effective des préoccupations des populations.
Au fondement des ONG réside une mission, celle de participer aux efforts des populations et des citoyens à se prendre en charge dans la perspective d’une vie meilleure où les droits de chacune et chacun sont respectés. Les ONG ne sauraient se substituer aux populations, mais travaillent au renforcement de leurs capacités : elles les accompagnent, les appuient à concevoir et réaliser leur développement économique, politique, social et culturel. A cet effet, les ONG cherchent à influer sur les politiques publiques aux plans local, national et international pour la prise en charge effective des préoccupations des populations. Soudaine et sans transition, si régulière pourtant dans ses horaires, la nuit sous l’équateur enveloppe la vie dès 18h. Les yeux presque bandés, il faut se retrouver dans le labyrinthe des ruelles sans réverbères. Sortie du goudron de l’avenue du général De Gaulle, je ne sais plus où je mets les pieds. La roulette congolaise, c’est savoir si ton prochain pas ne te mène dans une crevasse, si ta chaussure sera encore sèche en arrivant chez toi. A tout prendre, jouer c’est mieux que d’avoir la frousse, ça occupe les méninges. De toute façon, tu n’as pas le choix. La lumière ici, c’est un privilège.
Soudaine et sans transition, si régulière pourtant dans ses horaires, la nuit sous l’équateur enveloppe la vie dès 18h. Les yeux presque bandés, il faut se retrouver dans le labyrinthe des ruelles sans réverbères. Sortie du goudron de l’avenue du général De Gaulle, je ne sais plus où je mets les pieds. La roulette congolaise, c’est savoir si ton prochain pas ne te mène dans une crevasse, si ta chaussure sera encore sèche en arrivant chez toi. A tout prendre, jouer c’est mieux que d’avoir la frousse, ça occupe les méninges. De toute façon, tu n’as pas le choix. La lumière ici, c’est un privilège.
 La rue Mampili était connue pour être mal famée, envahie par les filles de joie, contaminée par le Sida et encrassée par les clients venus s’en mettre plein la vue au seul cinéma porno de la ville. L’emplacement de Satan est toujours là, mais aujourd’hui c’est un théâtre éphémère de la vie quotidienne. Un puits d’eau est resté, comme un trésor dans le dédale des ruines en béton armé. La journée, les femmes l’investissent pour y faire la lessive ou préparer le saka-saka
La rue Mampili était connue pour être mal famée, envahie par les filles de joie, contaminée par le Sida et encrassée par les clients venus s’en mettre plein la vue au seul cinéma porno de la ville. L’emplacement de Satan est toujours là, mais aujourd’hui c’est un théâtre éphémère de la vie quotidienne. Un puits d’eau est resté, comme un trésor dans le dédale des ruines en béton armé. La journée, les femmes l’investissent pour y faire la lessive ou préparer le saka-saka Mon expérience urbaine ne relève en rien de l'exploit et n'a été pour moi qu'une introduction à ce que peut être le quotidien de millions de personnes, en Afrique et ailleurs dans le monde. Par la suite, j'ai pu interroger deux entreprises actives dans le solaire au Congo. Il semble que le solaire constitue une solution adaptée aux habitations les plus éloignées, et que les appels d'offre publics, les donations privées à des villages traitent de mieux en mieux la problématique énergétique. Garantir, par l'énergie solaire, eau et électricité en permanence dans des hôpitaux reculés constitue par exemple une bonne manière d'attirer du personnel médical réticent, qui trouvera en brousse d'aussi bonnes, voire meilleures, conditions de vie qu'en ville.
Mon expérience urbaine ne relève en rien de l'exploit et n'a été pour moi qu'une introduction à ce que peut être le quotidien de millions de personnes, en Afrique et ailleurs dans le monde. Par la suite, j'ai pu interroger deux entreprises actives dans le solaire au Congo. Il semble que le solaire constitue une solution adaptée aux habitations les plus éloignées, et que les appels d'offre publics, les donations privées à des villages traitent de mieux en mieux la problématique énergétique. Garantir, par l'énergie solaire, eau et électricité en permanence dans des hôpitaux reculés constitue par exemple une bonne manière d'attirer du personnel médical réticent, qui trouvera en brousse d'aussi bonnes, voire meilleures, conditions de vie qu'en ville.