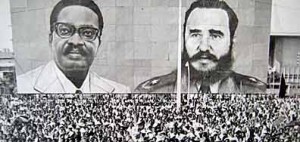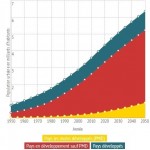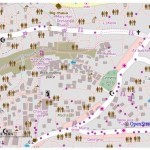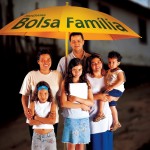L’état civil est l’ensemble des dispositions légales et réglementaires dont l’objet est de situer dans le temps et dans l’espace les événements essentiels de la vie d’un être humain dont les plus importants sont la naissance, le mariage et le décès. Il désigne également la structure administrative qui s’occupe de la délivrance des documents appelés actes d’état civil. « L’état des personnes n’est établi et ne peut être prouvé que par les actes de l’état civil, les jugements ou arrêts en tenant lieu et, exceptionnellement, les actes de notoriété »[1]. Si la situation s’améliore au niveau des mairies qui délivrent généralement les pièces d’état civil, tel n’est pas le cas dans l’appareil judiciaire qui actualise rarement les casiers judiciaires des citoyens condamnés suite à des jugements prononcés. Les gouvernants africains ont lancé un appel à Yamoussoukro en Côte d’Ivoire en février 2015 en vue de promouvoir l’utilisation de l’état civil et des statistiques de l’état civil pour appuyer la bonne gouvernance en Afrique[2].
L’état civil est l’ensemble des dispositions légales et réglementaires dont l’objet est de situer dans le temps et dans l’espace les événements essentiels de la vie d’un être humain dont les plus importants sont la naissance, le mariage et le décès. Il désigne également la structure administrative qui s’occupe de la délivrance des documents appelés actes d’état civil. « L’état des personnes n’est établi et ne peut être prouvé que par les actes de l’état civil, les jugements ou arrêts en tenant lieu et, exceptionnellement, les actes de notoriété »[1]. Si la situation s’améliore au niveau des mairies qui délivrent généralement les pièces d’état civil, tel n’est pas le cas dans l’appareil judiciaire qui actualise rarement les casiers judiciaires des citoyens condamnés suite à des jugements prononcés. Les gouvernants africains ont lancé un appel à Yamoussoukro en Côte d’Ivoire en février 2015 en vue de promouvoir l’utilisation de l’état civil et des statistiques de l’état civil pour appuyer la bonne gouvernance en Afrique[2].
Constats sociodémographiques et économiques
Les données d’état civil sont très utiles dans plusieurs domaines : démographique, administratif, juridique, économique et social. La population du continent africain est estimée à 1,111 milliards d’habitants en 2013 avec un taux de croissance annuel[3] de 2,5%, notamment en Afrique Subsaharienne.
« Les naissances, les mariages et les décès sont constatés sur des registres tenus dans les centres d’état civil selon les modalités fixées par décret »[4]. Donc les statistiques de fécondité et de mortalité devraient être constatées par l’état civil. Si elles ont connu un essor avec l’accession de la plupart des pays africains à l’indépendance ; ces données sur la fécondité et la mortalité en Afrique, ne proviennent plus que de plusieurs enquêtes et recensements organisés sur le plan mondial. L’état civil en Afrique n’est pas utilisé à des fins statistiques principalement à cause du fait que la législation dans certains pays ne prévoit pas ce volet statistique[5]. Cette législation n’envisage pas aussi le transfert de données entre la structure en charge de la collecte (état civil) et la structure en charge du traitement de ces données. Il y a encore à ce jour, des naissances qui ne sont pas enregistrées du simple fait que certaines femmes continuent d’accoucher à la maison. En outre, de nombreux décès ne sont pas déclarés auprès des services en charge de l’état civil.
La pratique des enregistrements fictifs surtout au moment de l'entrée à l’école est très répandue et peut arriver jusqu’à 80% des enregistrements dans certains zones[6]. Ce sont pour la plupart des enfants nés en dehors des centres de santé formels (structures informelles) ou ceux dont les parents n’ont pas fait aussitôt après leur naissance, la déclaration dans le registre de l’état civil. Cette situation favorise la pratique de fraude au sein des administrations africaines.
Le manque d’informations sur la couverture des enregistrements des faits d’état civil (naissances et décès), ne permet pas d’élaborer parfois de bonnes politiques économiques. Les activités pour le suivi d’élaboration de stratégies de réduction de la pauvreté biaisent les objectifs du millénaire pour le développement (OMD). Or ces statistiques devraient renforcer l’appui au système de collecte des indicateurs économiques (indice de coût de la construction, indice de prix à la consommation, le commerce extérieur, les comptes nationaux, etc.) afin de stimuler l’impact des politiques économiques et sociales. Suivant les dispositions du code des personnes et de la famille, dans le cas du Bénin par exemple « L’officier de l’état civil est tenu, à la fin de chaque trimestre, sous peine de sanction, d’adresser au service national des statistiques, un état des naissances, des mariages, des divorces, des décès et des enfants sans vie inscrits au cours du trimestre »[7].
Cette disposition du code n’est pas suivie et met à mal les activités d’analyses (évolution des structures de consommation des ménages, production des notes sur l’emploi, mise à jour des bases de données, publication et diffusion des résultats des différentes études et enquêtes statistiques, etc.) des services en charge du traitement des données statistiques.
D’une façon générale, des difficultés dans l’atteinte d’un important taux de fréquentation en matière d’état civil persistent encore en Afrique. Or, un faible taux d’enregistrement des événements de l’état civil ne permet pas à cette structure de jouer efficacement son rôle de banque de données fiables pouvant aider les gouvernants africains. A tout cela, s’ajoutent les fraudes que l’on constate dans les services d’établissement des actes d’état civil.
Constats sur les fraudes et les jugements supplétifs
L’état civil dans la vie des citoyens est empreint de toutes sortes de fraudes. Il y a lieu ici de signaler les cas particuliers de la falsification des actes de naissance opérés par certains usagers et ayant pour objet :
- d’accélérer la date du début de la scolarité,
- de faire reculer le moment de la retraite,
- d’établir de faux liens de filiation à des fins successorales,
- d’établir une fausse pièce d’identité (carte nationale d’identité, passeport, permis de conduire),
- de faciliter l’obtention de certains avantages matrimoniaux (mariage, divorce, rapprochement de conjoint, etc.).
La fraude peut porter sur l’acte d’état civil lui-même. Elle résulte alors de l’usage de faux actes confectionnés par des personnes ou des officines privées, d’altération de copies ou d’extraits d’actes régulièrement délivrés par les autorités locales, d’altération des registres de l’état civil par surcharge, rature, découpage et collage, de confection de vrais faux actes d’état civil constitués d’actes réguliers en la forme mais dont les événements relatés ne correspondent pas à la réalité (naissance fictive, reconnaissance mensongère, etc.).
La fraude à l’état civil a pris une ampleur toute particulière à travers essentiellement le phénomène de l’émigration. Une enquête menée par le ministère français des affaires étrangères auprès de postes diplomatiques et consulaires a permis de procéder à une estimation des actes d’état civil faux ou obtenus frauduleusement. Dans nombre de pays, la proportion de faux actes détectés par ces postes se situe entre 30 et 60 %. Elle est même évaluée à 90 % pour les Comores[8].
L’ignorance ou la méconnaissance des textes régissant le délai de déclaration d’une naissance ou d’un décès conduit certains bénéficiaires à solliciter la complicité des agents des services d’état civil pour se faire établir de faux actes en vue de régler une préoccupation de l’heure.
Beaucoup d’événements d’état civil passent inaperçus et échappent ou ne sont pas portés à la connaissance des services d’état civil. La non déclaration de ces faits, loin de conduire à des fraudes, peut s’expliquer par l’éloignement des centres d’état civil, le manque de moyens pour faire face aux frais médicaux très élevés, certaines femmes pour des normes coutumières craignent l’assistance d’un homme comme agent de santé d’accouchement, le comportement des agents chargés de prendre les déclarations, l’analphabétisme, le délai de prescription de 10 jours[9]. Toute personne se trouvant alors dans l’impossibilité de se faire établir un acte d’état civil, peut le suppléer par un jugement supplétif qui relève du Tribunal de Première Instance (TPI) du lieu de son ressort.
Les jugements supplétifs subissent aussi des manipulations au niveau des prénoms, de la date de naissance et du lieu de naissance lors de la délivrance de copies certifiées conformes aux originales. Ce qui permet à leurs titulaires de reproduire ces copies conformes qui présentent de nouvelles données. Des investigations faites au niveau de la Circonscription Urbaine de Cotonou au Bénin laissent découvrir de graves lacunes en ce qui concerne les transcriptions sur les registres d’état civil. Les jugements supplétifs homologués depuis 1997 ne sont pas encore transcrits à nos jours. Ceci est dû au non suivi et au manque de contrôle des autorités compétentes, toute chose qui favorise la fraude en matière d’état civil[10].
Il est donc évident que ces différentes manifestations de fraudes, faussent les statistiques des actes d’état civil, et par conséquent biaisent les différentes politiques élaborées par les autorités africaines.
Constats sociopolitiques et juridiques
Le droit à la personnalité juridique est une question qui revêt une importance capital. En effet, sans une identité légale, la jouissance des différents droits (liberté d’aller et venir, liberté de choisir, liberté d’entreprendre, droit à l’éducation, santé, eau et électricité, droit au travail, demande d’un titre foncier, héritier des biens, droit au mariage, etc.) est illusoire ou fortement compromise. Voilà que le système d’état civil dans la majorité des Etats africains est embryonnaire. Bon nombre de personnes sont des « sans papiers ». Cette situation n’est pas sans conséquences sur la vie des citoyens.
Formellement, des subterfuges ont parfois été trouvés pour contourner ces difficultés comme par exemple l’inscription des citoyens (ou supposés tels) sur les listes électorales sans pièces d’identité et sur la base de simples témoignages, souvent des chefs de villages ou de quartiers des villes. Ces solutions n’enlèvent rien à la responsabilité de l’État car « l’acte d’état civil constitue un droit inaliénable de la personne humaine. Il est de la responsabilité de l’État, au regard de ses engagements vis-à-vis des instruments internationaux de protection des droits de l’Homme, de prendre toutes mesures nécessaires pour en assurer la pleine garantie afin que chaque Béninois soit détenteur d’une identité légale »[11].
Pour remédier à cette lacune, le Bénin a initié en 2006 le projet « Recensement Administratif à Vocation Etat Civil[12] » ou « RAVEC ». C’est une administration spéciale mise en place par le Gouvernement béninois et dont l’objectif est d’organiser, en collaboration avec les tribunaux et les communes, des audiences foraines afin de délivrer des actes de naissance aux personnes qui n’en possèdent pas. Ce projet permettra au Bénin de disposer d’un système d’état civil moderne, sécurisé et crédible répondant aux exigences de la bonne gouvernance. Le RAVEC vise donc à constituer une base de données, attribuer un identifiant à chaque béninois, rendre accessibles les actes, même en cas de perte, permettre la sécurisation et la fiabilité du système d’état civil, dorénavant numérisé et biométrique. Toutes choses qui permettront d’avoir des listes électorales, cartes d’électeurs, permis de conduire, passeports fiables, etc. Le recensement sur les registres de requérants a connu un succès considérable puisque les demandeurs d’actes de naissance (en principe seulement ceux qui ont plus de quinze ans) dans les 77 communes béninoises se chiffrent à 2 336 159 personnes[13]. La phase des audiences foraines a en effet connu quelques difficultés de parcours (vacances judiciaires, grèves des magistrats, puis des greffiers, etc.), mais début 2010, plus de 70% des requérants avaient obtenu satisfaction. Mais le volet « base de données que comporte le RAVEC, a été invalidé par la Cour constitutionnelle, car cela est du ressort du pouvoir législatif[14].
Malgré ces constats, les officiers d’état civil sous estiment le nombre croissant de fraudes répertoriées et ignorent les conséquences que cela peut avoir sur le fonctionnement normal des centres d’état civil en particulier et sur la société en général. En effet, la montée de la fraude à l’état civil peut remettre en cause la totalité des actes d’état civil délivrés par les autorités compétentes et freiner par conséquent certains droits que doivent bénéficier les citoyens.
Pourtant, des dispositions légales et réglementaires ont été prises pour permettre à l’officier d’état civil de vérifier l’événement déclaré et la valeur probante de l’acte de l’état civil. Dans certains cas, il est même parfois habilité à refuser l’établissement d’un acte. En outre, des sanctions pénales ou administratives ont été dictées pour réprimer les agissements frauduleux. Malgré ce dispositif législatif le mal demeure. Monsieur Ousmane Massek Ndiaye[15] a reconnu que la loi seule ne peut venir à bout de ce phénomène. Il a invité à une union sacrée de tous les responsables politiques, religieux, coutumiers pour influer positivement sur les mentalités.
L'état civil à un rôle primordial à jouer dans le processus de développement de l'Afrique. De fait, il constitue un soutien fort à l'élaboration et au suivi des politiques socio-économiques. Cependant, son rôle en tant qu'appui à la planification du développement est compromis par la moindre importance qui lui ait accordé et qui se traduit par d'importantes fraudes, qui mettent davantage à mal le rôle qu'il pourrait jouer. Il est donc nécessaire, aujourd'hui d'envisager des solutions et ce d'autant plus que le numérique offre des possibilités, afin de rétablir l'état civil et d'en faire un outil pour le développement de l'Afrique.
Nicolas Olihidé
[1] Article 33 de la Loi N°2002-07 du 24 Août 2004 portant Code des personnes et de la famille en République du Bénin.
[2] NATIONS-UNIES / CEA, 2015, Troisième conférence des ministres africains en charge de l’état civil, Yamoussoukro (CÔTE D’IVOIRE), 09 au 13 février 2015.
[3] http://www.notre-planete.info/actualites/3839-croissance-demographique-population-mondiale consulté le 23 Mai 2015.
[4] Article 34 du Code des personnes et de la famille du Bénin.
[5] NATIONS UNIES / Département des affaires économiques et sociales / Division des statistiques, 2003, Rapport de la réunion d’experts sur l’amélioration des statistiques de fécondité et de mortalité en Afrique francophone, Yaoundé, Cameroun, du 22 au 26 septembre 2003.
[6] http://www.voyagesphotosmanu.com/population_benin.html consulté le 23/03/2012.
[7] Article 41 alinéa 6 du Code des personnes et de la famille du Bénin.
[8] Extrait du document intitulé « Outils de formation en matière d’état civil » réalisé par SOUDJAY SONATAY Oumie en 2006 financé par l’UNICEF sur le site web : http://www.comores-web.com/article/la-fraude-a-letat-civil.html consulté le 24/03/2012.
[9] Article 60 alinéa 1 du Code des personnes et de la famille du Bénin.
[10] ANAGONOU AKANMOUN Philomène, 1999, Problématique de l’état civil au Bénin : cas des jugements supplétifs, UNB/ENA.
[11] Union africaine et gouvernement du Bénin, MAEP : Rapport d’évaluation du Bénin, pp.355 et 366.
[12] Décret n° 2006-318 du 10 juillet 2006 portant établissement et délivrance des actes de naissance aux personnes qui n’en possèdent pas.
[13] BADET Giles, 2010, Bénin, Démocratie et Participation à la vie politique :une évaluation de 20 ans de Renouveau démocratique, Une étude d’AfriMap et d’Open Society Initiative for West Africa
[14] Décision DCC 06-17 du 17 novembre 2006.