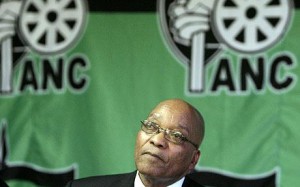Dr. Gilles Olakounlé Yabi est consultant indépendant sur les questions de conflits, de sécurité et de gouvernance en Afrique de l'Ouest. Il était auparavant directeur du projet Afrique de l'Ouest du think-tank International Crisis Group. Cet article a initialement été publié sur le site d'African Futures et sur son blog (http://gillesyabi.blogspot.com). Nous le republions ici avec son accord.

C’est l’estomac noué et la gorge serrée que les citoyens de six pays membres de la Communauté économique des Etats d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) s’apprêtent à entrer dans une période électorale devenue synonyme, dans une trop grande partie du continent, de risque maximal de crise violente. Les premiers qui devraient être convoqués aux urnes sont les électeurs de Guinée Bissau où un scrutin présidentiel et des législatives censés tourner la page d’une période de transition sont prévus le 13 avril prochain. Dans ce pays lusophone, le seul de la région avec les îles du Cap-Vert, le calendrier électoral a été systématiquement perturbé depuis la démocratisation formelle au début des années 1990 par des coups de force militaires, des assassinats politiques et dernièrement par la mort naturelle du président. Mais c’est en 2015 que l’actualité électorale sera extraordinairement chargée.[1] Des élections présidentielles sont prévues au premier trimestre au Nigeria et au Togo, puis au dernier trimestre au Burkina Faso, en Guinée et en Côte d’Ivoire.[2]
Pour chacun de ces pays et pour l’ensemble de l’Afrique de l’Ouest, les élections présidentielles à venir représentent un enjeu crucial pour la paix, la stabilité politique mais aussi pour le progrès économique et social. Si la région n’avait pas connu une série de crises violentes au cours des dix dernières années, les échéances de 2014-2015 auraient dû surtout servir de test pour la consolidation de la pratique et de la culture démocratiques dans chacun des pays concernés et, par là même, pour l’ensemble de cette région du continent. Cette question ne sera que secondaire autant pour les citoyens que pour les organisations régionales et internationales à l’approche des différents scrutins présidentiels. La préoccupation première sera celle d’éviter que ces moments censés incarner la vitalité démocratique ne se transforment en périodes d’explosion de violences, ou pire, de basculement dans des conflits armés. Au regard des évènements politiques et sécuritaires des dernières années, ces craintes sont légitimes.
Mais quelle est l’ampleur des risques associés à chacune des élections présidentielles à venir dans la région ? Où sont-ils les plus importants ? Pour tenter de répondre à ces questions, trois éléments d’appréciation méritent d’être mobilisés: ce qu’on pourrait appeler l’intensité anticipée de la compétition présidentielle, le contexte sécuritaire général du pays et le cadre institutionnel appelé à régenter le processus électoral. Anticiper l’intensité de la compétition pour la fonction présidentielle revient à s’interroger, dans chaque pays, sur les chances que le scrutin soit ouvert et qu’il n’y ait pas de candidat quasiment sûr de gagner bien avant l’échéance. Classer les pays en fonction de ce premier critère n’est pas si simple, alors qu’on ne connaît pas encore avec certitude qui seront les candidats en course pour chacune des élections présidentielles.
En Guinée Bissau, le scrutin doit mettre fin à une situation d’exception née d’un coup d’Etat…contre un Premier ministre qui était en passe de devenir président, Carlos Gomes Júnior. Organisée en avril 2012, la dernière élection présidentielle s’était arrêtée entre les deux tours. Gomes Júnior, largement en avance à l’issue du premier tour, avait été brutalement sorti du jeu par les chefs militaires du pays qui lui étaient résolument hostiles. L’ancien Premier ministre reste en 2014 un acteur politique influent mais contraint à l’exil d’abord au Portugal et désormais au Cap-Vert, toujours considéré inacceptable pour la hiérarchie militaire et peut-être pour des acteurs régionaux importants, on ne voit pas comment il pourrait rentrer dans son pays en sécurité et se présenter à nouveau à une élection présidentielle. Il a sollicité l’investiture de son parti, le PAIGC (Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde, Parti africain pour l’indépendance de la Guinée et du Cap-Vert), mais le choix de ce dernier s’est porté le 2 mars sur l’ancien ministre des Finances et ancien maire de la capitale, José Mário Vaz.
Le PAIGC, qui continue à bénéficier de son statut historique de parti ayant conduit la lutte armée pour l’indépendance des deux anciennes colonies portugaises d’Afrique de l’Ouest, reste la force politique dominante dans le pays malgré ses divisions internes. Il partira favori pour les élections législatives, face au PRS (Partido para a Renovação Social, Parti pour la rénovation sociale), également divisé, et aux autres partis plus petits. La compétition pour le fauteuil présidentiel devrait être plus ouverte en raison notamment de quelques candidatures indépendantes susceptibles de séduire un électorat désorienté par les luttes politiques partisanes. Mais le plus dur en Guinée Bissau n’est pas toujours de doter le pays d’un président démocratiquement élu. C’est de lui garantir de bonnes chances de survie politique et physique jusqu’à la fin de son mandat, surtout s’il lui venait à l’esprit de toucher aux intérêts des chefs militaires et/ou des alliés locaux des réseaux internationaux de trafic de drogue actifs dans ce pays et dans toute l’Afrique de l’Ouest.
Au Nigeria non plus, on ne sait pas encore avec certitude qui sera candidat, mais l’attention se concentre sur les intentions du président sortant Goodluck Jonathan. Evoquant un principe non écrit de rotation entre candidats nordistes et sudistes désignés par le PDP (People’s Democratic Party, Parti démocratique du peuple), parti au pouvoir depuis le retour à la démocratie en 1999, nombreux sont ceux qui s’opposent à une nouvelle candidature du président actuel. Vice-président en 2007, Jonathan avait hérité du poste de président après le décès de Umaru Yar’Adua en 2010 avant de se faire élire en 2011 pour un premier mandat plein de quatre ans. Les défections de personnalités très influentes du PDP se sont multipliées ces derniers mois et elles continuent, affaiblissant le camp du président.
L’opposition au PDP semble par ailleurs n’avoir jamais été aussi forte, en raison de la fusion en février 2013 de quatre partis importants dans une grande formation, l’APC (All Progressives Congress, Congrès de tous les progressistes) qui est aussi bien implanté que le parti au pouvoir dans tous les Etats de la fédération. Les moyens financiers, déterminants dans la bataille électorale colossale qui se profile, ne manqueront pas d’un côté comme de l’autre, même si le camp au pouvoir dans cette puissance pétrolière qu’est le Nigeria disposera inévitablement d’un avantage certain en la matière. La compétition sera selon toute probabilité très intense. Elle le sera dans tous les cas, y compris dans l’hypothèse très improbable d’un retrait du président sortant de la course à l’investiture du PDP, et quel que soit le candidat qui sera choisi par l’APC. Ce choix ne sera pas aisé et pourrait provoquer des failles dans l’unité affichée jusque-là par le nouveau grand parti d’opposition.
Les Togolais devraient, comme les Nigérians, aller aux urnes au premier trimestre 2015. Le président sortant Faure Gnassingbé, élu dans des circonstances controversées et violentes en 2005 après la mort naturelle de son père, Eyadema Gnassingbé, puis réélu en 2010, pourra se porter candidat une troisième fois sans avoir à faire modifier la Constitution en vigueur. Depuis le retour forcé à un système démocratique formel, le pouvoir togolais n’a pas arrêté de jouer avec la disposition de limitation à deux du nombre de mandats présidentiels successifs. En 2002, une révision constitutionnelle avait non seulement supprimé cette disposition mais elle avait également consacré le principe d’une élection présidentielle à un seul tour. Malgré les recommandations d’un accord politique global signé en 2006 et les demandes répétées de l’opposition, les dispositions actuelles de la Constitution et du code électoral restent très favorables à une tranquille pérennité du régime du président Gnassingbé. Le parti présidentiel UNIR (Union pour la République) dispose d’une majorité absolue au Parlement et s’assurera que rien ne soit entrepris pour réduire les chances de victoire de son chef en 2015. Par ailleurs, la machine sécuritaire au service du pouvoir et l’insuffisante coordination des forces politiques de l’opposition ne militent pas pour l’instant en faveur d’une compétition électorale ouverte et intense pouvant déboucher sur une alternance politique réelle dans un pays qui n’en a pas connue depuis le coup d’Etat d’Eyadema Gnassingbé en… 1967.
Au Burkina Faso, il n’y a même pas eu d’alternance générationnelle comme ce fut le cas au Togo en 2005. Au pouvoir depuis octobre 1987, Blaise Compaoré devrait avoir passé 28 ans à la tête de l’Etat au moment de l’élection présidentielle de 2015. La Constitution limitant le nombre de mandats successifs à deux, le président ne pourra être candidat qu’à condition de réussir à faire passer une nouvelle révision de la loi fondamentale dans les mois à venir. Cette intention ne faisant plus de doute, la mobilisation des adversaires à une énième manœuvre visant à prolonger le règne du président Compaoré a commencé à Ouagadougou. Elle a même affaibli le pouvoir beaucoup plus rapidement qu’on ne pouvait le prévoir, un large groupe de personnalités de poids du parti présidentiel, le CDP (Congrès pour la Démocratie et le Progrès) qui ont toujours soutenu Compaoré, ayant décidé de quitter le navire pour rejoindre en janvier dernier le camp des adversaires de toute révision constitutionnelle.
Le Burkina Faso est de fait déjà entré dans une période tendue et cela devrait durer jusqu’à ce que le pouvoir décide de renoncer à toute modification constitutionnelle ou choisisse de convoquer un référendum sur cette question. Dans ce dernier cas, de fortes contestations sociopolitiques seront inévitables et leurs conséquences incertaines. La compétition électorale en 2015 sera forcément intense. Dans l’hypothèse où Compaoré renoncerait à prétendre à un nouveau mandat, la compétition devrait être très ouverte. Elle pourrait juste être moins tendue et explosive qu’en cas de candidature du président sortant.
En Guinée, le président Alpha Condé devrait être candidat en 2015 pour un second et dernier mandat. Pas d’obstacle légal à contourner. Il devrait par contre faire face à des rivaux politiques organisés, déterminés et capables de le priver d’un nouveau mandat. Arrivé au pouvoir en décembre 2010, au terme d’un scrutin laborieux et controversé, le président avait été largement distancé au premier tour par l’ancien Premier ministre Cellou Dalein Diallo avant de l’emporter au second. Les récentes élections législatives, elles-aussi organisées au forceps après une série de reports et grâce à une forte implication internationale, ont encore montré que le camp du président Condé n’était pas capable d’écraser l’opposition. Cette dernière, même éclatée en plusieurs pôles, a quasiment fait jeu égal avec le parti du président, le RPG (Rassemblement du peuple de Guinée) et ses alliés.
L’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) de Cellou Dalein Diallo reste une force politique significative qui, si elle s’allie à d’autres partis importants comme l’Union des forces républicaines (UFR) de Sydia Touré ou le PEDN (Parti de l’espoir pour le développement national) de Lansana Kouyaté, pourrait devenir majoritaire à l’occasion du second tour d’un scrutin présidentiel. Dans l’hypothèse, pour le moment improbable, d’une candidature unique de l’opposition, le président Condé serait particulièrement menacé par une défaite électorale, malgré les avantages habituels conséquents d’un président-candidat. Aucun doute n’est permis sur l’intensité de la bataille pour la présidence de la Guinée à la fin de l’année 2015. Elle sera l’une des plus rudes de la région.
Au cours de ce même dernier trimestre 2015, les Ivoiriens seront eux-aussi convoqués aux urnes pour reconduire le président Alassane Ouattara ou choisir un nouveau chef d’Etat. Arrivé au pouvoir au terme d’une élection compétitive qui a dégénéré en conflit armé avec celui qui était le président sortant, Laurent Gbagbo, Ouattara a rapidement indiqué qu’il serait bien candidat à un second et ultime mandat. Si son parti, le Rassemblement des républicains (RDR) sera à coup sûr uni derrière le président pour la future bataille électorale, le soutien franc et massif du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI), allié important et potentiellement décisif, n’est pas nécessairement acquis. Le scrutin ne sera pas gagné d’avance mais la faiblesse et le passif du Front populaire ivoirien (FPI) de l’ex-président Gbagbo, détenu à la prison de la Cour pénale internationale aux Pays-Bas, sont tels que le président sortant devrait partir favori. Son bilan en termes de relance de l’économie ivoirienne et des mesures récentes allant enfin dans le sens de l’apaisement et de la réconciliation nationale devraient aussi jouer en sa faveur. On peut anticiper une compétition présidentielle modérément intense dans un pays dont les électeurs ont encore à l’esprit le traumatisme postélectoral de 2010-2011.
Gilles Olakounlé Yabi
[1] L’autre élection présidentielle de l’année 2014, prévue en juin, aura lieu en Mauritanie, pays à cheval sur l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique du Nord qui s’est retiré de la CEDEAO en 2000.
[2] Dans la foulée, au début de l’année 2016, les électeurs du Niger et du Bénin seront à leur tour appelés aux urnes pour choisir leurs chefs d’Etat. Dans les deux pays, l’atmosphère politique est déjà marquée par de fortes tensions à plus de deux ans des échéances électorales. Le Cap-Vert, la Gambie puis le Ghana seront aussi concernés par les élections au second semestre 2016.
 La question des limitations de mandats présidentiels, plus d’un demi-siècle après les indépendances, reste plus que jamais au cœur des débats africains. Des tripatouillages et des tentatives de tripatouillages constitutionnels, orchestrés par des présidents « véreux » et avides de pouvoir sont régulièrement constatés sur le continent. Blaise Compaoré, après avoir passé plus d’un quart de siècle (27 ans) à la tête du Pays des Hommes Intègres, veut récidiver et tient mordicus à un passage en force pour être éligible aux futures élections présidentielles de 2015.
La question des limitations de mandats présidentiels, plus d’un demi-siècle après les indépendances, reste plus que jamais au cœur des débats africains. Des tripatouillages et des tentatives de tripatouillages constitutionnels, orchestrés par des présidents « véreux » et avides de pouvoir sont régulièrement constatés sur le continent. Blaise Compaoré, après avoir passé plus d’un quart de siècle (27 ans) à la tête du Pays des Hommes Intègres, veut récidiver et tient mordicus à un passage en force pour être éligible aux futures élections présidentielles de 2015.
 Effroi, indignation et incompréhension. Tels sont les sentiments qui règnent lorsque le nom du groupe islamiste nigérian Boko Haram est mentionné dans les médias. Considéré comme une secte ou un mouvement terroriste à doctrine essentiellement anti-occidentale, Boko Haram semble aujourd’hui invincible. Ses sévices font trembler le géant économique africain, des régions du nord jusqu’au cœur de la capitale, Abuja. De 2002 à 2014, le nombre de victimes n’a cessé de croître et la fragilité inquiétante de l’armée et du gouvernement nigérians n’en rendent pas la situation moins complexe.
Effroi, indignation et incompréhension. Tels sont les sentiments qui règnent lorsque le nom du groupe islamiste nigérian Boko Haram est mentionné dans les médias. Considéré comme une secte ou un mouvement terroriste à doctrine essentiellement anti-occidentale, Boko Haram semble aujourd’hui invincible. Ses sévices font trembler le géant économique africain, des régions du nord jusqu’au cœur de la capitale, Abuja. De 2002 à 2014, le nombre de victimes n’a cessé de croître et la fragilité inquiétante de l’armée et du gouvernement nigérians n’en rendent pas la situation moins complexe.
 Dans
Dans C’est l’estomac noué et la gorge serrée que les citoyens de six pays membres de la Communauté économique des Etats d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) s’apprêtent à entrer dans une période électorale devenue synonyme, dans une trop grande partie du continent, de risque maximal de crise violente. Les premiers qui devraient être convoqués aux urnes sont les électeurs de Guinée Bissau où un scrutin présidentiel et des législatives censés tourner la page d’une période de transition sont prévus le 13 avril prochain. Dans ce pays lusophone, le seul de la région avec les îles du Cap-Vert, le calendrier électoral a été systématiquement perturbé depuis la démocratisation formelle au début des années 1990 par des coups de force militaires, des assassinats politiques et dernièrement par la mort naturelle du président. Mais c’est en 2015 que l’actualité électorale sera extraordinairement chargée.[1] Des élections présidentielles sont prévues au premier trimestre au Nigeria et au Togo, puis au dernier trimestre au Burkina Faso, en Guinée et en Côte d’Ivoire.[2]
C’est l’estomac noué et la gorge serrée que les citoyens de six pays membres de la Communauté économique des Etats d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) s’apprêtent à entrer dans une période électorale devenue synonyme, dans une trop grande partie du continent, de risque maximal de crise violente. Les premiers qui devraient être convoqués aux urnes sont les électeurs de Guinée Bissau où un scrutin présidentiel et des législatives censés tourner la page d’une période de transition sont prévus le 13 avril prochain. Dans ce pays lusophone, le seul de la région avec les îles du Cap-Vert, le calendrier électoral a été systématiquement perturbé depuis la démocratisation formelle au début des années 1990 par des coups de force militaires, des assassinats politiques et dernièrement par la mort naturelle du président. Mais c’est en 2015 que l’actualité électorale sera extraordinairement chargée.[1] Des élections présidentielles sont prévues au premier trimestre au Nigeria et au Togo, puis au dernier trimestre au Burkina Faso, en Guinée et en Côte d’Ivoire.[2]
 Au cours des dernières semaines, la bataille politique entre le People’s Democratic Party (PDP) et son rival de l'opposition, le All Progressives Congress (APC), a été largement reléguée au second plan au Nigeria. Au lieu de cela, tous les yeux sont fixés sur Boko Haram et la façon dont le gouvernement compte endiguer la menace.
Au cours des dernières semaines, la bataille politique entre le People’s Democratic Party (PDP) et son rival de l'opposition, le All Progressives Congress (APC), a été largement reléguée au second plan au Nigeria. Au lieu de cela, tous les yeux sont fixés sur Boko Haram et la façon dont le gouvernement compte endiguer la menace.
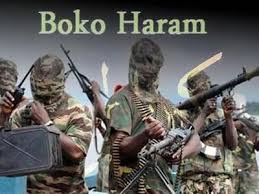 La lutte contre Boko Haram
La lutte contre Boko Haram
 Le second tour de l’élection présidentielle en République de Guinée-Bissau, tenu le 18 mai dernier, a livré son verdict. Avec 62% des suffrages, José Mario Vaz a remporté face à Nuno Gomes Nabiam (38%) un scrutin qui vient couronner un énième processus de normalisation de la tumultueuse vie politique locale.
Le second tour de l’élection présidentielle en République de Guinée-Bissau, tenu le 18 mai dernier, a livré son verdict. Avec 62% des suffrages, José Mario Vaz a remporté face à Nuno Gomes Nabiam (38%) un scrutin qui vient couronner un énième processus de normalisation de la tumultueuse vie politique locale.
 « Je n'ose imaginer ce que le monde aurait dit de lui si ce héros avait été blanc », Mark Doyle, journaliste de la BBC à propos de Mbaye D
« Je n'ose imaginer ce que le monde aurait dit de lui si ce héros avait été blanc », Mark Doyle, journaliste de la BBC à propos de Mbaye D Instituées comme étant un outil de sécurité et de stabilité pour une Afrique nouvellement décolonisée, un demi-siècle après, des bases militaires françaises continuent d’exister dans nombreux pays africains (les Comores, le Cameroun, le Gabon, la Centrafrique, la Côte d’Ivoire, Djibouti…), ce qui peut paraitre incompréhensible, d’autant plus que ces pays ne sont pas les plus stables d’Afrique.
Instituées comme étant un outil de sécurité et de stabilité pour une Afrique nouvellement décolonisée, un demi-siècle après, des bases militaires françaises continuent d’exister dans nombreux pays africains (les Comores, le Cameroun, le Gabon, la Centrafrique, la Côte d’Ivoire, Djibouti…), ce qui peut paraitre incompréhensible, d’autant plus que ces pays ne sont pas les plus stables d’Afrique.
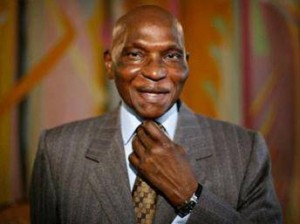
 Malgré un état de santé chancelant, le Président algérien, très affaibli, n’a pas hésité à se porter candidat à sa propre succession. L’élection présidentielle du 17 avril 2014, dépourvue de tout suspense, paraissait comme une simple formalité car le candidat Abdelaziz Bouteflika était assuré de l’emporter.
Malgré un état de santé chancelant, le Président algérien, très affaibli, n’a pas hésité à se porter candidat à sa propre succession. L’élection présidentielle du 17 avril 2014, dépourvue de tout suspense, paraissait comme une simple formalité car le candidat Abdelaziz Bouteflika était assuré de l’emporter.
 Alors que le monde entier célèbre le vingtième anniversaire du tragique génocide rwandais, au Burundi, on déplore le vingtième anniversaire d’un assassinat. Celui de Melchior Ndadaye, président du Burundi de juin à octobre 1993, qui faisait partie de la majorité Hutu. Une tentative de coup d’Etat suivie de près par le massacre de milliers de Tutsi, minoritaires au Burundi, puis d’une escalade de violence qui fait écho à celle qui sévissait au Rwanda à la même période. Frontalier du Rwanda, avec lequel il partage certains aspects démographiques, le Burundi a lui aussi été le théâtre de massacres entre Hutu et Tutsi. Représentant de l'Organisation Mondiale de la Santé à Bujumbura au moment des faits, le Dr Mouhtare Ahmed revient sur les constats réalisés par une équipe de l'ONU dépêchée sur les lieux entre 1994 et 1995, et sur sa propre expérience.
Alors que le monde entier célèbre le vingtième anniversaire du tragique génocide rwandais, au Burundi, on déplore le vingtième anniversaire d’un assassinat. Celui de Melchior Ndadaye, président du Burundi de juin à octobre 1993, qui faisait partie de la majorité Hutu. Une tentative de coup d’Etat suivie de près par le massacre de milliers de Tutsi, minoritaires au Burundi, puis d’une escalade de violence qui fait écho à celle qui sévissait au Rwanda à la même période. Frontalier du Rwanda, avec lequel il partage certains aspects démographiques, le Burundi a lui aussi été le théâtre de massacres entre Hutu et Tutsi. Représentant de l'Organisation Mondiale de la Santé à Bujumbura au moment des faits, le Dr Mouhtare Ahmed revient sur les constats réalisés par une équipe de l'ONU dépêchée sur les lieux entre 1994 et 1995, et sur sa propre expérience.
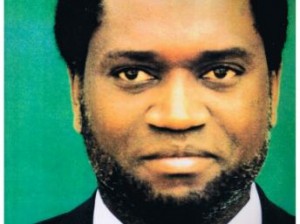 Ndadaye : « ils ont tué Ndadaye, mais ils n’ont pas tué tous les Ndadaye ».
Ndadaye : « ils ont tué Ndadaye, mais ils n’ont pas tué tous les Ndadaye ».