 En 2000 s’est tenu un rassemblement historique des chefs d’État et de gouvernement au siège de l’Organisation des Nations Unies (ONU) à New York. A l’issue de cette rencontre cent quatre-vingt-neuf (189) pays ont adopté la déclaration du millénaire, dans laquelle les huit (8) objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) ont été annoncés. Quinze (15) ans plus tard, le résultat de l’objectif huit (8) concernant « le partenariat mondial pour le développement » indique que « L’aide publique au développement des pays développés a augmenté de 66 % en valeur réelle entre 2000 et 2014 ». En mettant en parallèle celui-là avec le résultat du premier objectif des OMD qui avait pour but de réduire l’extrême pauvreté et la faim montrant que « la proportion des personnes sous-alimentées dans les pays en développement a diminué de près de moitié depuis 1990. », il devient pertinent de s’interroger sur ce que ces avancements impliquent dans une dimension plus ciblée à savoir la lutte contre la malnutrition en Afrique Subsaharienne.
En 2000 s’est tenu un rassemblement historique des chefs d’État et de gouvernement au siège de l’Organisation des Nations Unies (ONU) à New York. A l’issue de cette rencontre cent quatre-vingt-neuf (189) pays ont adopté la déclaration du millénaire, dans laquelle les huit (8) objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) ont été annoncés. Quinze (15) ans plus tard, le résultat de l’objectif huit (8) concernant « le partenariat mondial pour le développement » indique que « L’aide publique au développement des pays développés a augmenté de 66 % en valeur réelle entre 2000 et 2014 ». En mettant en parallèle celui-là avec le résultat du premier objectif des OMD qui avait pour but de réduire l’extrême pauvreté et la faim montrant que « la proportion des personnes sous-alimentées dans les pays en développement a diminué de près de moitié depuis 1990. », il devient pertinent de s’interroger sur ce que ces avancements impliquent dans une dimension plus ciblée à savoir la lutte contre la malnutrition en Afrique Subsaharienne.
Malgré les a priori sur le sujet, la malnutrition n’est pas liée simplement à des apports d’aliments en excès ou insuffisants ; elle est principalement causée par une absence de nutriments essentiels affaiblissants les défenses du sujet contre les maladies courantes tout en pesant sur sa croissance. En Afrique , même si l’on constate une augmentation de la visibilité des cas d’obésités et de surpoids -qui sont un autre type de malnutrition- accompagnés par des cas de maladies liées à l’alimentation et à la nutrition comme les maladies cardiovasculaires, les diabètes etc., le type de malnutrition le plus connu par l’inconscient collectif, et attribué au continent africain, est celui lié aux carences qui touche généralement les enfants de moins de cinq (5) ans , dont les deux (2) principales formes sont définies ci-dessous :
- la malnutrition chronique ou retard de croissance est le résultat d’une alimentation et/ou d’une hygiène inadéquate, de l’insuffisance des soins sur une longue période. Le retard de croissance est un indicateur de la pauvreté et de la vulnérabilité. Ses conséquences se mesurent sur le long terme.
- la malnutrition aigüe résultant d’un apport énergétique insuffisante, des pratiques d’allaitement et d’alimentation inadéquate et des maladies récurrents. Ses conséquences sont immédiates et peuvent conduire à des risques de mortalité.
Le nombre de personnes touchées par la malnutrition est assez conséquent tant au niveau planétaire qu’au niveau du continent africain, d’où l’importance d’élaborer des stratégies de réponses harmonieuses, cohérentes et rationnelles nécessitant d’important flux financiers et de compétences diverses faisant appel aux Etats, aux bailleurs, aux agences onusiennes, à la société civile, au secteur privé et au secteur académique. Cela peut être expliqué par différents facteurs et en particulier par les multiples engagements pris par les acteurs de la nutrition présents en Afrique subsaharienne. En guise d’exemple on peut citer le cas du Burkina Faso qui, bien que les derniers événements socio-politiques aient ralenti l’avancement de sa feuille de route, est en cours d’élaborer son Plan Stratégique Multisectoriel. Ceci explique sans nul doute le fait que le gouvernement burkinabé a érigé au rang de priorité nationale : la lutte contre le retard de croissance, en signant le pacte mondial de nutrition pour la croissance économique et sociale.
Cette note introductive rend compte de l’importance des investissements pour soutenir les pays en voies de développement dans leur lutte contre la pauvreté et les problématiques de santé publique à l’image de la malnutrition. Pour faire face à cette problématique de santé publique frappant de plein fouet le continent, des investissements sont attribués à l’ensemble des interventions destinées à lutter contre.
Ceux-ci sont généralement attribués à deux grands types d’intervention : d’une part les interventions directes ou spécifiques, autrement dit celles qui s’adressent aux déterminants immédiats de la nutrition et du développement fœtal et infantile (Ruel et al, 2013). D’autre part les interventions indirectes, c’est-à-dire celles qui attaquent les déterminants sous-jacents de la nutrition et du développement fœtal et infantile – sécurité alimentaire, pratiques de soins adéquats au niveau maternel, familial et communautaire, accès à des services de santé et à un environnement sain et hygiénique- en intégrant des objectifs et actions spécifique à la nutrition (Ruel et al, 2013) communément appelés interventions « sensibles ». Si ces deux premiers types d’interventions catalysent une grande partie des investissements de la nutrition, nous pouvons noter tout de même l’existence d’investissements destinés à un troisième type d’intervention pour faire face à la malnutrition: la construction d’un environnement favorable. Ce dernier type d’intervention renvoie à des évaluations rigoureuses, à des stratégies de plaidoyer adaptés et efficaces, à la coordination des actions à tous les niveaux, à un engagement de redevabilité, à la régulation des motivations et de la législation, à un développement des capacités d’investissements et à la mobilisation des ressources intérieures.
Ces faits montrent de part et d’autre l’importance de la lutte contre la malnutrition et des investissements mobilisés par les différents secteurs. Par contre si l’on tient compte du suivi des investissements réalisé dans les financements des activités de santé à travers les Comptes Nationaux de la Santé, des investissements publics pour les infrastructures, des audits auprès des entreprises privées et publiques etc., il devient tout à fait légitime de s’interroger sur le suivi des investissements en nutrition dans les pays en développement. Qui finance la nutrition dans ces pays, principalement en Afrique subsaharienne ? Quelles sont les interventions les plus financées ? Ces interventions ont-elles des impacts positifs ? Peut-on mesurer le coût-efficacité des interventions de la nutrition ?
Pour répondre à ces différentes questions, une méthodologie ne concernant que les investissements publics a été proposée par le mouvement Scaling Up Nutrition (SUN) «fondé sur le principe du droit à l’alimentation et une bonne nutrition à tous » regroupant les six secteurs (évoqués en haut) pour renforcer la nutrition. La méthodologie proposée consiste à :
- identifier les allocations budgétaires pertinentes pour la nutrition via une recherche par mot-clé ;
- évaluer clairement les allocations budgétaires spécifiques et sensibles à la nutrition;
- attribuer des ratios aux spécifiques (100 %), tel qu’un programme national de nutrition; et une allocation raisonnable pour les programmes contribuant à la nutrition (e.x 25 %), tels que les programmes de protection sociale et les programmes de développement de la petite enfance.
L’atelier SUN tenu dans la capitale ivoirienne du 27 au 29 avril 2015 avec la présence de quatorze (14) pays dont sept (7) pays – Benin, Burkina Faso, Burundi, Comores, Cote d’Ivoire, République Démocratique du Congo, Madagascar- ont réalisé et présenté l’analyse des budgets de la nutrition. Les résultats de l’analyse soulignent la quasi-absence d’interventions spécifiques à la nutrition pour le Cameroun ainsi qu’une grande partie des sept (7) pays, comme en témoigne la remarque d’un représentant de la société civile camerounaise : « il n’y a presque pas de budget pour les interventions spécifiques à la nutrition » concluant qu’ils vont se servir des résultats de l’atelier pour attirer l’attention du gouvernement afin qu’il soit pris en compte dans le prochain plan budgétaire. Cet exercice a permis également aux pays présents à l’atelier de connaître les secteurs qui contribuent à la nutrition et où trouver les allocations de la nutrition.
Dans le même sens des ateliers SUN sur les investissements en nutrition on peut citer la rencontre des pays anglophones d’Afrique en Ouganda du 21 au 22 avril 2015 avec la participation de l’Ouganda, du Kenya, du Lesotho, de la Gambie, du Ghana, du Soudan du Sud et de la Zambie. Les faits saillants de l’atelier recommandèrent d’intégrer les allocations de la nutrition dans les différents secteurs du gouvernement zambien et la multisectorialité de la nutrition a refait surface ainsi que la nécessité d’adapter le jargon de la nutrition afin de la rendre accessible.
En sommes ce que l’on peut dire à l’issu des ateliers SUN sur le suivi des investissements en nutrition est que « disposer de données fiables est essentiel pour permettre aux décideurs de procéder à la définition des priorités, à la planification et à la prise de décisions éclairées sur l’allocation des ressources pour la nutrition dans les budgets nationaux. C’est à ce point que les gouvernements opèrent des choix fondamentaux de dépense pour améliorer la nutrition, lesquels choix peuvent jeter les bases pour l’avenir de la nation ». En d’autre terme la redevabilité des acteurs des différents secteurs de la nutrition est primordiale pour la mise en place des Plans Nationaux de Nutrition. L’engagement des acteurs d’être comptable de la nutrition permettrait non seulement aux pays de disposer de données concernant les allocations et les dépenses pour la nutrition, mieux cet engagement serait aussi un baromètre pour mesurer le coût-efficacité des interventions. De plus si les données sont renseignées de manière transparente l’outil peut servir de comparaison entre les pays ayant suivi les investissements en nutrition, ce qui serait un moyen pour mesurer l’efficacité ou non des interventions financées dans différents pays et différents contextes.
Le Guatemala a compris cela en élaborant son propre système de suivi des investissements en nutrition. Il a mis en place un système de surveillance des investissements en faveur de la nutrition, dans l’optique de déterminer l’adéquation des ressources par rapport aux investissements. Depuis la mise en place de ce système le pays a maintenant à sa disposition (Bulux J. et al., 2014) :
- un budget de sécurité alimentaire et nutritionnelle ventilé par Institution, Programmes et Activités ;
- des responsabilités claires, avec des fonctionnaires désignés responsables des différentes étapes du système de mise en place ;
- un outil simple de mise en œuvre, facilitant la compréhension des dépenses publiques à différents niveaux ;
- une bonne coordination entre les institutions.
En dehors de cet exemple, l’Afrique subsaharienne pourrait disposer de son propre système de suivi des investissements en tenant compte par exemple aux amendements du dernier rapport d’Unicef sur le suivi des investissements en nutrition au Burkina Faso entre 2011 et 2014. Ces amendements peuvent être améliorés en cherchant du côté des travaux réalisés par le mouvement SUN, même si sa méthodologie mérite d’être affiner, du côté des récents travaux académiques sur le sujet et du côté du SPRING qui envisage de continuer à suivre les investissements de la nutrition pour l’Ouganda et le Népal.
Cette démarche responsable, de qualité et d’engagement à la transparence, base d’un « contrat moral » à la redevabilité serait un premier pas pour « éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l’agriculture durable » comme souhaité par le deuxième objectif, des Objectifs du Développement Durable (ODD) qui sont une nouvelle série d’objectifs, cibles et indicateurs rentrés en vigueur cette année pour une durée de quinze (15) ans sur lesquels les États membres de l’ONU devraient baser leur programmes et politiques.
Ibrahima-Ndary GUEYE
Références :
Les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) : http://www.un.org/fr/millenniumgoals/reports/2015/pdf/MDG%202015%20pressreleasemessage_fr.pdf
Malnutrition MSF : http://www.msf.fr/activites/malnutrition
Malnutrition FAO: http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/eufao-fsi4dm/doc-training/bk_1b.pdf
Mouvement SUN : http://scalingupnutrition.org/fr/ressources/suivi-financier-et-mobilisation-des-ressources/analyse-de-budget
Global SUN Gathering 2015 https://www.youtube.com/watch?v=MHp2B0NmjLs
Atelier SUN Ouganda: http://scalingupnutrition.org/fr/news/les-pays-sun-dafrique-demontrent-le-bien-fonde-de-linvestissement-pour-la-nutrition-a-travers-lanalyse-de-budget#.VkuJBvkve01
Atelier SUN Abidjan: http://www.euractiv.fr/sections/aide-au-developpement/les-odd-cest-quoi-315654
Les Objectifs du Développement Durable (ODD) : http://www.euractiv.fr/sections/aide-au-developpement/les-odd-cest-quoi-315654
Picanyol C., Financial Resource Tracking for Nutrition: Current State of the Art and Recommendations for Moving Forward, Global Nutrition Report, disponible sur: http://globalnutritionreport.org/files/2014/11/gnr14_pn4g_11picanyol.pdf
The Lancet, Maternal and child Nutrition, Executif summary of the Lancet Maternel and children nutrition series, 2013. Disponible sur http://thousanddays.org/wp-content/uploads/2013/06/Nutrition_exec_summ_final.pdf
Bulux J. et al ., Suivi des crédits financiers en faveur de la nutrition : l’expérience du Guatemala. Nutrition Mondiale, Rapport 2014 disponible sur : http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/gnr14fr.pdf

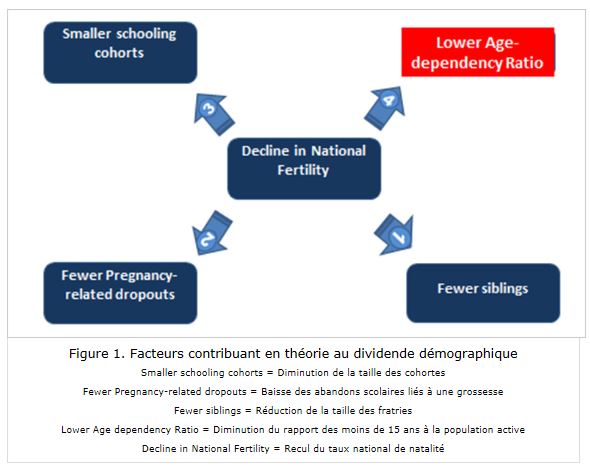
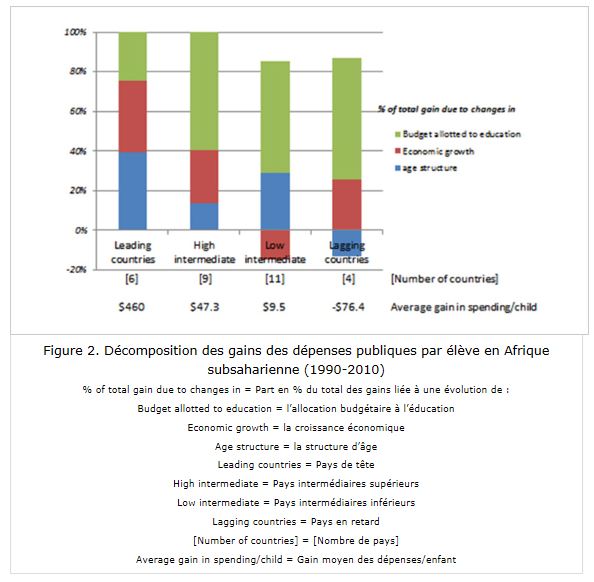
 Les enjeux environnementaux en Afrique sont énormes, du souillage du Delta du Niger au traitement des déchets et des effluents, en passant par la surexploitation des ressources halieutiques des côtes. En matière de protection de l’environnement, l’approche par les droits de propriété a été développée depuis les années 80, en réaction à la fois à l’approche réglementaire et à la nouvelle tradition juridique « Law & Economics » fondée sur le critère de l’efficience. Elle propose un retour à la règle de responsabilité civile et se révèle être une alternative promouvant à la fois le respect des droits, la croissance et l’environnement. Mais qu’en serait-il en Afrique ?
Les enjeux environnementaux en Afrique sont énormes, du souillage du Delta du Niger au traitement des déchets et des effluents, en passant par la surexploitation des ressources halieutiques des côtes. En matière de protection de l’environnement, l’approche par les droits de propriété a été développée depuis les années 80, en réaction à la fois à l’approche réglementaire et à la nouvelle tradition juridique « Law & Economics » fondée sur le critère de l’efficience. Elle propose un retour à la règle de responsabilité civile et se révèle être une alternative promouvant à la fois le respect des droits, la croissance et l’environnement. Mais qu’en serait-il en Afrique ?
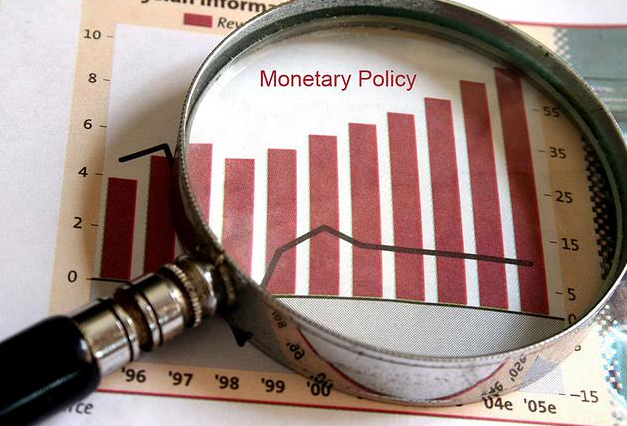
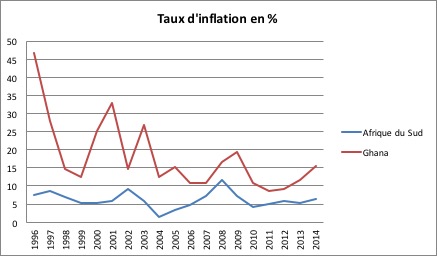

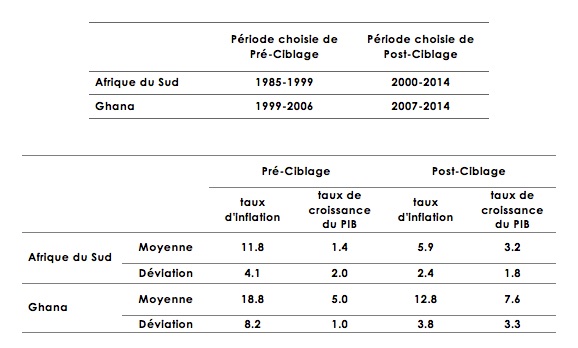
 [/caption]
[/caption]

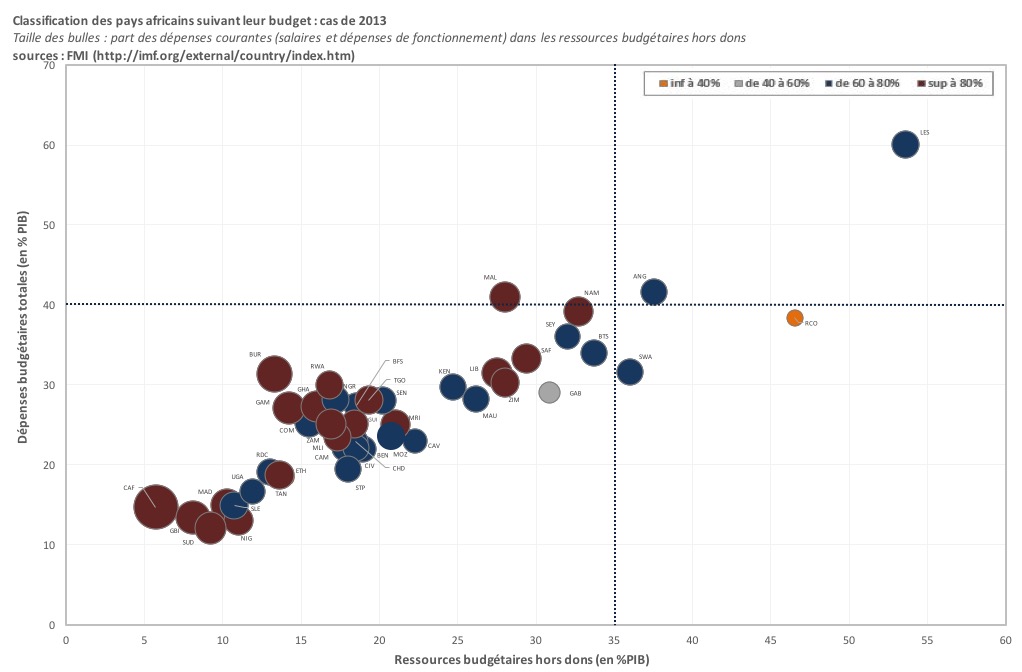

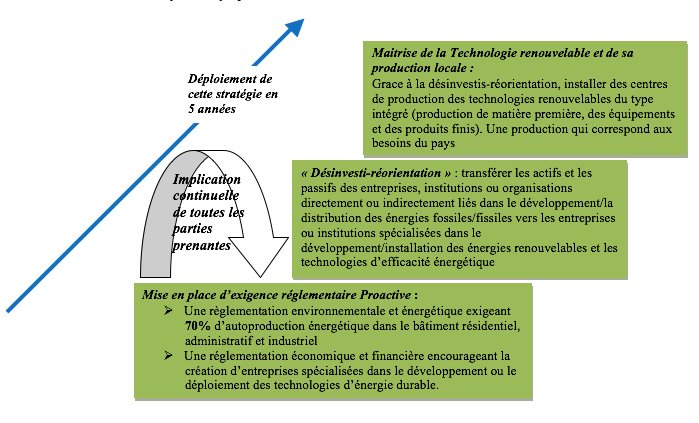
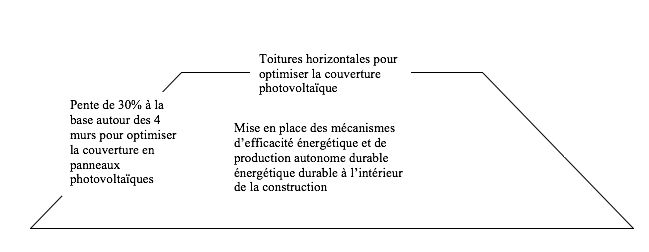
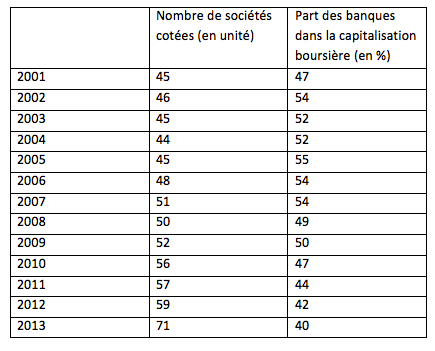
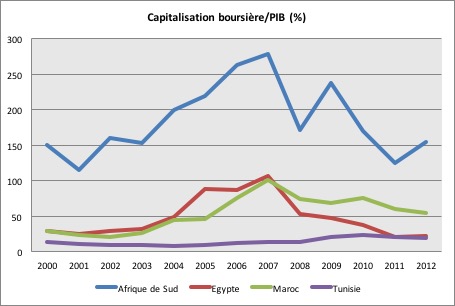





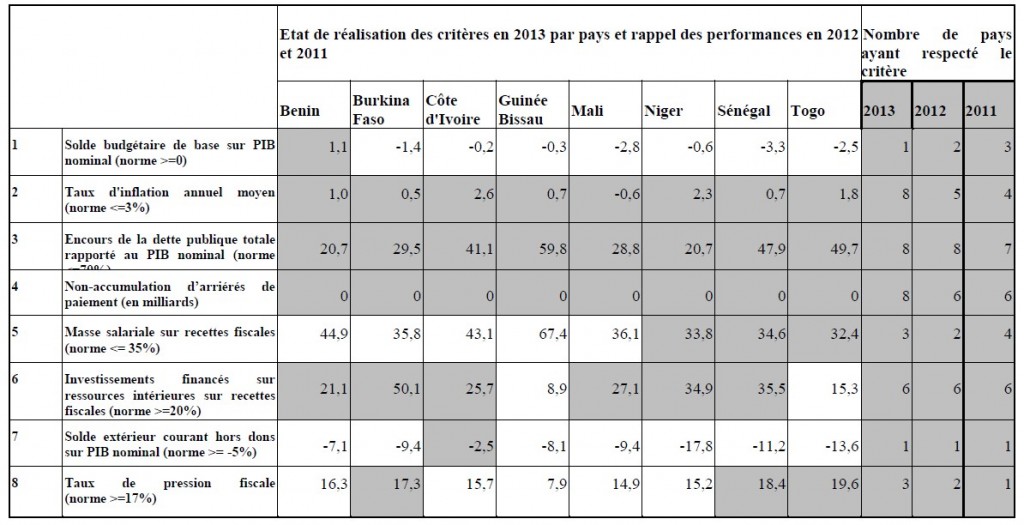

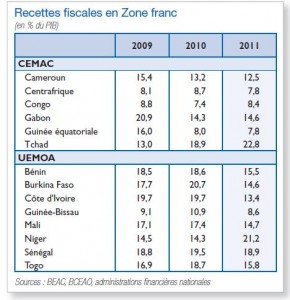
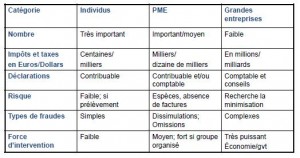
 En 2013, les flux d’IDE en direction de la Côte d’Ivoire ont plus que triplé par rapport à 2012, atteignant 621 millions d’euros (CEPICI). En 2014 et 2015, cette donnée devrait être encore plus importante. En outre le pays bénéficie de conditions allégées sur les marchés financiers (régional et international). Ses émissions de longue maturité (supérieur à 3 ans) sont sursouscrites à des taux relativement faibles par rapport à ses pairs de la région (6% en moyenne sur les émissions effectuées depuis 2013). Pour ses premières incursions sur le marché international, le pays a obtenu des taux relativement bas (5,625% pour la première portant sur 750 millions de dollars et 6,625% sur la seconde portant sur 1 milliard de dollars) là où les autres pays obtiennent des niveaux de rémunérations atteignant 10%.
En 2013, les flux d’IDE en direction de la Côte d’Ivoire ont plus que triplé par rapport à 2012, atteignant 621 millions d’euros (CEPICI). En 2014 et 2015, cette donnée devrait être encore plus importante. En outre le pays bénéficie de conditions allégées sur les marchés financiers (régional et international). Ses émissions de longue maturité (supérieur à 3 ans) sont sursouscrites à des taux relativement faibles par rapport à ses pairs de la région (6% en moyenne sur les émissions effectuées depuis 2013). Pour ses premières incursions sur le marché international, le pays a obtenu des taux relativement bas (5,625% pour la première portant sur 750 millions de dollars et 6,625% sur la seconde portant sur 1 milliard de dollars) là où les autres pays obtiennent des niveaux de rémunérations atteignant 10%.

 Le sport est un secteur qui subit plusieurs mutations, qui connaît une croissance assez rapide et qui ne laisse personne indifférent. Cependant son incidence macroéconomique est sous–estimée. Il est selon PricewaterhouseCoopers, le seul secteur qui n’a pas connu la crise et son marché à l’échelle mondiale devrait connaître une croissance annuelle moyenne de 3,7 % d'ici à 2015
Le sport est un secteur qui subit plusieurs mutations, qui connaît une croissance assez rapide et qui ne laisse personne indifférent. Cependant son incidence macroéconomique est sous–estimée. Il est selon PricewaterhouseCoopers, le seul secteur qui n’a pas connu la crise et son marché à l’échelle mondiale devrait connaître une croissance annuelle moyenne de 3,7 % d'ici à 2015 L’Accord de partenariat économique (APE) est le dernier des nombreux processus de négociations commerciales dans lesquels les pays africains se sont simultanément engagés. De nombreuses réflexions ont déjà fort pertinemment documenté les implications et enjeux de ces processus, qui se chevauchent ou se juxtaposent, sur les faibles ressources humaines, matérielles et institutionnelles des Etats africains, pour qu’il soit utile d’y revenir.
L’Accord de partenariat économique (APE) est le dernier des nombreux processus de négociations commerciales dans lesquels les pays africains se sont simultanément engagés. De nombreuses réflexions ont déjà fort pertinemment documenté les implications et enjeux de ces processus, qui se chevauchent ou se juxtaposent, sur les faibles ressources humaines, matérielles et institutionnelles des Etats africains, pour qu’il soit utile d’y revenir.