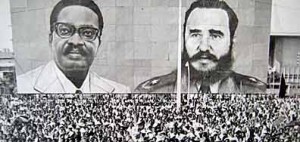Suite et fin d'un panorama de la situation politique au Togo par Giani Gnassounou, dont la première partie est parue sur L'Afrique des Idées il y a quelques semaines sous le titre: "Le Togo, ou l'impossible alternance".
Suite et fin d'un panorama de la situation politique au Togo par Giani Gnassounou, dont la première partie est parue sur L'Afrique des Idées il y a quelques semaines sous le titre: "Le Togo, ou l'impossible alternance".
Plusieurs mois après les élections présidentielles remportées par le président sortant Faure Gnassingbé (2005-), la vie politique togolaise semble en léthargie. Les leaders de l’opposition s'expriment de moins en moins, contrairement aux élections précédentes où ils étaient légion à prendre d'assaut les médias pour contester vigoureusement les résultats proclamés. Ce n’est pas l'envie qui leur manque, bien au contraire, mais leur position est plutôt précaire. Ils avaient promis aux populations que les élections de 2015 seraient « l’ultime rendez-vous » pour obtenir l’alternance politique au Togo et proposer aux Togolais, après près d’un demi-siècle de règne sans partages, une autre manière de faire de la politique. Affirmer que cette mission s’est soldée par un échec est un pur euphémisme. L’impasse politique est sans précédent dans l’histoire politique togolais et ceci, en raison de plusieurs facteurs.
Un président protégé de toutes parts
Sur le plan interne, l’Union pour la République (UNIR), parti du président réélu, est majoritaire à l’Assemblée nationale. Dans ce contexte, une modification de la Constitution actuelle, qui ne prévoit pas de limitation de mandats, ne se fera qu’au gré de la volonté de la majorité dirigeante ; quand bien même la grande majorité de la population togolaise (85%) souhaite une révision de cette constitution, d’après un sondage réalisé par l’institut Afrobaromètre en 2014.
L’opposition togolaise est plus que jamais divisée et sort très affaiblie de ces élections. Entre une opposition « participationniste », qui a essuyé un cuisant échec ; une opposition « abstentionniste », qui ne cesse d’accuser la première d’avoir légitimé des élections frauduleuses ; et un président sortant qui n’attendait que cela, le peuple semble résigné à l’idée d’une quelconque alternance. Sur le plan externe, les dernières élections ont été saluées par l’ensemble de la communauté internationale et des chancelleries occidentales présentes au Togo. Faure Gnassingbé y a ainsi gagné en légitimité et en reconnaissance. Avec une opposition décimée par des querelles internes et un président béni par ses pairs à l’international, Gnassingbé a un boulevard devant lui et rien ne semble pouvoir l’empêcher de poursuivre sereinement son règne à la tête du pays. L’alternance est-elle à jamais compromise ?
Excepté le bien vouloir du prince, les moyens pour entrer dans une nouvelle ère politique sont rares voire utopiques
La mauvaise idée d’une lutte armée
En Afrique, l’alternance s’obtient souvent par la lutte armée, sans pourtant qu’elle produise des résultats meilleurs ; la situation tend plutôt à se dégrader. Les régimes renversés par les armes ont généralement été remplacés par des régimes de même nature sauf quelques cas marginaux tels que le Ghana, où l’utilisation de la force armée a permis l’instauration plus tard d’un régime démocratique pérenne. Depuis 1960, années des indépendances de la majeure partie des pays africains, pas moins de 80 coups d’État ont été perpétrés. 40% des régimes politiques africains entre 1960 et 1990 avaient des origines militaires. En 2014, plus de cinquante années après les indépendances, encore un État sur trois est dirigé par un régime d’origine militaire. Au Togo, ce moyen est inenvisageable. L’armée est acquise à la cause de la majorité dirigeante, du fait de sa composition ethnique. En effet, sous l’ère du père de Faure Gnassingbé, Gnassingbé Eyadéma (1963-2005), une politique d’ethnicisation de l’armée a été menée de sorte que cette dernière est composée aujourd’hui majoritairement de personnes originaires du nord du pays, fief électoral du pouvoir en place. Depuis les années 1990, début de la lutte pour l’instauration de la démocratie, l’armée constitue un acteur clé de la scène politique. A la solde du pouvoir en place, elle a permis son maintien aux affaires et n’a pas hésité comme en 2005, à perpétrer des massacres au nom de la survie du régime.
La partialité et l’ethnicisation de l’armée ont toujours fait craindre une guerre ethnique sur le territoire togolais. Cette stratégie serait donc très mal venue et ne ferait que déplacer ou aggraver le problème.
L’illusion du pouvoir au peuple et du peuple au pouvoir
Le pouvoir au peuple ou le peuple au pouvoir. Pour être exact ce serait le peuple dans les rues et le pouvoir au peuple. Quelques mois avant la tenue des élections présidentielles togolaises, le Burkina Faso, pays voisin du Togo a connu une accélération inattendue de son histoire politique. Le peuple s’est levé comme un seul homme pour empêcher l’ex-président Blaise Compaoré (1987-2014) de modifier la constitution et de rempiler pour un nouveau mandat. L’expérience burkinabè a flatté l’opposition togolaise, qui s’est convaincu qu’elle pouvait être répliquée au Togo, mais il n’en a été rien. Au Burkina, mais également en Tunisie lors du Printemps arabe de 2011, la version surmédiatisée qui présente le peuple prenant son destin en main et imposant sa souveraineté devrait fortement être nuancée. En effet, le comportement des forces armées, autant dans le cas du Faso que celui de la Tunisie, a déterminé l’issue du soulèvement populaire. C’est également le comportement des corps habillés qui a déterminé la situation du Printemps égyptien, dont l’état actuel atteste bien mon propos sur le rôle des forces armées dans ces situations.
Les révolutions populaires dans ces pays précités, n’auraient pas produit ces résultats si l’armée ne s’était pas désolidarisée du pouvoir en place. Dans le contexte togolais, cette neutralité de l’armée n’est pas encore acquise. En effet, s’il y a bien une institution (si on peut se permettre ce terme) qui au fil des années est restée solide et efficace malgré les soubresauts internes (qui n’ont jamais filtré) qu’elle a pu connaitre, c’est bien les Forces armées togolaises. C’est peu dire que l’inébranlable fidélité de la Grande Muette au régime explique la longévité de ce dernier.
On pourrait même être tenté de dire qu’elle est le premier garant de la République, devant la Cour constitutionnelle et les autres institutions. On se rappelle bien le triste épisode de la nomination de Faure Gnassingbé par l’armée à la tête du pays le soir de l’annonce du décès de son père le 5 février 2005. Au Togo, l’armée semble avoir plus de pouvoir qu’elle ne le montre. Inféodée au pouvoir en place, elle n’hésite pas à le faire valoir quand le besoin se fait sentir.
Toutefois, il faut préciser que c’est aussi toute la classe politique togolaise (opposition et majorité) qui a conféré ce pouvoir à l’armée: la majorité avec sa politique d’ethnicisation et de favoritisme ; mais aussi l’opposition, avec ses prises de position extrêmes contre l’armée, qui font craindre des représailles en cas d’alternance. Dans ce contexte, un soulèvement populaire ne saurait à lui seul provoquer une alternance au Togo. D’ailleurs, on en est loin tant le peuple semble résigné à propos de cette problématique.
La sagesse d’un compromis patriotique
La question prioritaire et brulante n’est pas la nécessité d’une alternance. Il s’agit surtout d’installer un débat politique franc, accepté par le peuple, qui ne souffre d’aucune contestation ou ambiguïté pouvant conduire à l’alternance. Le verrou politique, imposé par l’armée, ne sera levé que par un sursaut patriotique et la volonté de tous les acteurs du jeu politique d’aligner le Togo dans le chœur des pays africains « considérés » comme démocratiques.
Ce sursaut patriotique, au nom de l’intérêt supérieur de la nation, passera par l’ouverture d’un vrai dialogue entre la classe politique et les F.A.T. En effet les forces armées constituent un acteur incontournable dans le jeu politique togolais ainsi que dans le jeu politique de plusieurs autres pays africains. Depuis les années 1990, cette armée fidèle au père et aujourd’hui au fils a été accusée des crimes les plus atroces contre la population. Elle est très impopulaire au sein de la population mais également auprès de l’opposition.
L’armée eu l’occasion de s’expliquer sur son rôle dans les tragédies qu’a connu le Togo lors des auditions de la Comité Vérité Justice et réconciliation (mise en place par le gouvernement togolais en 2009 chargée de faire la lumière sur les heures obscures de la nation entre 1958 et 2005 ). Malheureusement, les F.A.T n’ont pas su profiter de cette occasion pour épurer leur passif auprès des populations et redorer leur blason. Le président Faure a tenté, ça et là, à travers certains évènements, de rapprocher l’armée du peuple mais le résultat reste assez mitigé. Il faut dire que les crimes dont est accusée l’armée peuvent constituer des crimes internationaux de nature imprescriptibles. En d’autres termes, la peur n’est pas que dans le camp des révoltés et des lassés du régime.
C’est à ce niveau que l’opposition a une obligation certaine de pédagogie dans la communication. Rassurer ces hommes contre l’idée de toute chasse aux sorcières et leur expliquer qu’un Togo libre, pluraliste ne peut être bénéfique qu’à tout le monde. L’intérêt supérieur de la nation passe également par un consensus purement politique entre les différents acteurs.
Aujourd’hui, la classe politique est un immense champ de ruines : une opposition diverse et divergente, incapable d’adopter une stratégie unitaire en son propre sein et un pouvoir incapable de discuter et d’incarner une réelle ouverture démocratique et de mettre en application ses propres engagements. Mais quel autre destin pourrait-on proposer aux descendants de Dzitri[1] si le dialogue reste impossible ?
Giani Gnassounou