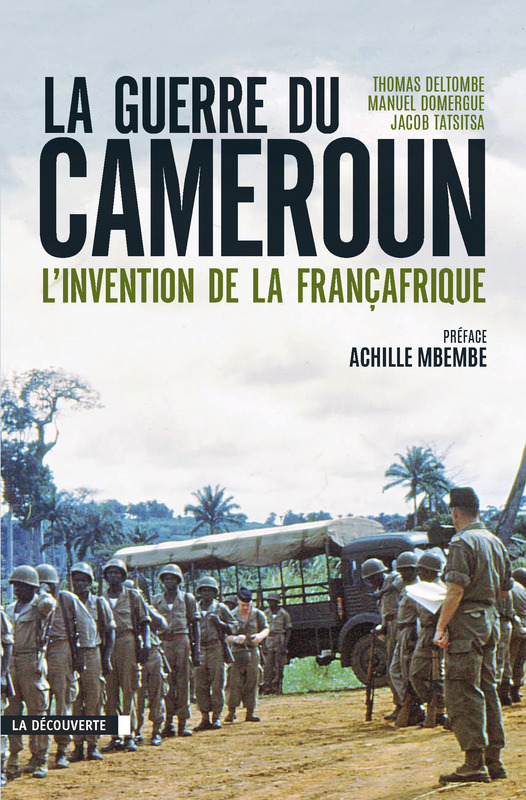En ce début d’année 2017, que peut-on dire globalement de la situation démocratique des États africains? Alors que certains pays consolident bon an mal an les acquis démocratiques obtenus souvent de haute lutte et au prix de moult sacrifices, d’autres n’arrivent pas encore à se défaire des relents encore bien vivaces et prégnants de l’autoritarisme. Alors qu’on assiste à des passations de pouvoir pacifiques et des alternances démocratiques dans certains pays, on a encore affaire à des dirigeants qui, avec leurs affidés et sinistres thuriféraires pas assez repus des ors de la République et autres avantages dantesques, s’emploient à user des procédés retors pour prolonger indûment leur bail à la tête de l’État. Preuve s’il en est que la hantise du pouvoir demeure un tropisme vivace dans le chef de bien d’autorités politiques en Afrique. Précisons déjà que nous ne mesurons pas la bonne santé démocratique des pays africains à l’aune de la seule tenue d’élections libres et transparentes dans ces pays. Ce serait là une conception fort minimaliste et subjective de la démocratie.
En ce début d’année 2017, que peut-on dire globalement de la situation démocratique des États africains? Alors que certains pays consolident bon an mal an les acquis démocratiques obtenus souvent de haute lutte et au prix de moult sacrifices, d’autres n’arrivent pas encore à se défaire des relents encore bien vivaces et prégnants de l’autoritarisme. Alors qu’on assiste à des passations de pouvoir pacifiques et des alternances démocratiques dans certains pays, on a encore affaire à des dirigeants qui, avec leurs affidés et sinistres thuriféraires pas assez repus des ors de la République et autres avantages dantesques, s’emploient à user des procédés retors pour prolonger indûment leur bail à la tête de l’État. Preuve s’il en est que la hantise du pouvoir demeure un tropisme vivace dans le chef de bien d’autorités politiques en Afrique. Précisons déjà que nous ne mesurons pas la bonne santé démocratique des pays africains à l’aune de la seule tenue d’élections libres et transparentes dans ces pays. Ce serait là une conception fort minimaliste et subjective de la démocratie.
Les bons élèves de la démocratie en Afrique
Le Ghana et le Bénin ont connu l’année dernière des élections apaisées et une alternance démocratique pacifique au sommet de l’État. Dans ces deux pays, le pluralisme politique est perçu comme une force et n’est pas étouffé. Les syndicats sont bien organisés, et constituent un moyen de pression vis-à-vis du gouvernement. C’est également le Bénin qui organisa la première conférence nationale sur le continent en 1990. Il est aussi le pionnier dans l’établissement d’une commission électorale nationale autonome. Le mérite du Bénin est qu’il n’est pas resté sclérosé dans une sorte d’exaltation de ce rôle historique de précurseur démocratique mais comme le souligne à juste titre l’analyste Constantin Somé dans son mémoire de maîtrise : «Le Bénin s'illustre par sa capacité d'innovation dans un souci d'équité et de transparence, signe de progrès refusant l'usurpation du pouvoir par tout groupe ou toute faction qui n'émanerait pas d'un choix du corps électoral. C'est pourquoi il a été mis sur pied «un arbitre» chargé des consultations électorales, qui revendique toute son autonomie et son indépendance. Il semble cultiver le pacifisme par une gestion de plus en plus saine des compétitions électorales à travers une institutionnalisation progressive des organes chargés de réguler les élections et surtout leur indépendance vis à vis du gouvernement, du parlement et des pouvoirs publics ».[1]
En ce qui concerne le Ghana, il occupe la deuxième place en Afrique après la Namibie et la 26ème au niveau mondial du classement 2016 de Reporters Sans Frontières (RSF) sur la liberté de la presse.[2] Cette place de choix dans ce classement international traduit le souci constant de garantir à la presse ses prérogatives d’indépendance éditoriale et de liberté de ton et d’opinion. Sur le plan politique, le vote populaire est respecté et les perdants acceptent leur défaite. Lors de la présidentielle de 2012, la Cour Constitutionnelle avait déclaré Dramani Mahama vainqueur face à Akuffo Addo, après recours de ce dernier devant ladite cour. Face à ce verdict, il avait reconnu sa défaite et appelé Mahama pour le féliciter. En 2016, le président sortant Mahama a été battu lors des élections par Akuffo-Addo et a reconnu aussitôt sa défaite. Tout ceci porte à croire que la démocratie ghanéenne se consolide inéluctablement. `
Toujours en Afrique de l’ouest, le Sénégal est également avant-gardiste en matière de démocratie sur notre continent. Même si ce pays a connu des épisodes ponctuels de « crise », il a toujours su se ressaisir. La longue et solide tradition de militantisme dans les sphères politique, associative et syndicale (Ex : Collectif Y’EN A MARRE, Raddho, Forum Civil ainsi que d’autres organisations de la société civile et des partis politiques alertes et engagés) constitue un garde-fou non-négligeable contre les velléités autoritaires et anti-démocratiques. La défaite du président Wade contre son adversaire Macky Sall en 2012, le référendum constitutionnel organisé par ce dernier en 2016 sont illustratifs de la bonne santé démocratique de ce pays et de la volonté de ses citoyens et dirigeants de préserver l’ethos démocratique sénégalais. Les États insulaires que sont le Cap-Vert et Maurice méritent aussi d’être évoqués comme des démocraties exemplaires sur le continent. Ces pays connaissent une stabilité politique qui est notamment le fruit d’une institutionnalisation et du respect des règles et pratiques démocratiques qui encadrent aussi bien l’action publique que la sphère privée.
Pour ce qui est de l’Afrique du Sud, c’est une démocratie qui fonctionne aussi bien en général.. On peut porter au crédit de cette nation et contrairement à beaucoup de pays sous nos tropiques que le pouvoir judiciaire est quand même indépendant de l’exécutif. Pour preuve, on peut citer les démêlés judiciaires du président Zuma empêtré dans des scandales de corruption et d’abus de pouvoir. On a tous en mémoire les rapports de l’ex-médiatrice de la République Thuli Madonsela qui a révélé en toute indépendance- même si elle a ensuite subi des pressions politiques- le « Nkandlagate » qui réfère à la rénovation d’une résidence privée du président avec l’argent public et aussi l’affaire concernant l’étroite collusion entre Zuma et la richissime famille Gupta. Même si les assassinats ciblés sont encore légion dans ce pays, on peut quand même voir que sur le terrain institutionnel, la liberté de parole est garantie et respectée, comme en témoignent les sévères récriminations des députés de l’EFF (Economic freedom fighters) de Julius Malema lors des sessions parlementaires en présence même du président Zuma.
Sao Tomé et Principe est aussi un modèle démocratique en Afrique. Même si ce petit pays, peu stratégique du point de vue géopolitique et économique suscite peu d’intérêt pour les observateurs et analystes internationaux, il reste que les fondamentaux de la démocratie y sont établis et valorisés. La même analyse peut être faite pour la Tanzanie.
Selon un classement de Reporters Sans Frontières (RSF) de 2014 sur la liberté de la presse, la Namibie est le seul pays d’Afrique à obtenir un score peu ou prou comparable aux pays scandinaves, en étant mieux notée (19ème à l’échelle mondiale) que la France (37ème) et bien d’autres pays du Vieux Continent. Il est également le premier pays africain à organiser des élections présidentielles et législatives par vote électronique en Novembre 2014.
Le Botswana jouit également d’une assez bonne réputation en matière de démocratie. Ce pays organise des élections libres et transparentes de façon régulière, présente aussi un tableau plutôt reluisant en matière de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption même si on ne peut pas ignorer les mesures coercitives et répressives prises à l’encontre de la minorité San, aussi appelée Bushmen.
En Afrique du Nord, la Tunisie essaie de se démarquer de ses voisins. Elle s’est dotée d’une constitution progressiste et a organisé en 2014 des élections libres et transparentes. L’activisme de certaines organisations syndicales ou de la société civile telles que l’UGTT (Union générale tunisienne du travail) et la ligue des droits de l’Homme en Tunisie (LTDH) a été sans contredit d’un apport capital dans ce sursaut démocratique.
Les régimes réfractaires à l’implantation durable des principes démocratiques
À côté de ces pays-à propos desquels, faut-il le rappeler on ne prétend aucunement une quelconque exhaustivité ni situation démocratique idyllique-qui présentent un profil démocratique assez remarquable, s’opposent des pays qui restent toujours prisonniers de régimes autoritaires ou peu démocratiques. En Afrique, nombreux sont les régimes qui instaurent des démocraties « cosmétiques » ou de façade. Nombreux sont les régimes qui feignent de s’enticher des fondamentaux de la démocratie comme le multipartisme, les élections libres et transparentes, un État de droit, une loi fondamentale, alors même que la gestion de leurs pays reflète nettement un pouvoir arbitraire, autocratique et/ou corrompu, c’est selon. L’Afrique des grands lacs (Ouganda, RDC, Rwanda et Burundi) et des pays comme l’Erythrée, la Gambie, le Zimbabwe, le Soudan, Djibouti, l’Ethiopie, l’Egypte, pour ne citer que ces quelques pays parmi bien d’autres sont encore loin d’avoir atteint les standards souhaitables ou escomptés d’une démocratie, pour parler en termes euphémiques. Il est évident que la situation démocratique de ces pays n’est pas tout à fait homogène. Certains de ces pays sont dirigés par des régimes tyranniques et jusqu’au-boutistes, frontalement réfractaires aux ambitions démocratiques des populations, alors que dans d’autres, malgré des lacunes démocratiques importantes, certains principes démocratiques de base sont relativement- parfois au gré des humeurs du régime- bien promus et appliqués.
Les populations africaines et notamment la jeunesse ont ardemment soif de démocratie pour exprimer librement leurs potentialités. Elles ne veulent plus que celles-ci soient étouffées par des dérives autoritaires surannées. Récemment, on a vu comment le régime de Yahya Jammeh en Gambie a tenté d’effectuer un coup de force illégitime pour demeurer au pouvoir malgré sa défaite. Cette mégalomanie de trop n’a fort heureusement connu que le destin qu’elle méritait : un échec. L’Union africaine ainsi que les organisations subrégionales se doivent de jouer un rôle actif pour enrayer les dynamiques autoritaires. Le principe de la non-ingérence dans les affaires intérieures d’un pays, braillé à tue-tête surtout par les despotes et leurs irréductibles ne saurait résoudre ces organisations du continent à de l’attentisme pendant que des populations se voient arracher injustement leur humanité et dignité. Vivement que la démocratie africaine renaisse de ses cendres et s’engage résolument vers le progrès!
Thierry SANTIME
[1] Somé, Constantin (2009, pp.31-32) : « Pluralisme socio-ethnique et démocratie : cas du Bénin ». Mémoire en vue de l’obtention d’une maîtrise en science politique à l’Université du Québec à Montréal.