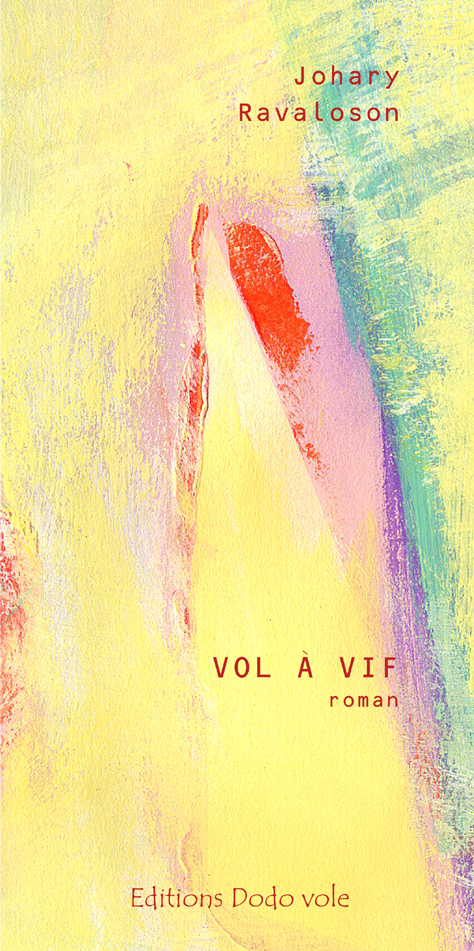A force de rencontre, de mariages, de divorces, et de métissage, la culture africaine a essaimé donnant naissance à de nombreux styles de danse ou encore de musique… Aujourd’hui plus que jamais la culture africaine s’exporte et traverse les âges, elle vit hors du continent grâce à la diaspora et à ses amis.
A force de rencontre, de mariages, de divorces, et de métissage, la culture africaine a essaimé donnant naissance à de nombreux styles de danse ou encore de musique… Aujourd’hui plus que jamais la culture africaine s’exporte et traverse les âges, elle vit hors du continent grâce à la diaspora et à ses amis.
A Marseille, la diaspora (ou plutôt devrais-je dire les diasporas) et les amateurs de culture africaine ont aussi leur lieu de rassemblement, l’Afriki Djigui Théatri. Depuis décembre, le Kollectif Afrobeat y donne un concert tous les deux mois : la « session Afrobeat ». J’ai assisté pour vous à leur dernier concert le 26 février. Récit d’un bel exemple de diffusion de la culture africaine :
L’Afriki Djigui Théatri, un haut lieu de diffusion de la culture afro
Des bancs par-ci, un vieux fauteuil par-là, des cadres et quelques masques africains aux murs. Le local d’Afriki Djigui Théatri a une décoration basique et un confort sommaire, il a tout d’un simple local associatif. Mais sa buvette improvisée et la petite scène que l’on découvre en fond de salle laisse penser qu’il s’y passe bien plus de choses qu’on ne peut le croire en pénétrant au 27 rue d’Anvers. L’association est un haut lieu de la culture afro à Marseille. Créée en 2001 par l’actrice ivoirienne Nacky Sy Savane et le promoteur culturel Kélétigui Coulibaly, dès ses débuts, l’Afriki Djigui a pour vocation d’offrir un espace d’expression aux artistes africains. Théatre, musique, contes, cinéma, rencontres littéraires, expositions, cette association franco-ivoirienne offre une scène aux arts africains et afrophiles qui ne trouvent pas toujours un lieu d’exposition dans nos villes. L’Afriki Djigui crée un pont entre la diaspora et son continent en lui facilitant l’accès à ses racines. Mais ne vous y trompez pas, l’Afriki Djigui Theatri n’a pas pour but d’être sectaire, sa programmation est riche et va dans le fond et dans la forme au-delà des frontières africaines. Kélétigui Coulibaly prône « la rencontre et la découverte autour de la culture […] et que l’on prenne ce qu’il y a de meilleur chez le voisin). Ainsi la programmation fait aussi la part belle aux arts et styles musicaux dérivés de la culture afro : le blues, le jazz, l’afrobeat…
Le Kollectif Afrobeat, un bel exemple de l'universalité africaine
L’Afriki Djigui Théatri apparaît alors comme la scène toute désignée pour laisser éclater la musique festive du Kollectif Afrobeat. Le groupe né il y a cinq ans à l’initiative deux copains musiciens : Christophe le guitariste et Nicolas le batteur qui rencontrent ensuite Fred le chanteur. Le trio s’entoure progressivement de musiciens talentueux et passionnés pour constituer un orchestre. Le Kollectif Afrobeat, c’est une bande de 15 musiciens qui s’enjaillent sur scène sur un mélange de funk, de jazz et de highlife: l’Afrobeat. « J’adore cette musique, une fois que l’on rentre dedans, on n’en sort plus » confie Louise, une saxophoniste suédoise fraîchement recrutée. Le groupe est riche, varié et métissé à l’image de la musique de Fela Kuti auquel la bande rend hommage. Dans le Kollectif Afrobeat on écoute des hommes, des femmes, des blondes, des brunes, des chauves, des jeunes et moins jeunes, de toutes origines mais pas nécessairement africaine. « Non, nous n’avons pas de lien particulier avec l’Afrique, nous ne participons pas non plus à des actions humanitaires, mais on adhère à la musique et au message de Fela Kuti ». Et quand la bande joue, tous les instruments de l’afrobeat sont là : saxophone, trompette, guitare, batterie, conga, clavier et les emblématiques chekeré et clave. Les différents chanteurs du groupe, fidèles à l’œuvre de l’artiste, reprennent même ses paroles en yoruba et en pidging. « Chacun son moyen de lutte » me dira Christophe ; « Fela était un artiste engagé et faisait passer un message à travers sa musique et nous on prend part à la lutte en jouant la musique de Fela! » Le rythme et la ferveur sont là quand on écoute le Kollectif Afrobeat. Dès l’intro le public agit comme en miroir face au groupe, sourire aux lèvres, les pieds qui battent la mesure. A l’écoute des paroles, on cerne le propos « No agreement today, no agreement tomorrow. I no go agree make my brother hungry».
Fela Kuti et l'Afrobeat : l'histoire d'un musicien engagé
Ni musicienne, ni historienne, je ne connaissais rien de l’Afrobeat ni de son créateur et encore moins son histoire. C’est donc à travers la performance du Kollectif Afrobeat et suite à mes échanges avec ses porte-paroles que j’ai découvert l’art et le combat de Fela Kuti. Il y a quelque chose de frappant dans l’histoire de l’artiste musicien nigérian. Sa musique est à l’image de sa vie et sa vie à l’image de l’Afrique, pleine de ressources et influencée, brave et engagée, entre gloire et déchéance. Né en 1938 au Nigeria, Fela Kuti va faire son éducation musicale en Europe. En voyage aux Etats-Unis au début des années 1970, il se forge une conscience politique. De retour au Nigéria, la musique de Fela Kuti opère un retour aux rythmes africains savamment alliés à des rythme jazz et funk. Ses textes en pidging porte un message politique engagé en faveur de l’émancipation et de la responsabilisation du peuple nigérian face à la corruption de la classe dirigeante de l’époque. Les titres « Why blackman dey suffer » et « no agreement » clairement expriment son engagement. Homme de culture populaire, il est arrêté, battu et incarcéré à plusieurs reprises. Il meurt en 1997 du virus du sida et usé par des années de lutte pour le Nigéria.
Imprégnée, géniale, inspirée, engagée, tragique, telle se résume l’œuvre et la vie de Fela. L’africain est artiste, il devient génie lorsqu’il discipline ses élans créateurs et se nourrit de ses racines pour inventer. Il se mue en leader quand il utilise son art pour conscientiser, il meurt mais son œuvre lui succède quand il a su rassembler.
Pour qu’elle vive et traverse les frontières, la culture afro a besoin de caisse de résonnance. C’est ce que propose l’Afriki Djigui Théatri à Marseille. Sa programmation met la lumière sur des artistes influencés par la culture afro sous toutes ses formes. C’est le cas du Kollectif Afrobeat, dont certains membres marqués par les performances scèniques de Fela de son vivant, contribuent aujourd’hui à la diffusion de son œuvre. Les oeuvres comme celles de Fela sont une richesse, qui doit être transmis aux nouvelles générations de jeunes africains et issues de la diaspora car la culture est aussi une arme de lutte soft, il est dans l’intérêt commun que la nôtre rayonne.
Michelle Camara












 Dans un article du Nouvel Obs, Souleymane Bachir Diagne s’imaginait expliquant à son enfant les fondements du soufisme. Tantôt définie comme la branche mystique de l’Islam, tantôt vue comme une démarche purement spirituel et indépendante du dogme, le soufisme est aujourd’hui plus que jamais d’actualité : Eric Geoffroy en parlant de la spiritualité musulmane, la désignait comme la seule solution pour la pérennité de l'Islam.
Dans un article du Nouvel Obs, Souleymane Bachir Diagne s’imaginait expliquant à son enfant les fondements du soufisme. Tantôt définie comme la branche mystique de l’Islam, tantôt vue comme une démarche purement spirituel et indépendante du dogme, le soufisme est aujourd’hui plus que jamais d’actualité : Eric Geoffroy en parlant de la spiritualité musulmane, la désignait comme la seule solution pour la pérennité de l'Islam.


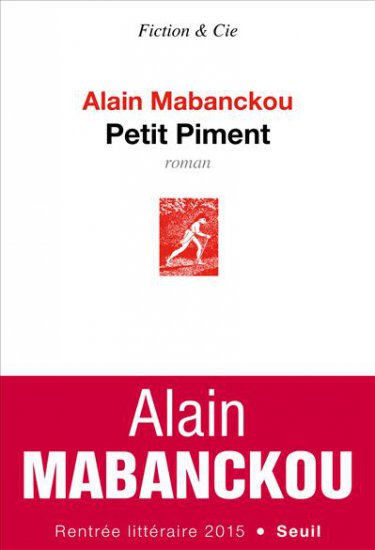

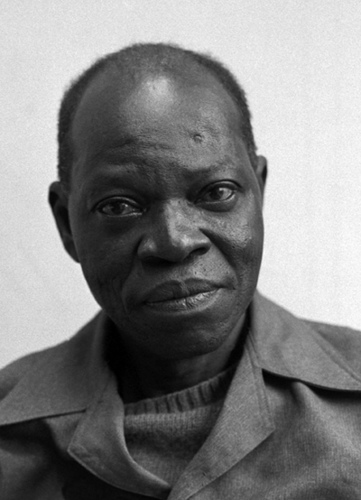
 France où il réside depuis plusieurs années, Fessologue qu’on le surnomme à cause du culte qu’il voue au postérieur des femmes. En proie à un chagrin d’amour causé par le départ de sa compagne, notre héros plonge dans une certaine mélancolie. Et c’est dans l’écriture qu’il trouvera refuge. Dans une narration à la première personne, Fessologue s’épanche : il revient sur sa relation avec son ex, parle de ses potes du Jip’s, ce bar en plein cœur de Paris où il passe le plus clair de son temps libre, de son voisin de palier cet « antillais qui n’aime pas les noirs », de l’épicier arabe du coin qui à la moindre occasion lui tient de grands discours sur l’Occident et ses torts et travers, et de toutes les rencontres qui auront un rôle déterminant dans sa vie.
France où il réside depuis plusieurs années, Fessologue qu’on le surnomme à cause du culte qu’il voue au postérieur des femmes. En proie à un chagrin d’amour causé par le départ de sa compagne, notre héros plonge dans une certaine mélancolie. Et c’est dans l’écriture qu’il trouvera refuge. Dans une narration à la première personne, Fessologue s’épanche : il revient sur sa relation avec son ex, parle de ses potes du Jip’s, ce bar en plein cœur de Paris où il passe le plus clair de son temps libre, de son voisin de palier cet « antillais qui n’aime pas les noirs », de l’épicier arabe du coin qui à la moindre occasion lui tient de grands discours sur l’Occident et ses torts et travers, et de toutes les rencontres qui auront un rôle déterminant dans sa vie.